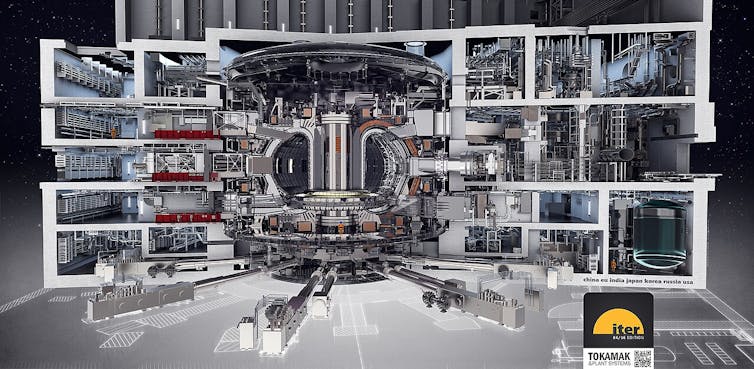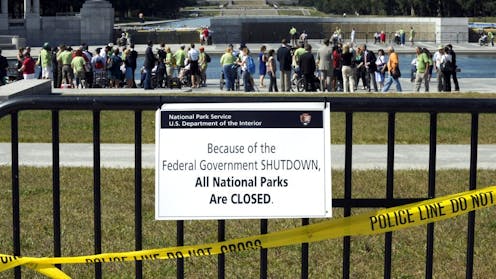Source: The Conversation – in French – By Vincent Bricart, Doctorant au Center for International Relation Studies de l’Université de Liège. Spécialisé dans l’étude des relations transatlantiques EU-USA et dans la politique étrangère des Etats-Unis., Université de Liège
Les prédécesseurs de Donald Trump ont tous assumé, chacun à sa façon, la notion d’« exceptionnalisme américain ». Lors de son discours prononcé à l’ONU, le 24 septembre dernier, le locataire actuel de la Maison Blanche a présenté une vision très différente de ce concept, ancrant la politique étrangère conduite par Washington dans les principes de nationalisme et de souverainisme, et y ajoutant une forte composante personnelle. De l’exceptionnalisme américain, on semble être passés à un « exceptionnalisme trumpien ».
Mercredi 24 septembre 2025, Donald Trump a pris la parole devant l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) pour la première fois depuis sa réélection. D’une durée d’un peu moins d’une heure, cette intervention a marqué les esprits autant par sa forme – un langage singulier pour un discours adressé à ses pairs internationaux – que par le fond du message. Trump y a vanté son bilan et défendu sa vision de l’Amérique (c’est-à-dire, des États-Unis) sur la scène mondiale, s’en prenant largement au passage à l’institution onusienne, aux politiques migratoires et environnementales de l’Union européenne, au bilan de son prédécesseur Joe Biden, ou encore à certaines figures étrangères comme le maire de Londres Sadiq Khan et le président du Brésil Lula.
Plus qu’une simple série de règlements de comptes, le discours de Trump visait surtout à exposer les succès de son Amérique et à affirmer l’avènement d’un nouveau modèle américain, marqué par une forme d’exceptionnalisme proprement trumpien : une Amérique illibérale, centrée sur le leadership personnel du président, en rupture avec la conception traditionnelle du rôle des États-Unis dans le monde.
Retour sur l’exceptionnalisme et le modèle américains post-guerre froide
Pour comprendre la rupture que constitue ce discours, il faut d’abord comprendre ce que sont l’« exceptionnalisme américain » et le modèle qui en découle.
L’exceptionnalisme américain repose sur trois postulats ou croyances constitutifs de l’identité nationale états-unienne. D’une part, les États-Unis se perçoivent comme une société distincte des autres dans l’histoire, car investie d’un destin singulier : la « destinée manifeste ». D’autre part, leur organisation politique, leurs institutions, leur démocratie et la liberté individuelle qui en résulte sont considérées comme supérieures à celles des autres pays du monde. Enfin, prévaut la conviction que l’Amérique constitue une référence, un modèle à diffuser – par l’exemple ou par l’action – à l’ensemble de l’humanité.
Ces idées sont profondément ancrées aussi bien dans une partie de la population que dans la grande majorité de la classe politique américaine. La notion d’exceptionnalisme américain se trouve ainsi au cœur de l’identité nationale des États-Unis. Elle repose non pas sur une histoire ou un peuple homogène, mais sur un patrimoine de valeurs partagées (liberté, autodétermination, destin unique) qui sert de mythe fondateur et de refuge en période de crise. Portant une dimension religieuse et émotionnelle, elle agit comme un ciment fédérateur pour les citoyens.

Wikimedia
Dans le domaine de la politique étrangère, l’exceptionnalisme sert d’outil de légitimation et de justification. Deux grandes doctrines s’en dégagent : une approche messianique, visant à exporter le modèle américain à l’échelle mondiale, par la persuasion ou par la force ; et une approche exemplaire, qui consiste à laisser ce modèle rayonner et inspirer sans chercher à l’imposer.
Sa souplesse en fait un concept en constante évolution, que les dirigeants du pays adaptent selon leurs besoins pour affirmer leur vision du leadership et du rôle des États-Unis dans le monde. Le locataire de la Maison Blanche occupe une place décisive dans ce processus. En tant que commandant en chef des armées et de la garde nationale et principal porte-parole du pays, il façonne la doctrine de politique étrangère et incarne les valeurs de l’exceptionnalisme. Ses discours sont des instruments privilégiés pour reformuler et actualiser ce récit, en fonction de sa propre lecture du contexte international et de ses objectifs politiques. À travers ses allocutions, il construit une stratégie narrative qui lie les valeurs américaines à l’affirmation de la puissance et au maintien du leadership mondial.
Depuis la fin de la guerre froide, l’exceptionnalisme américain et le modèle qu’il promeut dans les instances internationales, notamment à l’AGNU, ont évolué dans leurs modalités.
Dans les années 1990, sous George H. W. Bush et Bill Clinton, Washington a cherché à orienter le système multilatéral tout en multipliant les interventions militaires dites « humanitaires » : première guerre du Golfe en 1990-1991, opération Restore Hope en Somalie en 1992-1993, participation aux frappes de l’Otan contre les forces serbes en Bosnie en 1995 et en Serbie en 1999, pour n’en citer que quelques-unes. Les États-Unis se posaient alors comme « puissance indispensable », garante de la stabilité mondiale, promouvant un exemple cosmopolite et multilatéraliste.
Au début des années 2000, George W. Bush a durci cette posture. Inspirée par les néoconservateurs et le traumatisme du 11-Septembre, son administration a adopté une politique messianique, interventionniste, fondée sur la supériorité morale et militaire des États-Unis. Le recours à la force fut justifié par l’indispensable « démocratisation » du Moyen-Orient et la lutte contre les « États voyous ». Ces interventions – en particulier la guerre en Irak, illégale au regard du droit international car non autorisée par le Conseil de sécurité – ainsi que les propos et la vision très critique de l’administration Bush (la plus hostile envers l’ONU jusqu’à l’arrivée de Donald Trump) à l’égard du multilatéralisme ont considérablement fragilisé la crédibilité du modèle américain promu à l’international.
À partir de 2009, Barack Obama a cherché à redéfinir cette notion d’exceptionnalisme : tout en affirmant la singularité du modèle américain, il a privilégié l’exemplarité interne et le multilatéralisme, rejetant le messianisme guerrier de ses prédécesseurs. Son approche relevait d’un leadership se voulant adapté à une ère « post-américaine » dans laquelle les États-Unis, en tant que puissance majeure, assumeraient davantage un rôle de soutien qu’une position de leader systématique.
Après le premier mandat Trump (nous y reviendrons), Joe Biden a entrepris de relancer l’exceptionnalisme américain, réaffirmant le leadership des États-Unis sur la scène mondiale en s’érigeant en chef de file indispensable des démocraties face à la montée de l’autoritarisme global. La guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine en février 2022 est venue conforter sa vision d’un affrontement décisif entre démocratie et autocratie. Cependant, les événements consécutifs aux massacres du 7 octobre 2023 ont mis en lumière les contradictions de ce modèle : le soutien presque indéfectible apporté à Israël malgré la catastrophe humanitaire imposée aux habitants de Gaza a fragilisé le leadership moral américain et le modèle démocratique que Biden cherchait à réaffirmer. Par ailleurs, l’évolution progressive du contexte politique intérieur a infléchi sa rhétorique, recentrant son discours sur le modèle de résilience de la démocratie américaine face aux menaces internes portées par le mouvement MAGA.
Malgré ces variations et leurs interprétations parfois ambiguës, une constante demeure dans les discours des présidents américains à l’AGNU : la valorisation d’un ordre international fondé sur la coopération, l’État de droit, la démocratie, les droits humains, la libre concurrence et la bonne gouvernance selon les principes néolibéraux – même si les États-Unis n’ont pas toujours respecté l’exemple qu’ils défendaient eux-mêmes.
Le discours de Trump à l’AGNU : l’exceptionnalisme trumpien
Lors de son discours à la 80eAssemblée générale de l’ONU, Donald Trump a abordé plusieurs thèmes marquants. Nous revenons ici sur les plus polémiques.
Le président Trump a d’abord sévèrement critiqué l’institution, ironisant sur ses infrastructures défaillantes (un escalier mécanique et un prompteur tombés en panne) et mettant en doute l’utilité même d’une organisation incapable, selon lui, de régler le moindre conflit – sachant qu’il a lui-même contribué à cet affaiblissement en réduisant la contribution américaine au budget de l’ONU – et accusant l’institution d’en créer de nouveaux en encourageant l’immigration dans les pays occidentaux.
Trump a ensuite martelé sa défense de la souveraineté nationale comme principe cardinal des relations internationales, en rupture frontale avec l’héritage multilatéraliste et universaliste de ses prédécesseurs. Cette posture nationaliste et identitaire l’a conduit à affirmer que le christianisme était désormais « le culte le plus menacé au monde » et à fustiger la politique migratoire européenne, accusée de fragiliser la cohésion des sociétés.
À lire aussi :
L’Europe vue par J. D. Vance : un continent à la dérive que seul un virage vers l’extrême droite pourrait sauver
Il a également réaffirmé son déni du changement climatique, qu’il a qualifié d’« escroquerie », et a rejeté toute régulation environnementale, inscrivant ainsi son discours dans une logique productiviste et consumériste caractéristique de sa vision économique.
À lire aussi :
Trump face au dérèglement climatique : du climatoscepticisme au radicalisme Dark MAGA
En ce qui concerne la politique énergétique, il a dénoncé la dépendance européenne au pétrole russe et pointé du doigt la Chine et l’Inde pour leurs choix énergétiques similaires.
Enfin, l’allocution s’est distinguée par un ton particulièrement vindicatif. Trump a multiplié les attaques personnelles, mentionnant Joe Biden à sept reprises pour critiquer son bilan, et s’en prenant à d’autres figures politiques comme le maire de Londres, le travailliste Sadiq Khan – accusé de vouloir « imposer la charia » –, ou encore le président brésilien Lula da Silva. Tout en soulignant qu’il avait une bonne relation personnelle avec lui, il a reproché au gouvernement de Lula, parmi autres, d’instrumentaliser la justice – une référence à peine voilée à la récente condamnation à vingt-sept ans de prison de Jair Bolsonaro, le prédécesseur de Lula, pour tentative de coup d’État en 2023.
En parallèle, l’hôte de la Maison Blanche a longuement insisté sur les « succès » de son administration, se targuant notamment d’avoir mis fin à « sept guerres », et affirmant que les États-Unis vivaient leur « Âge d’or », portés par la puissance de leur économie, de leurs frontières, de leur armée, de leurs amitiés et de leur esprit national.
À lire aussi :
Recréer un second « Gilded Age » (Âge doré) : les illusions de Trump
Jamais dans l’histoire de l’AGNU un président états-unien ne s’était autant vanté de ses succès, tout en critiquant ouvertement ses prédécesseurs et des dirigeants de pays amis démocratiquement élus. Une telle approche est d’autant plus atypique qu’elle relève davantage de la dynamique d’un discours sur l’état de l’Union, traditionnellement prononcé chaque mois de janvier devant le Congrès américain, que d’une allocution solennelle devant ses pairs à l’ONU.
Comment comprendre ce discours ?
Le discours de Donald Trump consolide la remise en cause, entamée durant son premier mandat, de la place et de la fonction de l’exceptionnalisme américain traditionnel dans la politique étrangère de Washington. Contrairement à ses prédécesseurs, il rejette l’idée que les États-Unis incarneraient nécessairement le « monde libre » ou qu’ils seraient investis d’une mission universelle au service de la démocratie et des droits humains.
À ses yeux, l’héritage multilatéral des dernières décennies a affaibli la puissance américaine et son image internationale. Son propos vise autant les dimensions symboliques de l’exceptionnalisme – leadership systématique, vocation morale – que les politiques concrètes qui en découlaient.
Dès lors, sa critique des Nations unies, sa promotion de la souveraineté des États, le rejet des politiques migratoires et le soutien au matérialisme dans le rapport de force traditionnel entre États (où les États-Unis partent avantagés) s’inscrivent dans une volonté de rupture. C’est une réorientation franche, assumée, qui s’oppose au modèle libéral et multilatéral de l’Amérique post-guerre froide pour laisser place à une vision américaine illibérale, qui a vocation à s’exporter à travers le monde et notamment en Europe. Sa critique des politiques conduites par l’Union européenne doit se comprendre selon la même logique.
Toutefois, Trump ne nie pas la supériorité et le caractère exceptionnel de l’Amérique : sa perspective nationaliste et protectionniste est centrée sur la défense prioritaire des intérêts américains et sur une glorification de la puissance matérielle. Dans une logique de rapport de force, il veut prouver que son Amérique est la plus forte, au-dessus des autres nations et modèles et, pour cela, il valorise la puissance tangible – ressources, poids économique, budget militaire – et les victoires concrètes qu’il présente comme des wins (accords politiques, succès économiques ou militaires favorables aux États-Unis).
Le modèle trumpien se traduit ainsi par une surreprésentation de l’affirmation de la supériorité des États-Unis et de leur puissance matérielle, une puissance que les politiques vertes et les énergies renouvelables pourraient, selon lui, entraver. Plus qu’un simple déni du changement climatique, Trump critique toute mesure limitant le marché et la prospérité. En outre, derrière ses attaques contre l’achat de pétrole russe se profile la volonté de promouvoir les exportations américaines de GNL.
Parallèlement, Trump individualise cet exceptionnalisme en l’associant directement à sa propre personne. Il met en avant le modèle non pas de l’Amérique en général, mais bien de son Amérique – celle de son administration et de son leadership personnel. Cette appropriation s’accompagne d’une défiance marquée à l’égard des autres modèles – qu’il s’agisse de celui des démocrates tels que Joe Biden, celui des Européens ou celui des leaders de gauche au niveau international comme Lula da Silva.
Il se présente comme l’unique acteur capable de restaurer la grandeur américaine : c’est une forme d’« auto-exceptionnalisme », qui souligne le caractère singulier et supérieur des aptitudes du président actuel à incarner et à réaffirmer la singularité américaine.
Le discours de Donald Trump à l’AGNU de septembre 2025 illustre ainsi la reconfiguration du modèle américain vers une approche axée sur le souverainisme, sur le protectionnisme, sur le nationalisme et sur un leadership fortement personnalisé, au détriment de la tradition multilatéraliste, néolibérale et universaliste, qui caractérisait jusque-là la projection américaine dans les affaires mondiales. Cette orientation s’accompagne d’une défense prioritaire, assumée et sans compromis des intérêts nationaux dans un rapport de force global ouvert. Déjà, ce modèle américain inspire des émules en Europe comme ailleurs dans le monde, et tout indique qu’il est appelé à encore se renforcer au cours des prochaines années.
![]()
Vincent Bricart ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. À l’ONU, Donald Trump redessine l’exceptionnalisme américain à son image – https://theconversation.com/a-lonu-donald-trump-redessine-lexceptionnalisme-americain-a-son-image-266262