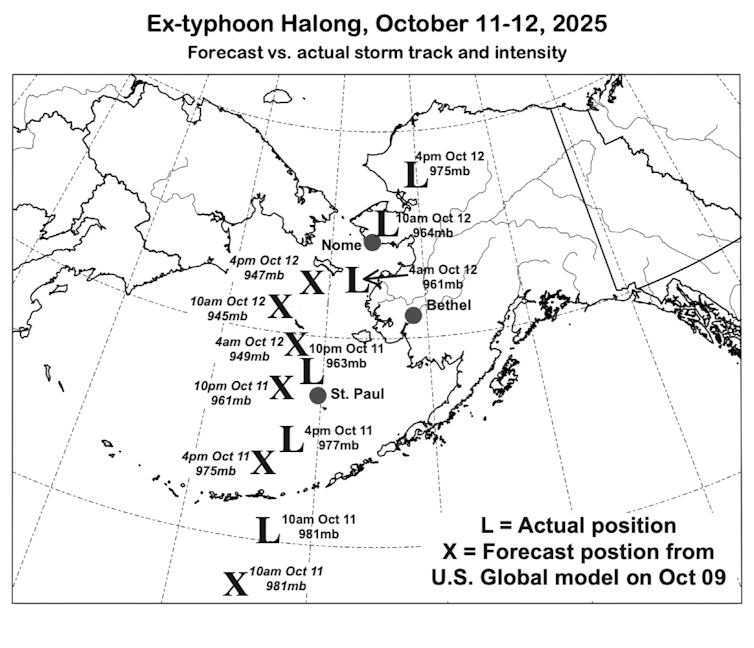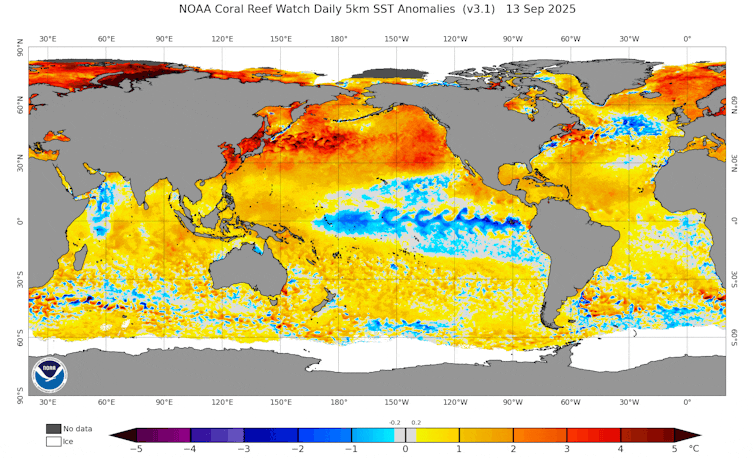Source: The Conversation – France in French (3) – By Pierre-Charles Pradier, Maître de conférences en Sciences économiques, LabEx RéFi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pour blanchir l’argent tiré de la vente de cocaïne, les trafiquants ont longtemps convoyé leurs recettes en utilisant des billets de 500 euros confiés à des « mules ». La surveillance accrue et la raréfaction des grosses coupures ont conduit les réseaux de blanchiment à payer les trafiquants de drogue en cryptomonnaies et à expédier les espèces sur des routes plus tranquilles, comme celles menant à Dubaï (Émirats arabes unis).
Le marché de la cocaïne a explosé entre 2014 et 2023. La production en Colombie a été multipliée par plus de sept pour atteindre, selon l’Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), près de 2 700 tonnes.
En coulisse, les trafiquants de drogue trouvent des moyens tout aussi illicites pour payer leurs fournisseurs, leurs petites mains ou pour dépenser le fruit de leur commerce criminel. La solution utilisée : le blanchiment d’argent. On estime que 25 % des montants collectés doivent être blanchis.
Trois phases sont généralement nécessaires dans le blanchiment : le placement dans le système financier, l’empilement (ou layering) avec le but de perdre la trace de l’origine des fonds et, enfin, l’intégration, où l’argent apparaît désormais légitime. Cette typologie ne permet pas de comprendre que le blanchiment est parfois partiel, c’est-à-dire qu’on s’arrête à la première étape. Considérons un exemple.
Prenons l’argent tiré de la cocaïne en provenance du principal exportateur de la coca : la Colombie. Une partie est intégralement blanchie sur place, en réinjectant l’argent liquide dans des commerces légitimes – restaurants, salons de coiffure, etc. –, tandis qu’une autre partie sert à payer la marchandise. Pour ce faire, il a longtemps suffi de fournir des espèces – en billets de banque –, dont le blanchiment s’achevait en Colombie.
Contrebande d’espèces
En Europe, elles sont changées en billets de 500 euros par des complices travaillant dans des banques puis confiées à des mules d’argent. Ces dernières prennent l’avion avec des sommes de 200 000 à 500 000 euros. Cette contrebande d’espèces en vrac (bulk cash smuggling) est le maillon de la chaîne du trafic de drogue ayant bénéficié à l’apparition des cryptomonnaies dans le trafic de drogue.
Pour bien comprendre l’emploi des cryptomonnaies dans le blanchiment de l’argent de la drogue, il faut expliciter les modalités de la contrebande d’espèces en vrac. Un article de Peter Reute et Melvin Soudijn (le premier est criminologue et le second officier de renseignement dans la police néerlandaise) a permis de mesurer précisément les coûts de cette opération. Ils ont accédé aux documents comptables des trafiquants dans six affaires jugées pour des faits qui se sont déroulés entre 2003 et 2008. Ils totalisent 800 millions d’euros transportés entre les Pays-Bas et la Colombie.
Les coûts représentaient environ 3 % pour le changement des petites coupures en billets de 500 euros, autant pour rémunérer la mule, un peu moins pour son voyage. La surveillance importante de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol obligeait à prendre l’avion ailleurs en Europe. Si on tient compte des frais annexes, le seul transport de fonds à destination de la Colombie coûtait entre 10 % et 15 %, voire jusqu’à 17 % des montants déplacés.
Concrètement :
-
La cocaïne part de Colombie.
-
Elle est vendue par des intermédiaires en Europe.
-
L’argent collecté de cette vente est changé en billets de 500 euros, moyennant 3 % de frais.
-
Les billets de 500 euros sont confiés à des mules, moyennant 3 % de frais.
-
Les mules voyagent vers la Colombie, moyennant 3 % de frais.
-
L’argent liquide arrive en Colombie pour payer la drogue, puis est blanchi sur place, avec encore des frais.
Pour les auteurs, la réglementation anti-blanchiment réussit à augmenter significativement les coûts de la contrebande, notamment le transport, mais pas le prix de vente, puisque le marché de la cocaïne augmente chaque année en France. En France, les prévalences de consommation ont été multipliées par neuf depuis 2000. Pour pallier ces réglementations, les trafiquants misent sur le billet de 500 euros.
Fin des billets de 500 euros
Rebondissement le 4 mai 2016 : la Banque centrale européenne (BCE) décide de cesser l’émission des billets de 500 euros. Le nombre de ces billets en circulation passe de 614 millions, fin 2015, à un peu moins de 220 millions au milieu de l’année 2025).
« Il a été décidé de mettre fin de façon permanente à la production du billet de 500 euros et de le retirer de la série “Europe”, tenant compte des préoccupations selon lesquelles cette coupure pourrait faciliter les activités illicites », souligne la Banque centrale européenne.
Cette même année, un nouvel actif financier entre en trombe : le bitcoin.
Apparition des cryptomonnaies
À partir de 2016, face à la raréfaction des billets de 500 euros, le bitcoin va contribuer à reconfigurer les routes du trafic d’espèces.
Au lieu d’une filière intégrée où les espèces reviennent à la source de la drogue pour payer les livraisons, on assiste à une spécialisation. D’un côté, les trafiquants de drogue échangent leurs espèces contre des cryptomonnaies qu’ils utilisent pour payer leur approvisionnement en Colombie. De l’autre, une filière de blanchiment récupère les billets et les fait voyager sur des routes plus faciles, comme celles menant à Dubaï (Émirats arabes unis).
Comment sait-on cela ? Par exemple, grâce à l’opération Destabilize de la National Crime Agency britannique. Le dossier de presse décrit un réseau international de blanchiment, contrôlé par des Russes. Ils utilisaient une plateforme d’échange n’exerçant pas son obligation de vigilance, Garantex, pour les opérations en cryptomonnaies, et Dubaï pour les opérations en espèces.
Le réseau de blanchiment récoltait les espèces des trafiquants de drogue et les payait en cryptojetons (notamment en USDT-Tether), moyennant 3 % de frais seulement. Par comparaison avec les 10 % à 15 % que coûtait le transport en Colombie avant la mise en extinction des billets de 500 euros, c’est une économie de 70 % à 80 %.
Cadre de déclaration des cryptoactifs
Les cryptomonnaies – d’abord le bitcoin et, désormais, les stablecoins comme l’USDT-Tether – ont permis aux trafiquants de drogue d’économiser leur marge sur l’envoi d’espèces en choisissant les routes les plus sûres. Il est trop tôt pour savoir si l’augmentation considérable du trafic de drogue transatlantique, attestée par une enquête récente du Financial Times, est liée à cette innovation technique.
Concrètement, la nouvelle méthode suit cette nouvelle route entre les trafiquants de drogue et les réseaux de blanchiment :
-
La cocaïne part de Colombie.
-
Elle est vendue par des intermédiaires en Europe.
-
L’argent collecté de cette vente est changé contre des cryptomonnaies USDT- Tether, moyennant 3 % de frais.
-
Les cryptomonnaies USDT-Tether sont envoyées en Colombie pour payer la drogue.
-
Pour le réseau de blanchiment, les espèces sont confiées à des mules, qui voyagent à Dubaï, moyennant 1 % de frais.
-
À Dubaï, les espèces sont blanchies, moyennant 1 % de frais.
Législation contre le blanchiment par cryptoactif
On peut penser que l’application des règles antiblanchiment aux prestataires de services liés aux cryptoactifs, dans les pays signataires du Crypto-Asset Reporting Framework_, va compliquer le jeu des organisations criminelles… qui sauront pourtant trouver les moindres failles et les exploiter.
L’invention des cryptomonnaies a fait perdre des années dans la lutte contre la criminalité organisée, mais la « coalition des volontaires », comme la Suisse, les Bahamas, Malte ou la France s’organise enfin.
En France, la lutte contre le blanchiment d’argent est renforcée par une loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic », promulguée en juin 2025. Un parquet national spécialisé est créé. Des mesures sont mises en place, de la fermeture administrative des commerces de façade (par les préfets plutôt que les maires trop exposés), le gel des avoirs des narcotrafiquants ou contre le mix de cryptoactifs.
Mais les trafiquants s’adaptent pour éviter d’être pris, c’est ce que nous verrons dans un second article.
![]()
A travaillé pour la Direction de la Surveillance du Territoire dans les années 1990.
– ref. Comment les trafiquants de cocaïne blanchissent l’argent des cartels – https://theconversation.com/comment-les-trafiquants-de-coca-ne-blanchissent-largent-des-cartels-265140