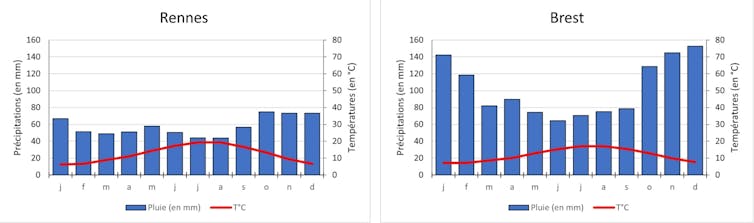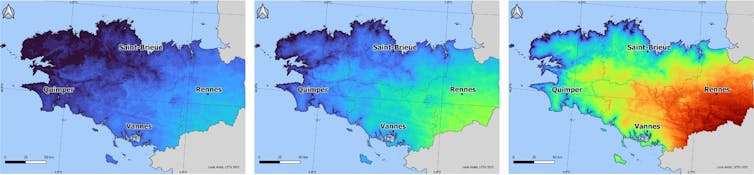Source: The Conversation – in French – By Armand Namekong Fokeng, Doctorant en biologie cellulaire et épidémiologie, Université de Corse Pascal-Paoli
Bien que les virus n’aient ni cerveau ni langage, leur circulation entre tiques, animaux et humains dans un environnement donné pourrait se lire comme un flux d’informations qui modifierait à jamais des comportements et qui façonnerait notre évolution.
La plupart des animaux ont un mode de communication évident : les cris d’alarme des suricates alertent au danger, les danses des abeilles signalent le nectar, les infrasons des éléphants permettent le maintien de la cohésion des groupes. Ainsi, c’est un nouveau message codé qui circule chaque fois et qui est ensuite interprété pour induire une action collective. Imaginez alors un instant, des virus qui parlent… pas un langage sonore ni gestuel, mais une conversation génétique, gravée dans des molécules (ADN, ARN) qui traversent les espèces en modifiant les corps.
Pour faire simple, un virus n’est qu’un morceau d’information génétique. Dénué de toute autonomie propre, il n’a de vie qu’à travers les cellules hôtes qu’il infecte. Le code génétique du virus est lu et exécuté comme un programme. En conséquence, la cellule cesse ses activités nobles (respiration, reproduction, réparation, etc.) et devient une usine à virus.
Cependant, le message viral n’est presque jamais stable. En effet, la fidélité est limitée dans la réplication des virus à ARN, tels que celui de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (CCHFV) sur lequel porte mon projet de thèse.
Chaque nouvelle infection draine avec elle une nuée de variants génétiques, appelés « quasi-espèces ». L’information virale est donc en perpétuelle réécriture pour s’adapter aux environnements et aux hôtes. Parfois, elle s’inscrit dans la mémoire profonde des organismes ayant été en contact avec le virus.
On sait, actuellement, qu’environ 8 % du génome humain provient de séquences virales anciennes parmi lesquelles certaines ont été intégrées à nos fonctions vitales. À titre d’exemple, la protéine syncytine, issue d’un rétrovirus, est indispensable à la formation du placenta chez les mammifères.
Les virus sont-ils toujours des intrus nuisibles ? Eh bien non ! Ils peuvent se présenter comme des créateurs invisibles de notre histoire génétique.
Une communication sans intention
Un virus est sans voix et ne choisit pas ses mots. Cependant, son interaction avec la cellule rappelle un échange de signaux.
En effet, dans le processus de l’infection, il doit reconnaître un récepteur spécifique sur la membrane de la cellule hôte : c’est la clé moléculaire qui lui ouvre la porte. Un exemple assez connu est celui du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) qui cible les lymphocytes T, en exploitant la très célèbre molécule CD4 à laquelle il se lie, et utilise les corécepteurs CCR5 ou CXCR4 pour infecter la cellule.
En réponse, l’organisme infecté met en place une véritable conversation immunitaire entretenue par de nombreux messagers chimiques : cytokines, interférons, fièvre, etc. Ces derniers modifient le comportement des cellules et, parfois, de l’individu lui-même.
À l’échelle sociale, l’infection induit des réactions telles que l’isolement, les soins, les nouvelles pratiques de prévention, etc. Ainsi, sans aucune intention, le virus modifie pourtant les relations collectives.
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo : un connecteur écologique
Le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est une parfaite illustration de cette logique. En effet, il circule dans un réseau où chaque espèce joue un rôle.
En ce sens, les tiques du genre Hyalomma sont à la fois vecteurs et réservoirs. Leur salive est riche en molécules immunomodulatrices, un cocktail de protéines ou de peptides (lipocalines, serpines, évasines, etc.) qui, en neutralisant les défenses immunitaires locales de l’hôte, préparent discrètement la transmission du virus.
Une fois infectés par les tiques, les mammifères domestiques (bovins, ovins, caprins), en tant qu’amplificateurs silencieux, hébergent le virus sans symptômes.
Chez l’humain, le scénario est différent. Ici, l’infection peut entraîner des fièvres hémorragiques potentiellement mortelles (de 10 % à 30 %) en cas d’apparition de symptômes. On estime de 10 000 à 15 000 cas environ, le nombre annuel de nouvelles infections à CCHFV. Ces dernières conduisent à environ 500 décès, soit une létalité moyenne globale d’environ 3-5 %.
En ce qui concerne la France, aucun cas humain symptomatique n’a été rapporté à ce jour. Cependant, des preuves d’une circulation virale dans le sang des animaux hôtes et dans les tiques vectrices prélevées dans ce pays ont été documentées. Bien qu’ayant un risque humain relativement faible pour le moment, la France est située au carrefour de plusieurs zones endémiques (la Turquie, les Balkans, l’Asie, l’Afrique).
À travers son cycle de transmission viral, le CCHV se présente comme un fil invisible qui relie tiques, animaux et humains. C’est un véritable message moléculaire qui circule, traverse les corps et remodèle les dynamiques écologiques et sociales.
Les devenirs d’un message viral
Il importe également de souligner qu’une fois dans la cellule, un virus a un destin riche en opportunités. Il peut ainsi être neutralisé par les défenses immunitaires ou se répliquer jusqu’à consumer entièrement son hôte.
Certains virus ont une présence latente et choisissent de rester silencieux ou endormis dans le génome ou le noyau. Cependant, dès que les conditions sont favorables (stress ou immunodépression), ils se réactivent et causent des dommages.
D’autres s’intègrent durablement dans le génome, modifiant ainsi la biologie de la cellule. Ainsi, ils peuvent dans certains cas activer des oncogènes et conduire à certains cancers, tels que celui du col de l’utérus pour le papillomavirus, ou simplement déclencher des dérèglements immunitaires qui débouchent sur l’expression de certaines maladies auto-immunes. Mais, dans certains cas, les virus passent inaperçus et disparaissent en silence.
La médecine, un nouvel interlocuteur moléculaire
Quand il faut barrer la voie aux virus, on s’attaque à leurs signaux moléculaires. Les antiviraux sont des brouilleurs de signal dans ce dialogue moléculaire.
Ainsi, certains empêchent l’entrée du virus, d’autres inhibent la copie de son génome : c’est le cas du favipiravir, par exemple, qui inhibe la polymérase des virus à ARN. Ce médicament est traditionnellement utilisé contre les pandémies grippales.
D’autres traitements agissent comme amplificateurs. C’est le cas des interférons, qui administrés comme médicament, renforcent l’expression des cellules et leur permettent d’alerter leurs voisines.
Ce jeu demeure toutefois dynamique. Face aux pressions thérapeutiques toujours plus nombreuses, les virus mutent en de nouveaux variants, enrichissant ainsi leur « vocabulaire moléculaire ». Le VIH en constitue un bel exemple ; en effet, il a rapidement développé des résistances aux premiers traitements en mutant. Ainsi, la médecine et la pharmacopée deviennent elles-mêmes des acteurs involontaires de cette conversation évolutive.
Et si l’on élargissait notre vision de la vie, en classant les virus parmi les acteurs de la communication ? Ainsi, la communication ne se limiterait plus seulement aux cris des animaux et aux paroles ou gestes d’humains. Elle pourrait également être inscrite dans la circulation d’informations génétiques entre les espèces.
De ce fait, les virus cesseraient d’être uniquement des ennemis pour devenir aussi, et surtout, des agents de mise en réseau, qui relient les tiques, les animaux et les humains. Ce faisant, ils laisseraient des traces dans nos génomes et modifieraient nos comportements sociaux en cas d’épidémie.
Vue sous cet angle, chaque infection virale deviendrait une conversation biologique, un échange franc où virus, cellules et écosystèmes négocieraient chacun leur position. De la simple chorégraphie d’une abeille au passage d’un virus dans un troupeau, le vivant deviendrait une immense polyphonie de messages.
Loin d’être un simple agent pathogène, le virus apparaît comme une voix invisible de la grande conversation du vivant.
Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.
![]()
Armand Namekong Fokeng ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Les virus, ces messagers invisibles de la conversation du vivant – https://theconversation.com/les-virus-ces-messagers-invisibles-de-la-conversation-du-vivant-266937