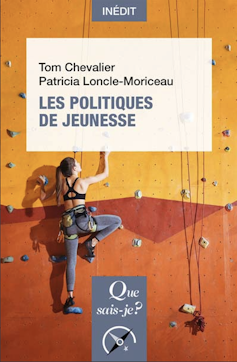Source: The Conversation – in French – By Jérôme Harmand, Directeur de Recherche, Inrae
Le plan Eau de la France vise 10 % de réutilisation des eaux usées traitées à horizon 2030. Comment y parvenir sans augmenter la quantité d’eau consommée au total – c’est-à-dire, sans risquer un effet rebond ? Panorama des bonnes pratiques identifiées par la recherche scientifique.
En France, le plan Eau annoncé par le président de la République en 2023 affichait un objectif de développement de 1 000 projets de réutilisation des « eaux non conventionnelles (ENC) » en 2027. Il s’agit d’un objectif intermédiaire avant de viser 10 % de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) à horizon 2030.
S’il est poursuivi sans suffisamment de discernement, cet objectif quantitatif national pourrait conduire à une maladaptation et à des projets inadéquats. Par exemple, à des projets qui auraient pour conséquence d’augmenter la quantité globale d’eau consommée à la faveur de l’« effet rebond ». Le risque serait de présenter la REUT comme une nouvelle ressource, alors même que cette eau remobilisée est susceptible de manquer aux milieux naturels.
Pourtant, l’état de l’art scientifique et l’analyse des retours d’expériences internationaux confirment l’intérêt du réusage de l’eau pour répondre à des situations de fortes tensions. Ces mêmes expériences démontrent aussi que les projets sont fortement conditionnés par les contraintes locales.
Autrement dit, leur réussite va dépendre de l’implication des acteurs, de l’adéquation entre la qualité de l’eau requise et le niveau de technologie des traitements, de la viabilité économique des projets, etc.
Les eaux usées, une ressource plutôt qu’un déchet
Pour aider nos sociétés à s’adapter au changement climatique et préserver notre environnement, une gestion maîtrisée et responsable de l’eau est essentielle, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Il s’agit d’un enjeu stratégique pour assurer des conditions de vie soutenables à tous.
Cela passe notamment par la sobriété et l’optimisation des usages et le partage de la ressource. Surtout, il ne faut pas oublier de prendre en compte de l’état des milieux aquatiques. Par exemple, en considérant le rôle environnemental des eaux usées traitées dans le maintien des débits d’étiage pendant les périodes de sécheresse.
Dans ce contexte, les eaux usées ne doivent plus être considérées comme un déchet à traiter et évacuer, mais comme une ressource. Ces eaux peuvent par exemple être riches en fertilisants utiles aux cultures agricoles. Dans une logique d’économie circulaire, on peut les considérer comme des flux de valeur, en fonction des spécificités territoriales (adéquation entre les besoins des cultures et l’eau disponible, proximité des usages…).
Les eaux usées domestiques constituent la principale ressource pouvant être mobilisée. Il est toutefois nécessaire d’élargir le concept d’économie circulaire de l’eau à l’ensemble des eaux non conventionnelles. Par exemple, les eaux de pluie, eaux de piscine ou encore les eaux évacuées du sous-sol pour permettre l’exploitation d’ouvrages enterrés tels les métros, tunnels ou parkings… Ceci permet d’équilibrer au mieux les usages et les prélèvements à l’échelle d’un territoire.
Boucler le « petit » et le « grand » cycle de l’eau
Pour faire face aux tensions sur la ressource, il nous faut donc inventer de nouvelles approches. L’enjeu est de repenser son utilisation tout au long des chaînes de valeur. Pour cela, on peut imaginer des usages en boucles (réusage après un usage précédent), là où ils étaient jusqu’à maintenant linéaires (mobilisation, utilisation, rejet).
Il s’agit de concevoir une gestion de l’eau plus intégrée à l’échelle d’un territoire, qui va contraindre ressources et besoins. L’objectif est que le cycle d’usage perturbe le moins possible le « grand » cycle (ou cycle naturel) de l’eau, aussi bien quantitativement que qualitativement.
Le contexte agricole, urbain ou industriel a également son importance. Il impose d’examiner les risques environnementaux et sanitaires. En effet, il s’agit de modifier le cycle de l’eau. La mise en place de solutions favorisant des cycles courts peut impacter les milieux et les populations à des degrés divers. C’est particulièrement vrai en périodes de sécheresse sévère.
Par exemple, la qualité microbiologique de l’eau peut poser question dans les situations de réutilisation indirecte. Dans ce cas, l’eau n’est pas prélevée directement en sortie de station (où elle serait alors soumise à des normes de qualité afin d’être réutilisée), mais en aval, dans le cours d’eau dans lequel la sortie de station s’est déversée. Ce type de prélèvement n’est réglementairement conditionné qu’à des contraintes quantitatives, et non plus qualitatives.
Quels sont les projets qui aboutissent ?
L’état de l’art scientifique et l’analyse des retours d’expériences internationaux sont utiles pour identifier les facteurs de réussite de ces projets.
Ils tirent tout d’abord parti d’un contexte géographique favorable. Par exemple, lorsque la distance entre les gisements et les usages potentiels est raisonnable ou que des aménagements hydrauliques existent déjà.
Ils organisent aussi la concertation des diverses parties prenantes concernées (gestionnaires, agriculteurs, consommateurs, financeurs…). L’enjeu est de les impliquer dans la gouvernance pour permettre de mieux aligner leurs intérêts respectifs.
Ils mettent également en place un plan de maîtrise des risques sanitaires et environnementaux, par exemple en adoptant une approche multibarrière.
Ces projets gagneraient à s’inscrire dans un cadre réglementaire et normatif clair et harmonisé, à une échelle dépassant le cadre national afin de tirer parti des retours d’expériences internationaux. À l’exception de la réutilisation à usage agricole, la réglementation sur les eaux usées pourrait être améliorée pour être mieux calibrée, plus cohérente, moins complexe et davantage inscrite dans la durée.
Enfin, ces projets doivent mobiliser des modèles économiques équilibrés entre les parties prenantes productrices et bénéficiaires. Ils devraient reposer sur une analyse au cas par cas de la rentabilité des infrastructures, dont le financement et l’exploitation croisent souvent acteurs privés et publics.
Les bonnes pratiques à adopter
Pour favoriser le succès des projets de REUT, il faut d’abord faire de la gestion responsable de l’eau une priorité dans chaque pays du monde. Cela implique d’inscrire dans la loi des instruments réglementaires de politique environnementale le permettant, sans alourdir et complexifier les cadres actuels.
Cela passe également par la promotion de mesures préalables. Notamment la sobriété, l’optimisation et le recyclage in situ des eaux lors de la conception puis l’exploitation de nouvelles d’infrastructures. Pour minimiser les impacts anthropiques de l’homme sur le cycle naturel de l’eau, il vaut mieux réutiliser un mètre cube d’eaux usées plutôt que de le puiser dans le milieu naturel.
Il convient d’intégrer dans l’analyse de rentabilité du projet, ses impacts et bénéfices sanitaires, sociaux et environnementaux sur l’ensemble de son cycle de vie, ainsi que le coût de renoncement global.
On pourrait également intégrer le recyclage de l’eau prélevée dans tous les schémas directeurs de l’aménagement et de gestion des eaux. La REUT peut ainsi être intégrée aux projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE).
C’est à cette condition que l’on peut concevoir et planifier une réutilisation multiressource et multiusage (lorsqu’elle est possible et pertinente) des eaux usées. Cela permet de substituer la REUT à d’autres prélèvements sur le milieu ou à l’utilisation d’eau potable. Pour cela il faut prendre en compte de façon systématique les enjeux de restauration et de préservation des ressources et des écosystèmes
Cela nécessite également de repenser les appels d’offres et contrats de délégation de service public. Il faudrait tenir compte de la raison d’être et des fonctions diverses des stations de traitement des eaux usées, et élargir leur rôle de « stations d’épuration » à celui de véritables usines de valorisation, lorsque c’est pertinent.
Au-delà de la récupération de l’eau, on peut y prélever des nutriments, comme l’azote ou le phosphore, ou encore produire de la chaleur. Mais, pour que cela possible, il convient d’adapter en conséquence les instruments fiscaux, les modalités de tarification et plus largement les modèles économiques.
Renforcer le soutien financier à la recherche sur cette question est crucial. À diverses échelles, on peut par exemple citer le Défi Clé Water Occitanie (WOc), le projet REUTOSUD, le programme de financement Water4All ou encore le réseau européen de recherche Water4Reuse.
Cela passe aussi par la création et l’animation de structures de sensibilisation, d’échange de connaissances et de concertation. Celles-ci doivent impliquer les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux aux côtés des autres parties prenantes. Ces dispositifs de recherche-action interdisciplinaire, appelés « Living Labs », sont ancrés dans les territoires et à l’interface science-politique-société. À l’image des Living Labs, mis en place dans le cadre du WOc déjà mentionné, ils doivent faciliter la conception d’outils, de services ou d’usages nouveaux autour du recyclage de l’eau.
Enfin, il convient de favoriser l’acculturation de toute la chaîne technique et administrative. Ceci passe par la formation initiale et continue des professionnels, des bureaux d’études, des élus et des fonctionnaires centraux et territoriaux. Ceci permettra une mise en œuvre plus aisée de ces nouvelles approches de gestion de l’eau, au service d’une économie circulaire de l’eau.
Les personnes suivantes ont collaboré à cet article, par ordre alphabétique :
Nassim Ait-Mouheb (Inrae ; Eau, Agriculture et Territoires), Claire Albasi (Université de Toulouse, Défi Clé Water Occitanie), Christophe Audouin (Suez), Gilles Belaud (Chaire EACC ; Eau, Agriculture et Territoires), Sami Bouarfa (Inrae ; Eau, Agriculture et Territoires), Frédéric Bouin (Université de Perpignan Via Domitia, UPVD), Pierre Compère (Explicite Conseil), Ehssan El Meknassi (Costea), Jérôme Harmand (Inrae ; Eau, Agriculture et Territoires), Marc Heran (Institut européen des membranes, Chaire SIMEV), Barbara Howes (SCP), Marie-Christine Huau (Veolia, Direction du Développement Eau), Vincent Kulesza (SCP ; Eau, Agriculture et Territoires), Rémi Lombard-Latune (Inrae ; EPNAC ; Groupe de travail national Eaux non conventionnelles), Alain Meyssonnier (Institut méditerranéen de l’eau), Bruno Molle (EIA/Inrae), Simon Olivier (Pôle de compétitivité Aqua-Valley), Carmela Orea (Eau, Agriculture et Territoires), Céline Papin (Eau, Agriculture et Territoires), Nicolas Roche (Aix-Marseille Université/University Mohammed VI Polytechnic, Eau, Agriculture et Territoires), Stéphane Ruy (Inrae, Institut Carnot), Pierre Savey (BRL ; Eau, Agriculture et Territoires) et Salomé Schneider (Chaire EACC).

Jérôme Harmand a reçu des financements de la Région Occitanie dans le cadre du financement du projet WOc WoD visant à étudier le traitement des eaux usées brutes pour les réutiliser. Il anime le réseau REUSE d’INRAE au niveau national et porte l’action COST CA23104 “Mainstreaming water reuse into the circular economy paradigm (Water4Reuse)”.
– ref. Comment favoriser la réutilisation des eaux usées traitées en France ? – https://theconversation.com/comment-favoriser-la-reutilisation-des-eaux-usees-traitees-en-france-257141

![]()