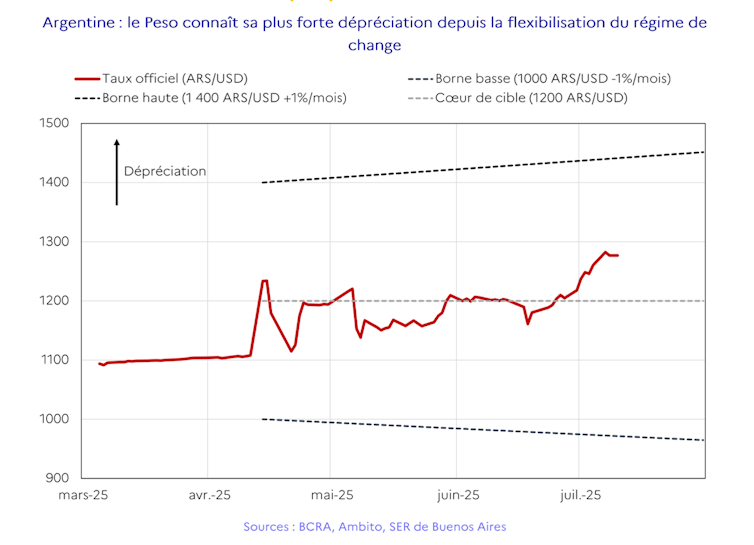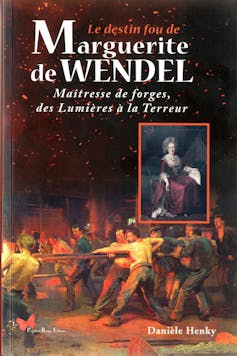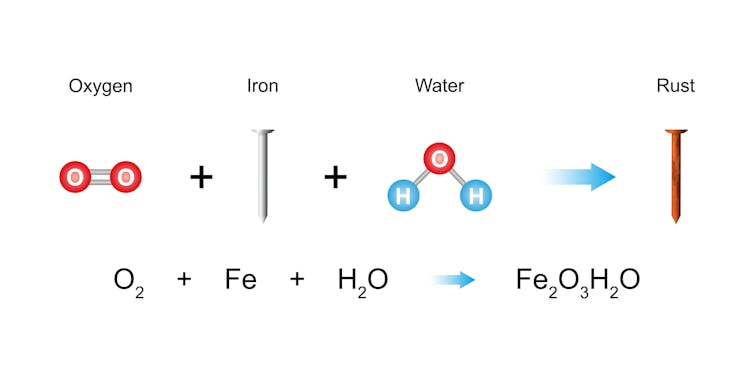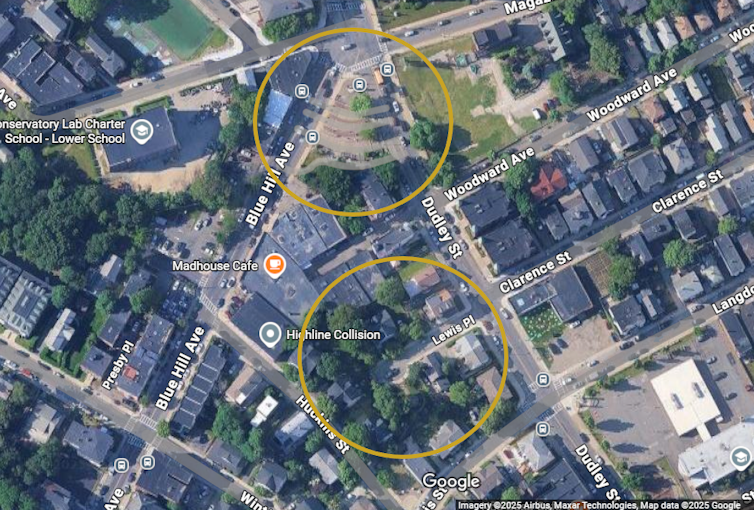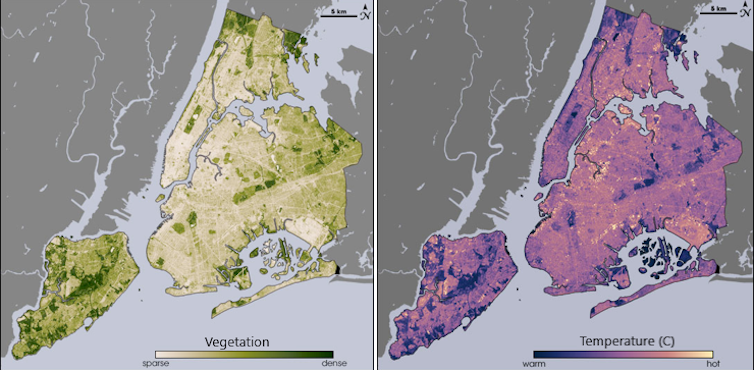Source: The Conversation – in French – By Attoumane ARTADJI, Géographe de la santé et Ingénieur de Recherche en Sciences de l’Information Géographique au LPED, AMU, IRD, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Depuis vingt ans, une lutte intensive est engagée contre le paludisme aux Comores, en Afrique australe. À terme, l’élimination de cette maladie dans ce pays n’est pas un rêve impossible, mais cet objectif demeure encore lointain. On fait le point sur la stratégie dite de « traitement de masse » mise en œuvre sur l’archipel, ses succès et ses limites.
Le 25 avril 2025, l’Union des Comores a célébré, comme le reste du monde, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ce pays de moins de 900 000 habitants s’est engagé depuis 20 ans dans une course à l’élimination du paludisme, dont il convient de retracer l’évolution.
Sur les trois îles (Grande Comore, Mohéli et Anjouan) de l’archipel des Comores, situé au sud-est du canal du Mozambique, entre le Mozambique et Madagascar, des efforts de contrôle considérables ont permis une spectaculaire « diminution de 97 % des cas de paludisme entre 2010 et 2016 » (passant de plus de 103 600 en 2010 à moins de 1 500 en 2016).
Une stratégie dite de « traitement de masse »
Ces efforts ont porté sur des distributions massives de moustiquaires imprégnées d’insecticides puis sur des campagnes de traitement de masse (TDM) par des médicaments proposés par la Chine : l’Artequick (qui est une combinaison d’artemisinine et de piperaquine) associé à la primaquine. Le paludisme a ainsi été quasiment éliminé à Mohéli et à Anjouan, mais est resté présent à la Grande Comore à des proportions faibles par rapport à 2010, laissant espérer son élimination définitive.
Malheureusement, le miracle de ce traitement de masse n’a pas suffi et le nombre de cas de paludisme n’a cessé d’augmenter depuis 2017, pour atteindre 21 079 en 2023, soit une augmentation de 87 %. Son élimination est-elle encore possible ?
Le succès de l’expérimentation à ciel ouvert de Mohéli
En novembre 2007, le programme « Fast Elimination of Malaria by Source Eradication » (FEMSE) a été lancé à Mohéli. Il s’agissait d’une campagne expérimentale visant à éliminer les parasites du paludisme (Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax et Plasmodium ovale) dans le sang des habitants de cette île dont la population a été estimée à moins de 40 000 personnes (d’après des chiffres de 2007). Mohéli est ainsi devenue un laboratoire à ciel ouvert pour l’expérimentation du traitement de masse du paludisme.
Ce programme était dirigé par des experts de l’université de médecine traditionnelle chinoise de Guangzhou (Canton), accompagnés par des équipes du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP-Comores).
Concrètement, une bulle sanitaire a été mise en place dans toute l’île pour distribuer à tous les résidents, malades ou non, un traitement d’Artequick (composé d’artémisinine et de piperaquine) ainsi que de la primaquine. Ce traitement a également été imposé à tous les visiteurs de l’île pendant trois ans. La finalité de ce programme était d’éliminer le réservoir de parasites pour interrompre la chaîne de transmission entre l’humain et les moustiques vecteurs (Anopheles gambiae et Anopheles funestus) en moins de deux ans.
En moins de six mois, à Mohéli, une réduction de 98 % de la charge parasitaire a été constatée chez les enfants. Un recul spectaculaire de la charge parasitaire chez les anophèles, les moustiques responsables de la transmission du paludisme, a également été observé.
Le traitement de masse élargi à toutes les Comores
Les résultats concluants de l’expérimentation de Mohéli ont convaincu les autorités comoriennes et leurs partenaires d’élargir le traitement de masse aux deux autres îles, Anjouan en 2012 et la Grande Comore en 2013. Plus de 80 % de la population des deux îles a pris ce traitement. Parallèlement, la campagne de distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILD) a connu le même succès.
Mais cette joie a été de courte durée. En effet, une recrudescence de l’incidence du paludisme a été observée dès 2017, avec plus de 500 cas pour 100 000 habitants. En 2023, ce sont plus de 2 400 cas pour 100 000 habitants qui ont été recensés, soit 12 fois plus qu’en 2016.
Cette résurgence du paludisme a suscité l’inquiétude des autorités comoriennes et de leurs partenaires.
Un effet de résistance aux médicaments ?
En réponse à cette crise, dès 2018, plusieurs campagnes de traitement de masse ont été réalisées à la Grande Comore dans des zones géographiques ciblées. La dernière en date a été réalisée en décembre 2024 dans la région de Hamahamet-Mboinkou, à Moroni, et dans bien d’autres régions de l’île.
Combien faudra-t-il encore de traitement de masse pour mettre fin à la transmission du paludisme aux Comores ? La multiplication de ces traitements de masse à la Grande Comore sans réelle efficacité, contrairement à ce qui fut observé lors des campagnes de 2007 à Mohéli ou à Anjouan en 2012, suscite de nombreuses inquiétudes. Peut-on avancer l’hypothèse de résistances à l’Artequick ?
La littérature scientifique confirme que certaines mutations observées dans les gènes du P. falciparum entraînent, dans certains pays d’Afrique, une résistance aux deux molécules contenues dans l’Artequick, c’est-à-dire l’artémisinine et la pipéraquine.
Or, les études évaluant la résistance aux médicaments antipaludiques aux Comores sont peu nombreuses. La dernière étude, réalisée entre 2013 et 2014 par les mêmes équipes ayant conduit le traitement de masse, a montré qu’aucune forme de résistance n’avait été observée à la Grande Comore. Depuis, ce constat serait-il encore le même ? Comment expliquer alors cet échec ?
La population pointée du doigt par les autorités sanitaires ?
D’après les déclarations des autorités sanitaires publiées dans les journaux, la Grande Comore « empêcherait » l’élimination du paludisme en Union des Comores. Les habitants de cette l’île seraient « méfiants » à l’égard de la prise de médicaments et « moins adhérents » aux efforts de lutte, ce qui a entraîné un faible taux de couverture des traitements de masse par rapport au reste des îles.
Aussi, la population « refuserait » d’utiliser les moustiquaires. Selon elles, la population devrait plutôt « coopérer » davantage, car l’élimination du paludisme nécessite un « engagement national ». Mais la population serait-elle l’unique coupable ?
Quelle place, à côté du nouveau vaccin antipaludique ?
Peut-on envisager une alternative au traitement de masse aux Comores ? Dès le début de l’année 2024, plusieurs pays d’Afrique ont introduit, dans leur programme de lutte contre le paludisme, le vaccin antipaludique RTS,S de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est le cas notamment du Cameroun, du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d’Ivoire, pour n’en citer que quelques-uns.
Interrogées sur la possibilité d’intégrer ce vaccin aux Comores, les autorités ont déclaré ce qui suit :
« Cela ne veut pas dire qu’on est contre la vaccination, mais nous préférons poursuivre la stratégie nationale déjà conçue avec la mission chinoise à travers la sensibilisation, le traitement de masse et la distribution de moustiquaires imprégnées ». La stratégie du traitement de masse va donc se poursuivre.
Lutte contre le paludisme : un financement compromis sous l’ère Trump ?
Outre le soutien de la Chine, l’Union des Comores bénéficie de financements de partenaires internationaux pour la lutte contre le paludisme. Il s’agit principalement du Fonds mondial et de l’OMS, des institutions largement soutenues financièrement par les États-Unis. Or, la rétractation de l’administration Trump risque de mettre en péril la lutte contre le paludisme aux Comores.
À lire aussi :
Comment le gel de l’USAID menace la surveillance sanitaire mondiale
En effet, le diagnostic et le traitement gratuits des patients dans les structures de soins, la distribution de moustiquaires dans les villages et la collecte de données épidémiologiques dans les districts sanitaires en sont dépendants. Avec un financement réduit, un retour à un nombre important de cas menace les Comores.
Cette résurgence du paludisme démontre les limites de la stratégie du traitement de masse imposée à une population qui la déboute depuis un certain temps.
Alors, sans stratégie alternative de lutte et sans autres sources de financement, le rêve d’un « avenir sans paludisme en Union des Comores à l’horizon 2027 » semble compromis et prolongé pour une période encore indéterminée.
![]()
Attoumane Artadji a bénéficié d’une Allocation de Recherche pour une Thèse au Sud (ARTS, 2015 à 2017) de l’IRD et a été financé en 2016 par le Fonds de coopération régionale via la préfecture de La Réunion pour mener des enquêtes de terrain dans le cadre du projet « GeoH2O-Comores, enquête sur l’eau et la santé dans l’Union des Comores ».
Vincent Herbreteau a coordonné le projet « GeoH2O-Comores, enquête eau et santé dans l’Union des Comores » financé en 2016 par le Fonds de Coopération Régionale via la Préfecture de La Réunion.
– ref. Résurgence du paludisme aux Comores : où en est-on de son élimination ? – https://theconversation.com/resurgence-du-paludisme-aux-comores-ou-en-est-on-de-son-elimination-259965