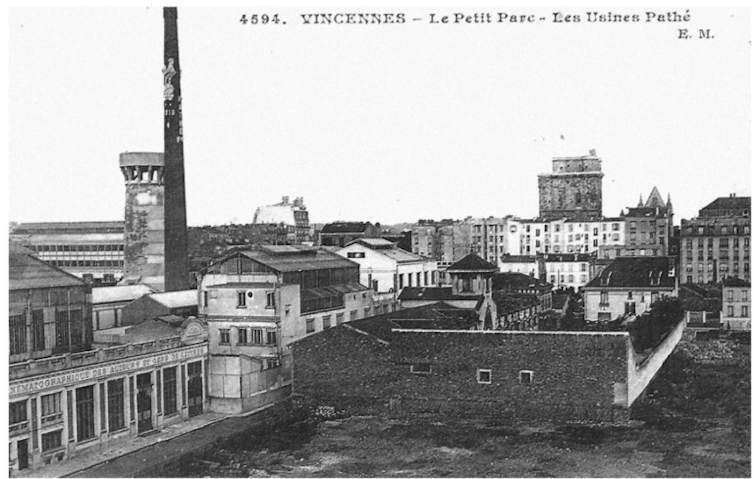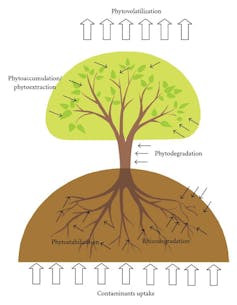Source: The Conversation – in French – By Christian Abadioko Sambou, Dr en Sciences Politiques, spécialiste en paix & sécurité, Université Numérique Cheikh Hamidou Kane
Depuis les luttes d’indépendance, la souveraineté occupe une place centrale dans les débats politiques africains. Elle renvoie à la conquête de l’autonomie, la quête de légitimité et la capacité des États à définir librement leur destin. Cette quête est continue et en lien profond avec l’histoire coloniale des Etats ouest-africains.
L’émergence de l’Alliance des États du Sahel (AES) – Mali, Burkina Faso et Niger– en septembre 2023, a ravivé ces débats ? plaçant au coeur des discussions les notions de souveraineté, de panafricanisme, de démocratie, alimentant les discussions à travers les médias classiques et sociaux. La souveraineté est ainsi devenue un marqueur idéologique structurant, cristallisant des oppositions entre des « pro-0ccident » vs « pro-bloc sino-russe ».
Cette recomposition se manifeste à travers deux dynamiques distinctes: d’un côté, l’AES qui prône une souveraineté de rupture, articulée autour de la sécurité, de la dignité nationale et du rejet des tutelles extérieures ; de l’autre, des démocraties consolidées comme le Sénégal, le Cap-Vert, le Bénin et le Ghana, qui défendent une posture fondée sur la légitimité électorale, la coopération régionale et l’ouverture internationale dans une égale dignité, comme fondement de leur souveraineté internationale.
Pour avoir étudié les régimes politiques et les questions de gouvernance en Afrique de l’Ouest, j’ai observé que là où les régimes militaires du Sahel central revendiquent une souveraineté défensive, parfois exclusive, les États démocratiques côtiers manifestent une autonomie de décision politique basée sur une tradition d’ouverture internationale.
Dès lors, une question s’impose : quels facteurs expliquent la divergence entre ces deux conceptions de la souveraineté en Afrique de l’Ouest, et que révèlent-elles des transformations actuelles de l’État postcolonial africain ?
Deux conceptions de la souveraineté
L’usage contemporain de la souveraineté en Afrique de l’Ouest renvoie moins à une définition juridique univoque qu’à deux idéaux-types de gouvernement, construits à partir de trajectoires politiques contrastées.
La souveraineté de rupture : l’Alliance des États du Sahel
Le premier idéal-type est celui d’une souveraineté de rupture, incarnée par l’Alliance des Etats du Sahel (AES), née de la Charte du Liptako-Gourma en septembre 2023. Dans ce modèle, la souveraineté cesse d’être exclusivement nationale pour prendre une forme régionalisée, articulée autour d’une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle (article 2 de la Charte). Elle est pensée comme une capacité à protéger, à combattre le terrorisme et la criminalité en bande organisée (article 4 de la Charte).
Trois piliers structurent cette souveraineté. D’abord, la sécurité comme fondement premier de l’État : l’autorité souveraine se légitime par la lutte contre le terrorisme et la reconquête territoriale. Ensuite, un discours panafricaniste de rupture, qui présente la souveraineté comme émancipation vis-à-vis des puissances occidentales et des institutions régionales jugées dépendantes.
Enfin, la volonté de reconstruire un État fort et centralisé, où l’armée devient l’acteur principal de la refondation nationale et du contrôle des ressources stratégiques. La souveraineté y est défensive, symbolique et identitaire, indissociable de la dignité nationale et de la survie de l’État.
Plus que la lutte contre le terrorisme, l’objectif de l’alliance est fondamentalement politique et souverainiste. A ce propos, le président de transition du Mali Assimi Goïta dans son discours à la nation du 31 décembre 2025, déclarait :
L’année qui s’achève a consacré une avancée majeure dans notre combat pour la souveraineté avec la consolidation de l’Alliance des États du Sahel. Avec le Burkina Faso et le Niger, nous avons choisi l’unité, la solidarité et la défense collective comme réponses aux défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels nos peuples sont confrontés.
La souveraineté de consolidation : les démocraties côtières stabilisées
À l’opposé, le second idéal-type est celui d’une souveraineté de consolidation, portée par des États côtiers comme le Sénégal, le Cap-Vert, le Bénin ou le Ghana. Ici, la souveraineté repose sur la légitimité électorale, la stabilité institutionnelle et la continuité de l’État de droit. Elle ne s’exerce pas contre l’ordre régional, mais à travers lui. Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye déclarait lors de son discours d’investiture le 2 avril 2024 que
le Sénégal doit exercer pleinement sa souveraineté, dans le respect de ses engagements internationaux, mais en plaçant en priorité les intérêts du peuple sénégalais.
Ces États conçoivent la souveraineté comme une capacité d’action collective, fondée sur la coopération, l’intégration régionale et le multilatéralisme, notamment au sein de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao). La souveraineté n’y est pas synonyme d’isolement, mais d’influence partagée et de consolidation progressive de l’État.
Cinq points de divergence
Ces deux modèles se distinguent à travers cinq indicateurs.
– La centralité de la force armée
La souveraineté est pratique et se mesure à la capacité des armées à protéger, à sécuriser des territoires, à administrer, à user et imposer la force. Dans l’espace AES, la souveraineté est associée à la puissance militaire. Ainsi le militaire est partout comme instrument de coercition et au cœur du pouvoir politique. La sanctuarisation de l’état d’urgence, la médiatisation des succès militaires, la rhétorique de la guerre et la mise en scène d’un Etat protecteur participent à l’entretien de cette souveraineté militaire défensive.
En contraste, dans les démocraties côtières, la souveraineté repose moins sur l’omniprésence du militaire que sur la primauté de l’Etat de droit. La sécurité est une politique publique soumise au contrôle civil parlementaire. Toutefois au regard du contexte régional, l’insécurité constitue un défi et justifie un renforcement des capacités étatiques et une attention aux armées.
– Les fondements de la légitimité politique
La distinction entre les deux modèles est forte autour de cet indicateur. Dans les régimes de l’AES la légitimité n’est pas fondée par les urnes. Les transitions sont prolongées et perdent leur sens. L’insécurité fragilise les institutions. Le pouvoir repose sur la force populaire, pas sur les urnes. Les dirigeants cherchent légitimité par la rue plutôt que par la démocratie.
Dans les États dits démocraties stabilisées, la souveraineté est indissociable de la légitimité électorale.Les citoyens refusent tout report ou blocage des élections. Pourtant, dans certains pays, l’exclusion des principaux opposants dévoie la compétition électorale.
Dans les deux modèles la souveraineté cherche à s’ancrer dans une forme de reconnaissance populaire, mais par des mécanismes radicalement différents.
– Sécurité et droits
Pour les régimes militaires, la sécurité est une priorité absolue. Elle justifie ainsi la suspension ou la relativisation de droits et libertés. Au nom d’un état d’urgence, la lutte contre le terrorisme et la survie de l’Etat priment sur les garanties individuelles.
A l’inverse dans les souverainismes démocratiques, la sécurité est liée aux droits, à la justice, à la gouvernance inclusive. La souveraineté elle-même repose sur un cadre juridique.
– Place des oppositions et des contre-pouvoirs
La conséquence du tout sécuritaire dans l’espace AES est la remise en cause de la place centrale des oppositions politiques, des contre-pouvoirs dans la gouvernance politique. Les droits et libertés sont largement restreints. Les oppositions politiques sont écartées et la presse encadrée.
Les régimes militaires protègent leur légitimité face aux menaces internes.
Dans les souverainismes démocratiques, le pluralisme et les libertés garantissent la légitimité de l’État.
– Rapport à l’international et à l’intégration régionale
Enfin les régimes de l’AES défendent une souveraineté de rupture vis-à-vis des institutions régionales et des partenaires occidentaux, accusés d’ingérence. Cette posture ne signifie pas l’autarcie : elle s’accompagne d’alliances alternatives (Russie, Chine) et d’une affirmation d’idéologie panafricaine parfois présentée en modèle sahélien.
Les démocraties côtières assument une souveraineté coopérative, fondée sur le multilatéralisme, la Cedeao, l’intégration régionale. La souveraineté ici n’est pas exclusive ou contre l’international mais à travers lui.
Les facteurs de la divergence
Les divergences s’enracinent dans des contextes historiques, politiques et économiques profondément asymétriques.
– Un contexte sécuritaire asymétrique
Le premier facteur explicatif tient à la géographie différenciée de la violence armée. Le Sahel central est devenu l’épicentre de l’insécurité depuis 2010.
L’expansion des groupes djihadistes et la porosité des frontières ont affaibli l’autorité étatique. La souveraineté devient une urgence existentielle face à cette crise. La militarisation du pouvoir s’impose comme réponse pour préserver l’unité et la survie de l’État.
À l’inverse, les États côtiers comme le Sénégal ou le Ghana n’ont pas connu une telle intensité de violence armée. Cette relative stabilité sécuritaire a permis la continuité institutionnelle, la consolidation de l’État de droit et une souveraineté pensée dans la durée plutôt que dans l’urgence.
– Dynamiques politiques et crise différenciée de la légitimité démocratique
Le second facteur est politique. Dans l’espace AES, la montée des régimes de transition reflète une crise électorale. Les coups d’État et la perte de confiance expliquent le recul de la démocratie. Cette « fatigue démocratique » nourrit un souverainisme sahélien. Le peuple devient source directe du pouvoir, par la rue et le soutien populaire.
À l’inverse, dans les démocraties côtières, les alternances régulières consolident la confiance. La souveraineté y reste liée au suffrage et au respect des procédures.
– Des économies politiques contrastées
Les structures économiques jouent un rôle clé. Les pays enclavés du Sahel dépendent d’économies agro-extractives fragiles. Les conflits ont désorganisé la production et affaibli l’État. Cela renforce la tentation d’un pouvoir autoritaire centré sur les ressources.
De leur côté, les États côtiers, plus diversifiés et ouverts, privilégient la stabilité et l’intégration économique régionale.
– Reconfigurations géopolitiques et rapports à l’international
Enfin, les divergences tiennent à de profondes recompositions géopolitiques. Au Sahel, le retrait occidental et la rupture avec la Cedeao ont favorisé une souveraineté de défiance. Les régimes militaires recherchent des alliances alternatives. La souveraineté y devient protection et affirmation identitaire.
À l’opposé, le Sénégal et le Ghana privilégient, eux, une souveraineté coopérative.
Ils s’inscrivent dans le multilatéralisme, tout en redéfinissant certains partenariats, notamment militaires. Au Sénégal, les autorités, tout en privilégiant des relations coopératives, ont remis en cause des accords de défense avec la France et rendu effectif le retrait des armées françaises du sol sénégalais.
Que retenir ?
Les deux modèles de souveraineté qui coexistent aujourd’hui en Afrique de l’Ouest ne sont pas des anomalies, mais les expressions d’une même quête d’autonomie dans des contextes différenciés.
Le souverainisme de rupture de l’AES répond à une crise de survie étatique, tandis que celui du Sénégal, du Ghana, du Cap-Vert, du Bénin, repose sur la stabilité institutionnelle et cherche à consolider une autonomie de décision à travers les institutions démocratiques.
Ces trajectoires traduisent deux manières d’adapter la souveraineté africaine au monde contemporain : l’une par la résistance et le refoulement de la tutelle occidentale, l’autre par l’intégration régionale politique et éconnomique.

Christian Abadioko Sambou does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
– ref. En Afrique de l’Ouest, deux modèles de souveraineté face à face – https://theconversation.com/en-afrique-de-louest-deux-modeles-de-souverainete-face-a-face-273188


![]()