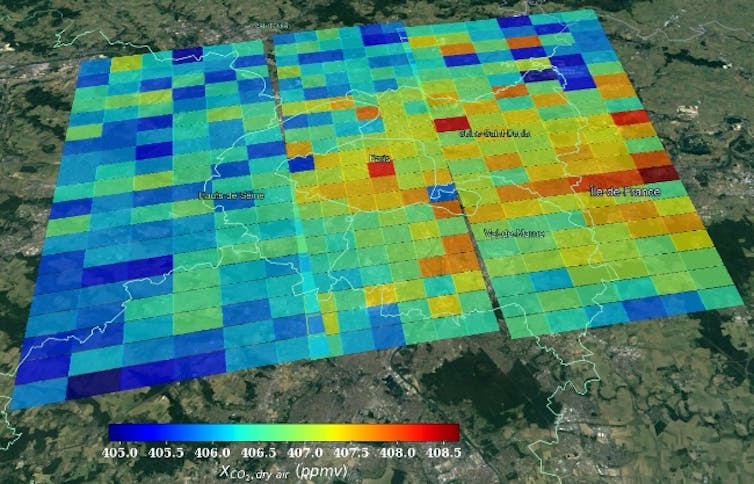Source: The Conversation – in French – By Cristina Pérez-Ordóñez, Profesora e investigadora, Universidad de Málaga

À l’origine illégales, les raves se voulaient des espaces d’expérimentation musicale et communautaire, aux marges de la société. Si certaines ont aujourd’hui été récupérées par l’industrie des festivals, d’autres persistent dans l’ombre, portées par une culture alternative aux codes bien établis. Un phénomène où musique électronique, spiritualité, engagement politique et contestation sociale se rencontrent.
« Notre état émotionnel est l’extase, notre nourriture est l’amour, notre addiction la technologie, notre religion la musique. Notre choix pour l’avenir, c’est la connaissance et, pour nous, la politique n’existe pas. »
C’est ainsi que débute ce que l’on appelle le Manifeste rave, publié au milieu des années 1990 sur le forum Alt.Rave. Ce texte est né en réaction à une campagne médiatique de dénigrement qui s’abattait alors sur ces fêtes. Il s’inspire des propos d’un DJ new-yorkais Frankie Bones, figure majeure de l’introduction de la culture rave aux États-Unis. L’essence de la philosophie du mouvement se résume en quatre mots : paix, amour, unité et respect (plus connus sous l’acronyme PLUR, pour Peace, Love, Unity, Respect).
Qu’est-ce qui pousse des millions de personnes à vouloir participer à ce type de fêtes ?
Le terme « rave » signifie « délire » en anglais. Ces fêtes permettent, à travers une musique manipulée électroniquement, de transcender l’individualité au profit du collectif. C’est ce que le sociologue Émile Durkheim appelait « l’effervescence collective », un phénomène également observable dans d’autres événements de musique live.
De l’esprit libertaire aux fêtes capitalistes
Les raves sont nées dans les années 1980. Les toutes premières étaient des fêtes illégales organisées dans des entrepôts désaffectés de Londres. Influencées par les free festivals et les new travellers (deux mouvements libertaires liés aux festivals artistiques et musicaux), ces free parties s’étiraient alors jusqu’à l’aube, au son du hip-hop, du groove puis, de plus en plus, de la house et de la techno venues de Chicago et Détroit.

Salix alba/Wikimedia, CC BY-SA
En 1989, le Royaume-Uni connaît ce que l’on appellera le « Second Summer of Love ». Cette période est marquée par des fêtes clandestines où la jeunesse célèbre le collectif à travers la musique électronique et l’expérimentation psychotrope. Peu après, en mai 1992, le collectif Spiral Tribe organise une rave illégale d’ampleur à Castlemorton, réunissant quelque 20 000 personnes.
Malgré la répression policière et les tentatives d’interdiction par le gouvernement de Margaret Thatcher, le phénomène est déjà enraciné dans les pratiques festives de la jeunesse.
Rapidement, de nombreux clubs et discothèques britanniques intègrent des soirées électroniques à leur programmation. Légalement encadrées, ces soirées marquent l’émergence d’un second modèle de raves : les raves institutionnalisées. Elles se diffusent ensuite à travers l’Europe et le reste du monde, connaissant un véritable essor et devenant peu à peu un produit du capitalisme culturel : des fêtes commercialisées, mondialisées et peu différenciées les unes des autres.

Altlondon/Wikimedia, CC BY-SA
Le cas de l’Espagne
Ce modèle inspire, par exemple, un mouvement emblématique de l’Espagne des années 1990 : la Ruta del Bakalao, un ensemble d’une dizaine de discothèques géantes à Valence. Ces clubs – Barraca, Espiral, NOD, ACTV, The Face, Spook, Puzzle, Heaven ou Chocolate – ouvrent quasiment en continu durant soixante-douze heures lors du week-end, accueillant des milliers de jeunes amateurs de musique mákina.
Comme au Royaume-Uni, la Ruta sombre dans l’oubli au milieu des années 1990. Mais avec la prolifération des festivals musicaux, les raves commerciales reviennent en force.
En Espagne, elles occupent désormais une place centrale dans les programmations, voire en deviennent l’élément principal, comme c’est le cas des festivals Dreambeach, Monegros, Medusa ou Sónar.
Quant aux raves clandestines, elles attendent le début du XXIe siècle pour gagner en popularité en Espagne. On en trouve notamment à Madrid (dans le tunnel de Boadilla ou au monastère de Perales del Río), en Andalousie (Grenade, Almería) ou en Catalogne.
De plus en plus de « ravers » ?
Plus largement, depuis le début du XXIe siècle, particulièrement depuis la pandémie de Covid-19, le mouvement raver ne cesse de gagner des adeptes. Ses partisans sont attirés par sa forme de loisir contre-culturelle et hédoniste, aux accents parfois rituels, voire quasi religieux.
Aujourd’hui, les deux grandes tendances coexistent : les raves commerciales (intégrées à la culture clubbing et festivalière) et les clandestines, ou free parties. Ce sont ces dernières qui suscitent le plus de controverses. Organisées par des collectifs appelés sound systems, elles sont secrètes, autogérées, non lucratives (les recettes servent à financer la fête), durent souvent plusieurs jours et se tiennent à l’écart des centres urbains pour éviter les conflits.
Elles exigent une logistique importante : tours de haut-parleurs, générateurs, essence, câblages, décors et éclairages sophistiqués. Ces fêtes ont toujours intégré une dimension visuelle et scénique forte.
Elles constituent aussi des espaces communautaires en rupture avec la vie quotidienne : des hétérotopies ou zones liminales où l’amour, la paix, l’unité et le respect sont les règles du vivre-ensemble. Elles se veulent des espaces sûrs, non violents, où les femmes sont respectées et non sexualisées.
Cette philosophie s’étend aussi à la défense de l’environnement comme en témoigne la parade berlinoise Rave The Planet, à la justice sociale comme lors des manifestations de Beyrouth en 2019, ou à l’engagement contre les conflits armés comme les raves organisées dans le désert israélien en protestation contre l’occupation de la Palestine.
Et ce, malgré la consommation de drogues associée à ces événements, où le cannabis et l’ecstasy – liés à la danse et à la fusion avec la musique – sont préférés au tabac, au LSD, à la cocaïne ou à l’alcool, dont la consommation peut parfois être mal vue.

Leonhard Lenz/Wikimedia
Sur le plan sociologique, les raves se distinguent par leur hétérogénéité et leur diversité. Selon leur style musical prédominant (techno, hardtechno, électronique, house, psychedelic trance, breakcore), elles attirent qui des clubbers, qui des punks, qui des hippies ou encore d’autres tenants de subcultures urbaines contemporaines. Et comme l’indique le Manifeste rave, tout le monde y est le bienvenu :
« Nous sommes une entité massive, un village tribal, global, qui dépasse toutes les lois établies par l’homme, ainsi que la géographie et le temps lui-même. Nous sommes innombrables. Nous sommes un. »
![]()
Cristina Pérez-Ordóñez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. La culture rave et ses multiples dimensions – https://theconversation.com/la-culture-rave-et-ses-multiples-dimensions-258491