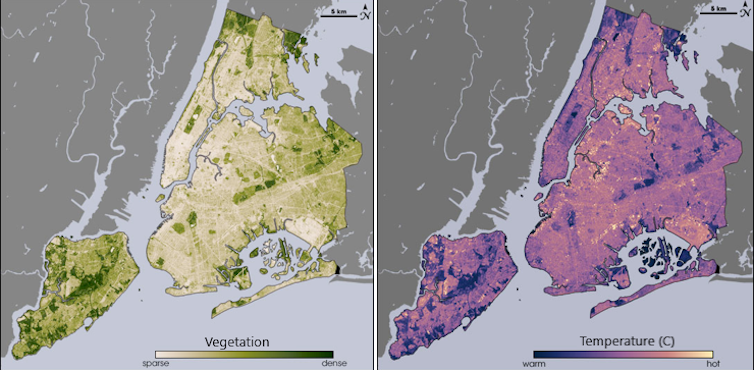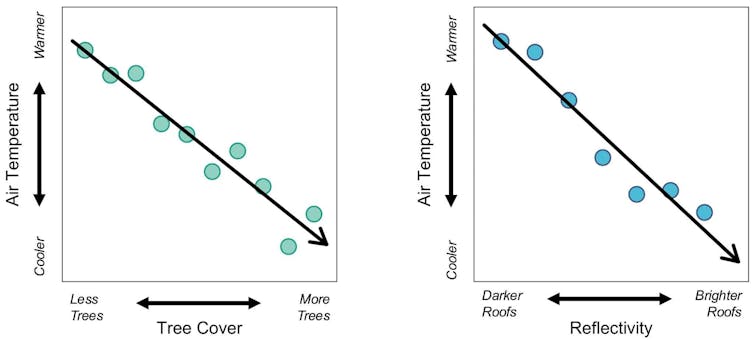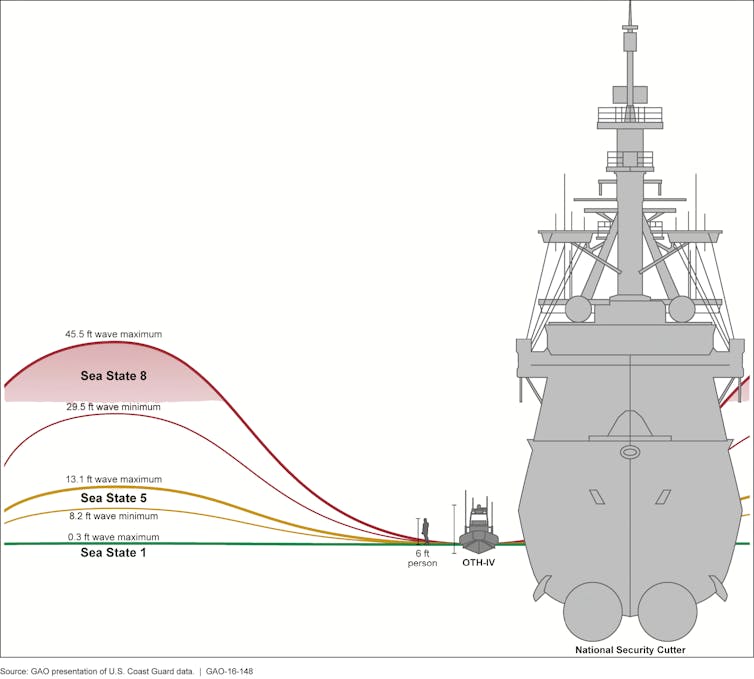Source: The Conversation – in French – By Cédrine Zumbo-Lebrument, Enseignante-chercheuse en marketing, Clermont School of Business

Le festival Europavox de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, a rassemblé près de 40 000 spectateurs en juin 2025, d’après les organisateurs. Entre concerts, stands institutionnels et prises de position engagées de certains artistes, il soulève une tension : et si ces événements festifs éphémères touchaient plus de citoyens que les dispositifs participatifs classiques ?
Chaque début d’été, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) se transforme en scène à ciel ouvert. Le festival attire un public large et intergénérationnel: adolescents, familles, groupes d’amis. Pendant trois jours, la ville vibre dans une atmosphère de curiosité et de fête.
L’édition 2025 illustre bien la diversité des registres proposés. Sur la grande scène, M (Matthieu Chedid) et son projet Lamomali ont fait dialoguer la chanson française et les traditions maliennes. Vendredi sur Mer a délivré une pop électro fédératrice, tandis que la jeune artiste Théa a revendiqué son identité queer sous les applaudissements de centaines de jeunes. Le chanteur satirique Philippe Katerine, quant à lui, a ironisé sur Marine Le Pen au détour d’une chanson provocatrice.
Quelques mètres plus loin, Zaho de Sagazan s’est drapée, en fin de concert, d’un drapeau arc-en-ciel LGBT et d’un drapeau palestinien sous les acclamations du public. La programmation a donné à voir une société où divertissement, engagement et contestation coexistent. Autour de la musique, un espace d’expression singulier s’est ouvert, mêlant le plaisir du spectacle et l’affirmation de messages politiques ou sociaux.
Pourquoi les institutions investissent ces espaces ?
Ce contexte populaire et convivial attire les acteurs publics. Dans l’enceinte du festival, on croisait ainsi des stands de la Ville de Clermont-Ferrand, du Département du Puy-de-Dôme, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Métropole, ou encore du service de vélos en libre-service C.Vélo. Quiz, jeux, simulateur de conduite, distribution de goodies : tout est conçu pour capter l’attention, valoriser l’action publique et donner une image plus accessible des institutions.
L’enjeu est loin d’être anecdotique. Les collectivités locales cherchent à renouer avec des citoyens gagnés par la défiance envers le politique. Une enquête Ipsos a récemment révélé que 78 % des Français estiment que le système politique fonctionne mal. Beaucoup ne participent plus aux consultations officielles, désertent les réunions de quartier et jugent les plates-formes numériques de concertation trop complexes ou peu efficaces.
En réalité, si l’idée de participation citoyenne reste plébiscitée dans les sondages, la mobilisation concrète demeure très faible : selon plusieurs études, seule une minorité de citoyens a déjà pris part à un débat public local, et une écrasante majorité a le sentiment que sa voix n’est pas prise en compte dans le débat public. Des experts observent d’ailleurs que la prolifération de ces dispositifs participatifs n’a pas résolu la crise de confiance, et va même de pair avec une recentralisation du pouvoir. Autrement dit, ces consultations, souvent conçues et pilotées d’en haut, peinent à jouer un rôle de contre-pouvoir puisque le « pouvoir exécutif en définit le cadre et la commande ».
Dans ce climat, les festivals apparaissent comme un moyen de recréer du lien. Ils offrent un contact informel, sans solennité, qui tranche avec les cadres participatifs traditionnels. Le fait d’aller vers le public sur un terrain festif permet de toucher des personnes habituellement éloignées de la vie civique, même à travers un échange bref ou un simple flyer.
Une participation qui interroge
Cette démarche d’« aller vers » pose néanmoins une question : peut-on vraiment parler de participation citoyenne ?
Le politologue Loïc Blondiaux a montré que la démocratie participative est souvent instrumentalisée par les élus comme un outil de communication et de légitimation bien plus qu’un véritable partage du pouvoir. Dès 1969, la sociologue Sherry R. Arnstein décrivait une « échelle de la participation » à huit niveaux, où les dispositifs les plus courants occupent les échelons inférieurs ; information unilatérale et consultation symbolique sans influence réelle sur la décision.
La « fausse démocratie participative » est pointée par le militant écologiste Cyril Dion lui-même : « Il n’y a rien de pire que la fausse démocratie participative ». Les festivals prolongent-ils cette logique, ou apportent-ils au contraire une alternative ?
D’un côté, on peut y voir une vitrine de plus : un espace de communication institutionnelle déguisé en moment convivial, où la participation du public reste superficielle. De l’autre, leur attractivité est telle qu’ils réussissent à toucher des publics habituellement éloignés des processus civiques. Là où une réunion de concertation classique n’attire souvent qu’une poignée de participants déjà convaincus, un festival réunit des milliers de citoyens de tous âges et horizons, sans effort particulier de leur part. Même si l’échange sur place est bref, le contact existe bel et bien ; ce qui est loin d’être garanti dans les démarches participatives formelles.
Il se joue une éducation démocratique
C’est précisément cette liberté qui permet une forme d’éducation démocratique implicite. La plupart des festivaliers viennent avant tout pour la musique et le plaisir, entre amis ou en famille. Beaucoup ne font qu’un passage éclair devant les stands institutionnels, repartant éventuellement avec un tote bag ou un badge souvenir, sans forcément l’intention de s’impliquer davantage par la suite.
Pourtant, ce premier contact, même superficiel, peut s’avérer plus efficace qu’un long questionnaire en ligne. L’effet d’exposition, le souvenir positif d’un échange informel et le sentiment d’accessibilité de la collectivité contribuent à renforcer une perception plus favorable des institutions locales.
Autrement dit, la « démocratie festive », même limitée, ouvre un espace de dialogue que les dispositifs officiels peinent à créer. Le politologue britannique Gerard Delanty parle à ce titre des festivals comme de véritables « sphères publiques culturelles » : des lieux où une pluralité de voix s’exprime et où le politique se mêle à l’émotion collective. Contrairement à la sphère publique classique définie par le philosophe Jurgen Habermas, fondée sur la raison argumentative et la recherche d’un consensus rationnel, ces espaces festifs introduisent une dimension affective dans le débat public. L’émotion collective partagée lors d’un concert ou d’un happening militant vient colorer le politique d’émotions, plus accessibles que le débat rationnel.
Contre-pouvoir, récupération ou coexistence ?
Cette pluralité d’expressions est-elle le signe d’une vitalité démocratique inédite, ou au contraire d’une neutralisation des tensions contestataires ? Jürgen Habermas définissait l’espace public comme un lieu de délibération rationnelle entre citoyens, structuré par des arguments critiques orientés vers l’intérêt commun. Les festivals comme Europavox s’en écartent radicalement : ils mettent en scène une coexistence de récits où la contestation politique (les slogans de Théa, l’ironie de Katerine, le geste de Zaho de Sagazan) se déploie au même titre que l’émotion, le divertissement ou la communication institutionnelle. Leur cohabitation avec les logiques de promotion publique peut sembler paradoxale.
Faut-il y voir un affaiblissement du débat démocratique, noyé dans le spectacle, ou au contraire une réinvention plus diffuse et inclusive de la citoyenneté contemporaine ?
D’une certaine manière, la convivialité générale désamorce les clivages habituels : tout le monde partage le même lieu, la même programmation, les mêmes expériences. Chacun peut y trouver ce qu’il vient chercher : un concert festif, un message engagé, une information sur les services publics. Cette coexistence des récits est peut-être la forme actuelle de notre démocratie : un pluralisme d’expressions tolérées côte à côte, mais sans véritable synthèse collective.
Plus qu’un festival
L’exemple d’Europavox montre qu’un festival peut (sans prétendre à de la concertation formelle) créer des conditions favorables à l’attention du public et au dialogue informel. À mi-chemin entre vitrine institutionnelle et engagement réel, il incarne un paradoxe de notre époque : en rendant l’action publique plus proche et sympathique, il parvient peut-être à toucher plus largement qu’un dispositif participatif pourtant conçu pour impliquer les citoyens.
Faut-il s’en réjouir ? Ou y voir la marque d’une démocratie épuisée, qui préfère la convivialité à la transformation profonde ? Sans doute un peu des deux. Une chose est certaine : ces espaces hybrides méritent d’être pris au sérieux, car ils en disent long sur nos manières contemporaines de « faire société » et d’associer les individus à la vie publique.
![]()
Cédrine Zumbo-Lebrument ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Par-delà la musique, les festivals comme scène démocratique : le cas Europavox – https://theconversation.com/par-dela-la-musique-les-festivals-comme-scene-democratique-le-cas-europavox-262350