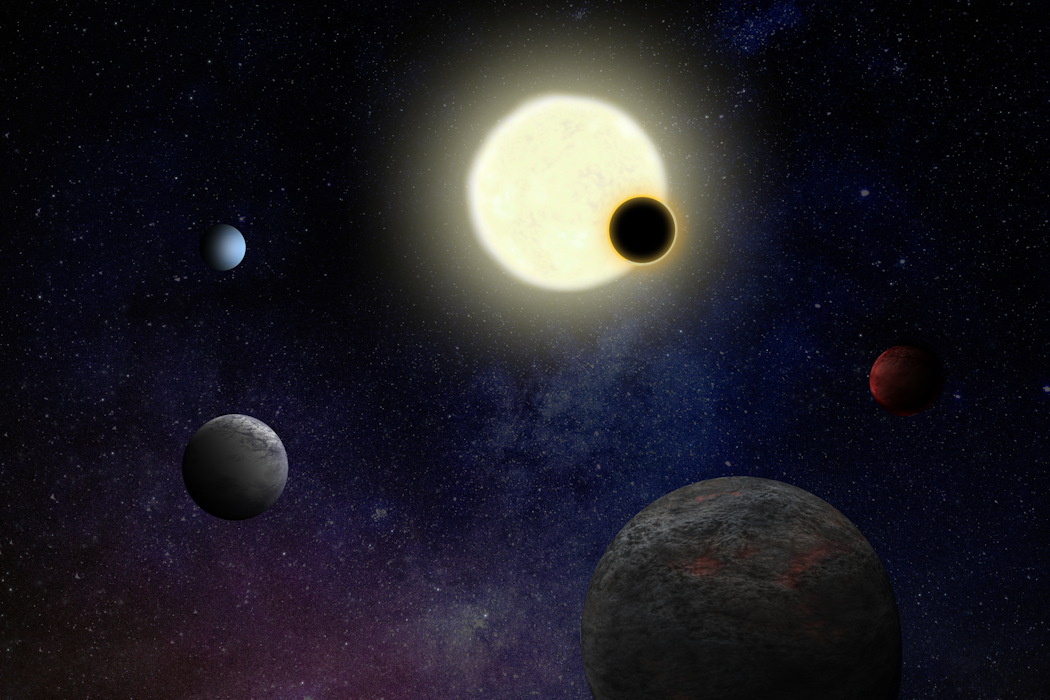Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armand Hernández, Investigador Ramón y Cajal en Ciencias de la Tierra y del Agua, Centro Interdiscilplinar de Química e Bioloxía (CICA), Universidade da Coruña
Seguramente todos hemos comentado lo caluroso y largo que fue el pasado verano. En el ascensor, en la cola del supermercado, en una sala de espera o mientras aguardamos a que nuestros hijos salgan del colegio; el “verano eterno” ha sido el tema estrella de muchas conversaciones cotidianas.
En Europa se empieza a sentir que el verano no termina. Las primaveras se acortan, los otoños llegan tarde y el frío del invierno, aunque puede ser extremo, dura poco. No es una impresión pasajera: la comunidad científica lleva tiempo observándolo, y ahora sabemos que el Viejo Continente se encamina hacia un cambio estacional sin precedentes en la historia humana.
En un estudio reciente, analizamos la evolución del verano durante los últimos 10 000 años y mostramos que, hace unos 6 000 años, esta estación llegó a extenderse durante casi 200 días. Entonces, las causas fueron naturales. Hoy el escenario es parecido, pero con una diferencia fundamental: el calentamiento actual tiene origen antropogénico y avanza a un ritmo muy superior al de aquel periodo.
Un archivo climático en el fondo de los lagos
Para reconstruir esta evolución, estudiamos las llamadas varvas, láminas de sedimento depositadas estacionalmente en algunos lagos. Cada varva suele incluir dos capas, una asociada al verano y otra al invierno. Midiendo su grosor es posible reconstruir, año a año, la duración e intensidad de cada estación.
El estudio de estas laminaciones en lagos europeos revela un patrón claro: los veranos del Holoceno medio (hace entre 8 000 y 4 000 años aproximadamente) duraban de media 200 días, casi un mes más que a principios del siglo XX.
¿Qué provocó esos veranos tan largos? La explicación principal está en el gradiente latitudinal de temperatura, la diferencia térmica entre el ecuador y el Ártico.
Cuando el Ártico se calienta más rápido que las zonas tropicales, ese gradiente se debilita y la circulación atmosférica se ralentiza. El chorro polar, la corriente de vientos rápidos que rodea el hemisferio norte, pierde intensidad y comienza a ondularse. Esta configuración favorece los llamados bloqueos atmosféricos: situaciones en las que un anticiclón estacionario permanece sobre Europa durante semanas, desviando las borrascas atlánticas y exponiendo al continente a aire cálido sostenido.
Leer más:
Fusión extrema en el Ártico: el nuevo rostro del deshielo acelerado por el cambio climático
Las consecuencias son veranos más largos y episodios más frecuentes de olas de calor, sequías y lluvias torrenciales al inicio del otoño. Según nuestra investigación, existe una relación estadística sólida entre la duración del verano y la intensidad del gradiente térmico: cerca de dos tercios de la variabilidad estacional del Holoceno se explica por cambios en este gradiente. Por cada grado de debilitamiento, Europa suma unos seis días adicionales de verano.
Lecciones del pasado
Lo preocupante es que este mecanismo está reactivándose hoy en día. La comparación con el pasado aporta perspectiva, pero también urgencia. Durante el Holoceno, las modificaciones del gradiente se debieron a variaciones orbitales o al retroceso de grandes masas de hielo, procesos lentos y graduales. Hoy, el motor del cambio es el calentamiento global inducido por la actividad humana, y la atmósfera responde con rapidez.
El Ártico se calienta unas cuatro veces más rápido que el resto del planeta, un fenómeno conocido como “amplificación ártica”, lo que reduce el gradiente térmico a una velocidad sin precedentes en los últimos diez milenios.
Leer más:
El Ártico, un termómetro del cambio climático
Desde los años ochenta, los veranos europeos muestran una clara tendencia a alargarse, confirmada por los registros meteorológicos. También lo reflejan los sistemas naturales: plantas que florecen antes, insectos que aparecen antes de lo habitual y aves migratorias que adelantan sus desplazamientos. El reloj climático de Europa está cambiando, y la diferencia principal respecto al pasado es la velocidad a la que ocurre.
Si las emisiones continúan al ritmo actual, Europa podría sumar hasta 42 días más de verano para el año 2100. Esto supondría veranos fuera de los umbrales naturales bajo los que se ha desarrollado la humanidad. En escenarios más optimistas, el aumento sería menor, pero aun así relevante: unos 13 días adicionales.
Aunque estas cifras puedan parecer pequeñas, dos semanas extra de verano extremo tienen consecuencias directas: mayor mortalidad por calor, estrés hídrico en cultivos, incendios más frecuentes, alteraciones en ecosistemas sensibles y presión añadida sobre las infraestructuras energéticas. A ello se suma el impacto en los inviernos que, aunque cada vez con más eventos extremos, duran poco, lo que afecta a la acumulación de nieve y la recarga de acuíferos, generando procesos de retroalimentación.
Una ventana al mañana
Aunque no existan predicciones exactas del futuro, aún es posible influir en su trayectoria. Cada decisión para reducir nuestras emisiones, cada avance tecnológico, cada política climática orientada a la neutralidad en carbono contribuye a frenar esta tendencia.
Contamos con herramientas científicas sólidas, sociedades más conscientes y una innovación climática en pleno desarrollo. El mismo conocimiento que permite reconstruir los veranos del Holoceno ayuda hoy a anticipar riesgos, transformar sistemas energéticos, restaurar ecosistemas y diseñar soluciones que hace poco parecían inalcanzables. La historia climática nos advierte. Queda por ver si sabremos escucharla.
![]()
Armand Hernández recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).
Celia Martin Puertas recibe fondos de UK Research and Innovation
– ref. Doscientos días de verano – https://theconversation.com/doscientos-dias-de-verano-270363