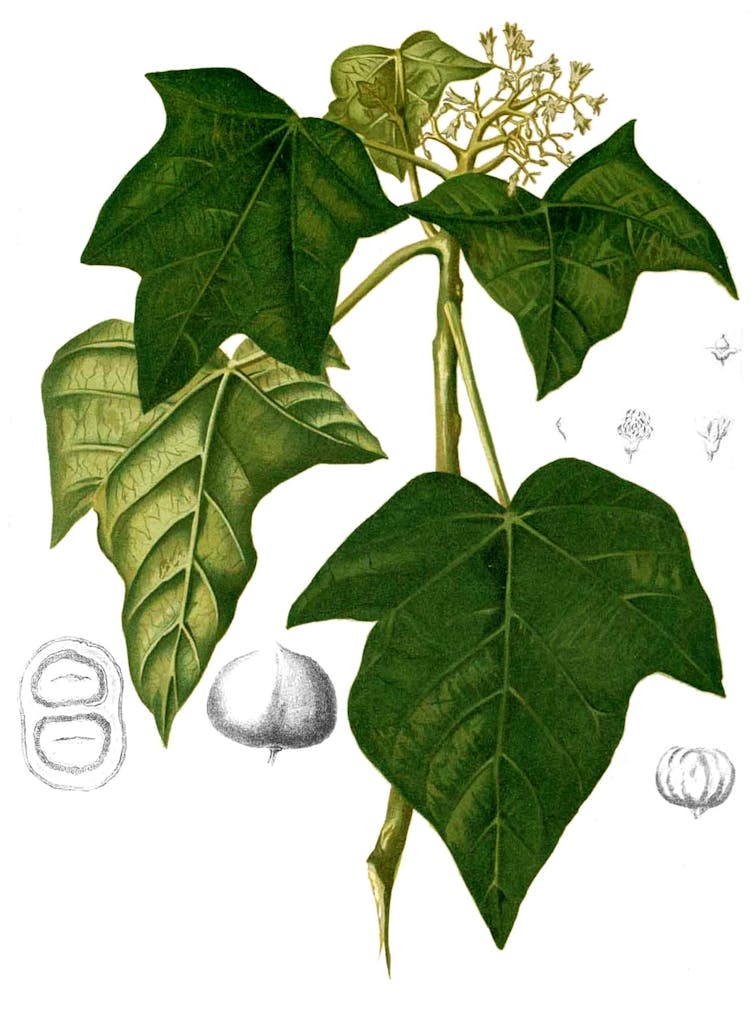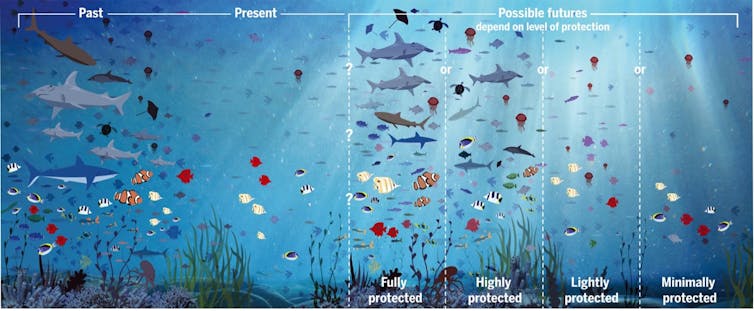Source: The Conversation – in French – By Mahmood Mamdani, Herbert Lehman Professor of Government, Department of Anthropology, Columbia University
Dans son dernier ouvrage, Slow Poison: Idi Amin, Yoweri Museveni, and the Making of the Ugandan State (Poison insidieux: Idi Amin, Yoweri Museveni et la génèse de l’État ougandais), l’anthropologue Mahmood Mamdani analyse les facteurs et les figures – Idi Amin et Yoweri Museveni – qui ont façonné l’Ouganda après son indépendance.
Dans cet entretien avec The Conveersation Africa, il explique qu’il existe des différences frappantes entre ces deux hommes.
Museveni est au pouvoir depuis près de quatre décennies. Amin a duré huit ans. Comment expliquer la longévité de Museveni ?
J’essaie d’expliquer dans mon livre les principales raisons qui ont permis à Museveni de rester au pouvoir pendant plus de quatre décennies. Je pense que ces raisons sont à la fois internes et externes.
Il n’a pas seulement fait comme les Britanniques qui prenaient des groupes éthniques existants et les politisaient en structures tribales. Il est allé plus loin: il a pris des sous-groupes éthniques et en a fait des tribus.
Pas seulement comme l’ont fait les Britanniques, en prenant les groupes ethniques existants et en les politisant pour en faire des structures politiques que nous appelons tribus. Mais plus que cela, en prenant certains sous-groupes ethniques et en les transformant en tribus. Ainsi, à partir de moins de 20 tribus, il en a créé plus de 100. C’est un processus sans fin.
Et puis il y a la raison externe. Contrairement à Amin, qui était l’ennemi juré des grandes puissances occidentales, Museveni s’est imposé comme leur allié privilégié et protégé.
**Certains analystes semblent suggérer que ce n’est que maintenant, en particulier depuis que son fils a commencé à faire des déclarations politiques, que la politique ougandaise se militarise. Mais un thème qui ressort clairement de votre livre est que, sous Amin comme sous Museveni, l’armée s’est substituée à l’organisation politique…
Je pense que c’est une lecture correcte du livre. Maintenant, dans le cadre de cette comparaison très large, il existe des différences importantes dans la voie empruntée par Amin.
Amin a été recruté comme enfant soldat par les Britanniques à l’âge de 14 ans environ. Il a été formé à ce qu’ils appellent les arts de la contre-insurrection, ce qui est en réalité un terme poli pour désigner le terrorisme d’État. Il avait l’habitude de démontrer publiquement, en particulier aux chefs d’État africains, par exemple lors de leur réunion au Maroc, comment il pouvait étouffer quelqu’un avec un mouchoir.
Et Amin a subi une sorte de transformation au cours de la première année qui a suivi son accession au pouvoir.
Il a accédé au pouvoir grâce à l’aide directe des Britanniques et des Israéliens. Les Israéliens, en particulier, ont conseillé à Amin qu’il ne pouvait pas se contenter de renverser le premier président de l’Ouganda après l’indépendance Milton Obote et penser que l’affaire était close. Il devait aussi s’occuper de ses acolytes, les personnes qu’il avait placées à des postes clés, et le retour de bâtons devait arriver d’un moment à l’autre.
Pour éviter cela, il avait choisi de les éliminer. Sa première année au pouvoir fut brutale. Il a tué des centaines de personnes dans différents camps militaires. Il s’agissait de massacres, il n’y a pas d’autre mot pour les qualifier.
Puis, après cela, il s’est rendu en Israël et en Grande-Bretagne avec une liste de demandes. Il pensait avoir rendu service aux Israéliens et aux Britanniques et s’attendait qu’ils fassent de même. Mais ceux-ci ont trouvé cela amusant, et il s’est senti humilié. Il a cherché une alternative, et c’est ainsi qu’il a rencontré, par l’intermédiaire du président égyptien Anwar Sadat, puis par le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, le leader soudanais, Gaafar Muhammad Nimeiry. Amin, avec l’empereur éthiopien Haile Selassie, a joué un rôle clé dans l’accord d’Addis-Abeba de 1972 qui a mis fin à la première guerre civile au Soudan.
Au cours des deux années qui ont suivi son arrivée au pouvoir, je n’ai pas eu connaissance de nouveaux massacres. Il a continué à tuer ses opposants, mais il n’a pas étendu les meurtres à la famille, aux amis, aux clans ou simplement aux groupes auxquels la personne était identifiée ou associée. Ses meurtres ressemblaient davantage à ceux d’un dictateur qui recourt à la violence pour écraser ses opposants.
C’est très différent dans le cas de Museveni. Museveni est arrivé au pouvoir avec la conviction que la violence est essentielle à la politique, et particulièrement à la politique de libération. Museveni est un fervent adepte de Frantz Fanon, en particulier Les Damnés de la Terre. Et la principale leçon qu’il tire de Fanon est le caractère essentiel de la violence dans toute politique d’émancipation.
J’essaie donc de retracer le cheminement qui a conduit Museveni à considérer la violence comme un élément central du démantèlement d’un État oppressif, pour aboutir à l’idée que la violence est un élément central de la construction d’un État. Il arrive ainsi à la conclusion inverse. Et cela bien avant que son fils n’entre en scène.
J’ai consacré tout un chapitre de mon livre aux premières décennies qui ont suivi 1986, lorsque Museveni est arrivé au pouvoir, à ses opérations dans le nord et aux massacres et meurtres successifs, Il affirmait poursuivre la guerre contre le terrorisme, qui avait commencé après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
Et ces affirmations ont été acceptées telles quelles par la communauté internationale, c’est-à-dire les puissances occidentales.
Diriez-vous donc que la guerre contre le terrorisme a été une aubaine pour Museveni, l’aidant à faire avancer son agenda ?
Tout à fait. Depuis le programme d’ajustement structurel de la fin des années 1980, il a compris que s’il voulait étouffer l’opposition dans son pays, il aurait besoin d’un soutien étranger, et que ce soutien lui serait accordé s’il se présentait comme un acteur central dans la guerre contre le terrorisme.
Museveni était suffisamment intelligent pour comprendre que la politique étrangère américaine et l’intervention militaire américaine avaient des limites politiques, notamment le nombre de pertes américaines acceptables. Et lorsque ces meurtres ont eu lieu en Somalie, lors de l’incident Black Hawk Down (La chute d’un faucon noir), Museveni a proposé ses services.
Il a envoyé ses soldats en Somalie. Vous vous souvenez de ce slogan, « des solutions africaines pour les problèmes africains ». Museveni a proposé cette solution africaine au Soudan du Sud, au Rwanda, dans l’est du Congo. La solution africaine n’était qu’un nom sophistiqué pour désigner le massacre d’Africains par des Africains au service des puissances impériales. Et c’est ce qui s’est finalement produit.
Vous recommandez une fédération comme la solution la plus susceptible de réussir dans l’Ouganda post-Museveni. Existe-t-il actuellement une base politique pour cela ? Ou faudrait-il que quelque chose se produise pour que la fédération proposée aboutisse ?
Ceux d’entre nous qui sont des nationalistes militants et des indépendants ont compris que la fédération était un projet britannique. Nous savions que la droite favorable à la création de fiefs tribaux utilisait la fédération comme écran pour masquer son agenda. Nous avons compris que c’était leur façon de saper toute tentative de construire un État nationaliste fort.
Mais depuis lors, avec la construction d’un État fort, nous avons compris que les conditions et les temps avaient changé. L’organisation locale, l’autonomie locale, ont pris une signification très différente.
C’est un moyen de résister au développement de l’autocratie du pouvoir central et je pense que les gens commencent à en tirer des leçons.
Maintenant, la question est de savoir quel type de fédération, car Museveni a également promu quelque chose qui ressemble à une fédération. Mais il a, comme en Éthiopie, promu ce que l’on peut appeler un fédéralisme ethnique.
Ainsi, dans chaque entité, il a séparé la majorité de la minorité: la majorité appartenant au groupe éthnique considéré comme “historique” sur le territoire et la minorité issue d’autres groupes éthniques, qui, bien que vivant dans le pays et y étant nés, se voient toujours privés de droits.
C’est ce qui s’est passé en Éthiopie. Si vous regardez l’Éthiopie, si vous regardez le Soudan, vous verrez que les Britanniques ont politisé les groupes ethniques et les ont transformés en tribus. Et puis, après le colonialisme, nous avons militarisé ces tribus. Nous avons donc créé des milices tribales. C’est ce qu’ils ont fait en Éthiopie. Ce sont les combats entre différentes milices tribales. C’est ce qu’ils ont fait au Soudan. Ils ont créé des milices tribales, d’abord au Darfour, puis dans d’autres endroits. C’est l’armée nationale qui a dirigé la création de ces milices tribales. Ce sont ensuite les milices tribales qui ont commencé à engloutir l’État.
La guerre civile qui sévit actuellement oppose donc l’armée nationale et les milices tribales. C’est le même processus que celui observé en Ouganda. Nous n’en sommes pas encore arrivés à créer des milices tribales, mais nous avons fabriqué tribu après tribu afin de fragmenter le pays.
Certaines des tendances que vous décrivez à propos de l’Ouganda se retrouvent dans la plupart des pays africains. Quelles leçons peut-on en tirer pour l’avenir du reste du continent africain ?
D’une manière générale, on observe ces tendances dans de nombreux pays africains. Le modèle colonial britannique est devenu le modèle colonial dominant. Même les Français, connus pour leurs préférences assimilationnistes, ont adopté la domination indirecte lorsqu’ils sont passés de l’assimilation à ce qu’ils appelaient l’association dans les années 1930. Et les Portugais ont suivi les Français.
Les Sud-Africains ont été les derniers à suivre le mouvement – ils ont appelé cela apartheid. Mais c’était la même chose, la création de homelands, la tribalisation des différences locales. C’est donc une tendance dans la pensée du continent.
L’alternative a souvent été la centralisation. Le continent oscille ainsi entre pouvoir autocratique et centralisé et des pouvoirs tribaux fragmentés.
Je propose une troisième voie. Je propose une fédération plus ethnique. Je propose une fédération davantage basée sur le territoire, davantage basée sur le lieu où vous vivez. Ainsi, peu importe d’où vous venez, le simple fait que vous viviez là signifie que vous avez lié votre destin à celui des autres personnes qui y vivent pour créer un avenir commun.
Et ce qui importe en politique, plus que votre origine, c’est la décision de construire un avenir commun. La migration est une caractéristique de la société humaine. La société humaine n’est pas née des patries. La patrie est donc une fiction coloniale.
L’idée que les Africains ne se déplaçaient pas, qu’ils étaient liés à un territoire particulier, est absurde, car les Africains se déplaçaient plus que quiconque. Nous savons que l’humanité est née en Afrique et s’est répandue dans le reste du monde. Alors, où se trouve la patrie ? Vous pouvez avoir une patrie pour cette génération, pour les générations précédentes, mais tous les Africains ont une histoire de migration. C’est, je pense, un élément central.
La voie à suivre : l’une est une fédération qui consolide la démocratie plutôt que de l’éroder.
La deuxième voie à suivre consiste à réfléchir de manière critique à l’ensemble du modèle économique néolibéral et à l’autonomisation des élites, qu’elles soient raciales, ethniques ou autres.
Je pense que nous devons trouver un modèle économique différent. Mais comme vous le dites, le livre n’est pas consacré à la recherche de solutions. Il est consacré à l’idée que nous devons comprendre le problème avant de nous précipiter vers des solutions.
Et chaque pays aura ses propres nuances qui sont ifférentes de celles de l’Ouganda.

Mahmood Mamdani does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
– ref. Génèse et déclin d’un État : le chercheur Mahmood Mamdani décrypte l’histoire politique de l’Ouganda – https://theconversation.com/genese-et-declin-dun-etat-le-chercheur-mahmood-mamdani-decrypte-lhistoire-politique-de-louganda-273487


![]()