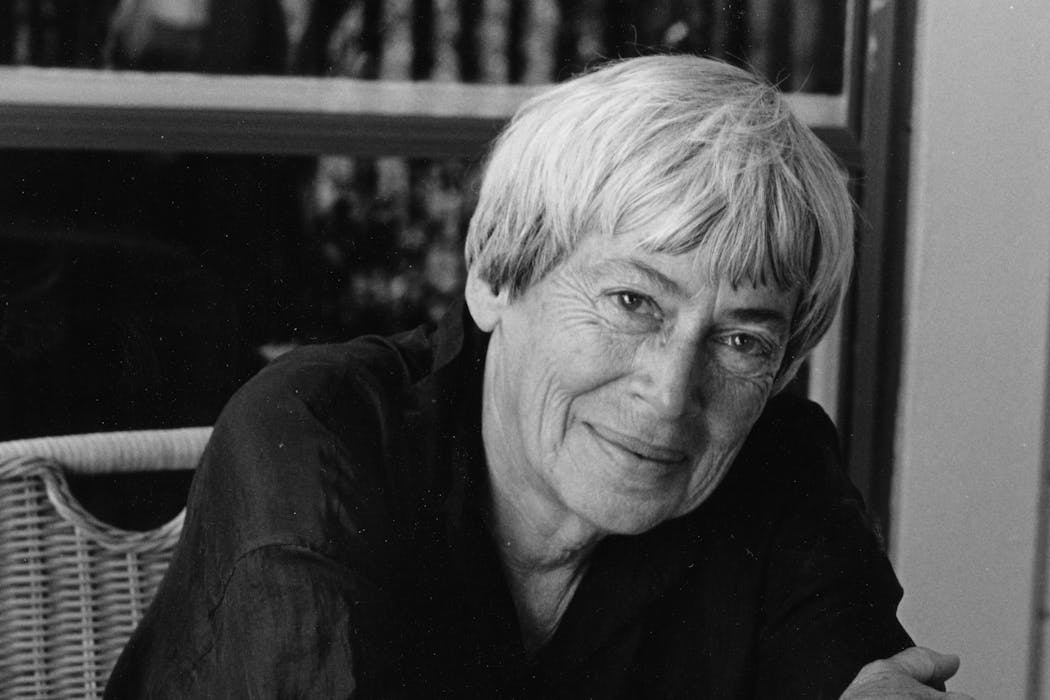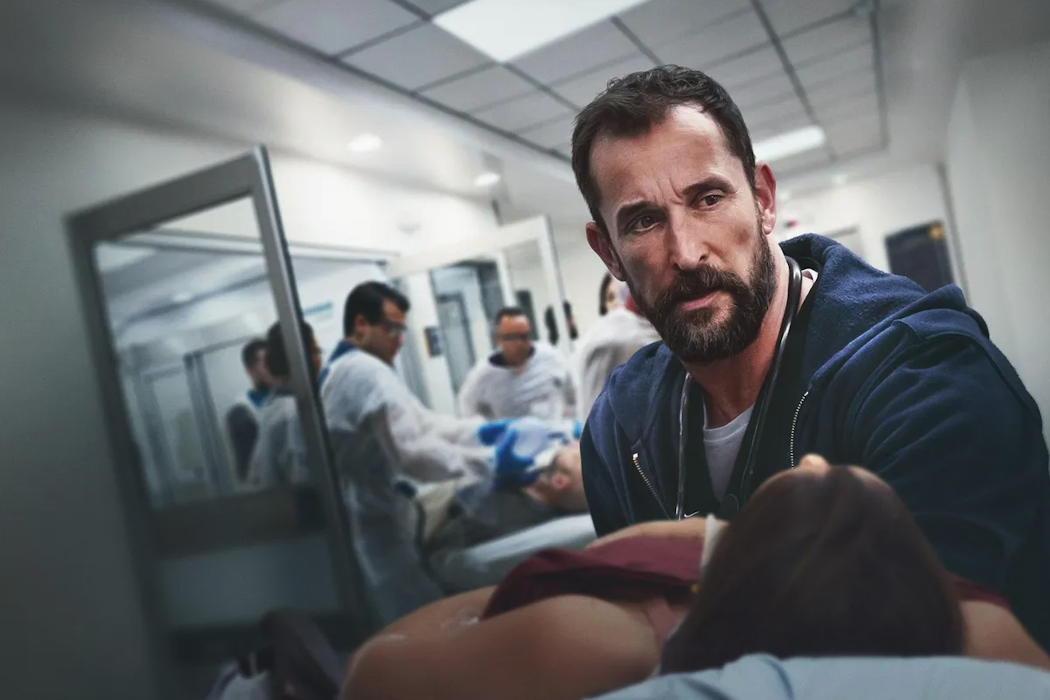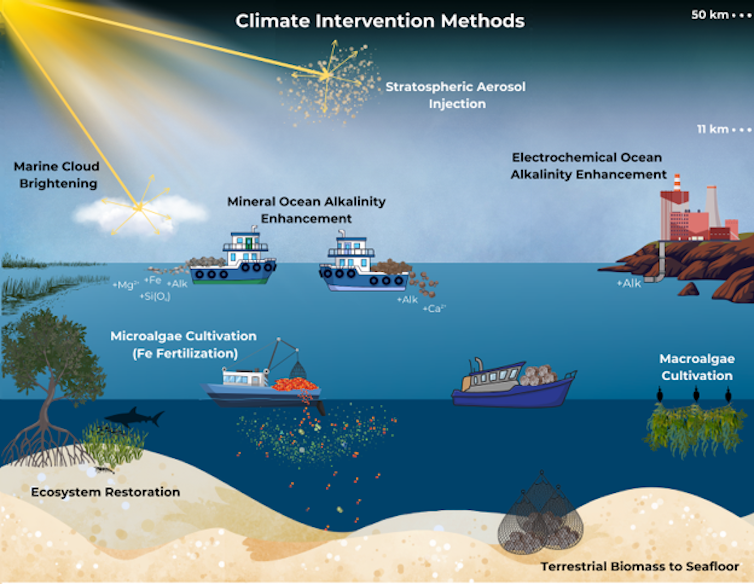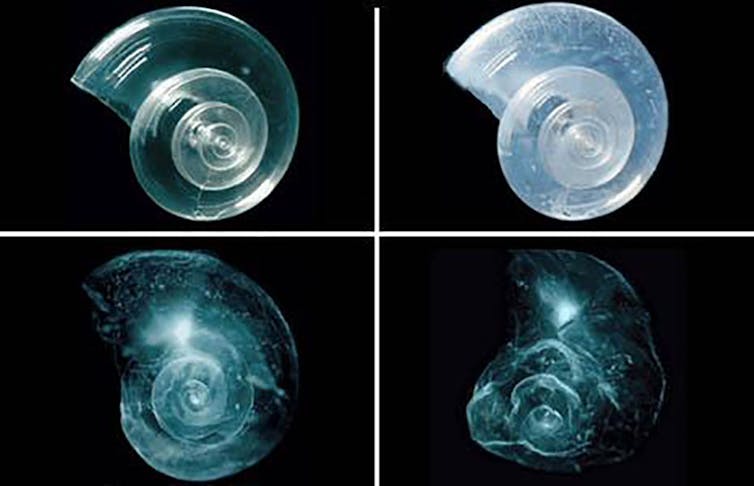Source: The Conversation – France (in French) – By Chloé Pannier, Doctorante en Sciences de l’éducation et de la formation, Nantes Université
À partir du 19 janvier 2026, les lycéens peuvent s’inscrire sur la plateforme nationale Parcoursup pour déposer leurs candidatures auprès d’établissements d’enseignement supérieur. Ce cheminement personnel les confronte à des normes et à des attentes sociales souvent sources d’anxiété. En quoi l’accompagnement des candidats est-il un défi pour les familles comme pour le monde enseignant ?
Chaque année, Parcoursup revient au cœur du débat. Autour de cette plateforme sur laquelle les lycéens déposent leurs candidatures auprès des établissements d’enseignement supérieur se cristallisent nombre des tensions qui traversent l’école française. La procédure d’orientation post-bac constitue surtout une épreuve sociale qui mobilise simultanément élèves, familles et équipes éducatives.
À partir de travaux croisant plusieurs enquêtes qualitatives (entretiens auprès d’élèves, de parents, de professeurs principaux, de psychologues de l’éducation nationale, et observations dans des commissions d’examen des vœux), nous proposons d’éclairer ce que produit concrètement Parcoursup dans la vie lycéenne : stress, malentendus, redéfinition des rôles éducatifs et montée des logiques stratégiques.
Une procédure technique devenue une expérience morale
Pour les lycéens, Parcoursup ne représente pas qu’un ensemble de démarches administratives ; il s’agit d’un moment décisif de leur parcours personnel, rythmé par différentes étapes, de la formulation des vœux à la publication des réponses. Cette temporalité crée un climat particulier où s’entremêlent injonction à l’autonomie, pression à la performance et nécessité de faire des choix engageants à 17 ans ou à 18 ans.
Les élèves décrivent une procédure marquée par l’attente, l’incompréhension du fonctionnement de l’algorithme et la crainte de faire « le mauvais choix ». Pour certains, Parcoursup confirme ou infirme l’image qu’ils se font d’eux-mêmes d’un point de vue scolaire, provoquant un sentiment de déclassement lorsque les réponses sont jugées décevantes.
Ces expériences individuelles renvoient à des enjeux collectifs : la massification scolaire, la hiérarchisation des filières ou encore la valeur persistante du diplôme dans les trajectoires sociales.
L’orientation devient ainsi une « épreuve morale », pour reprendre les mots du sociologue Danilo Martuccelli : il s’agit d’un dispositif où les individus se confrontent à des normes, des attentes et des défis qui les dépassent.
Dans les familles, de l’accompagnement stratégique à l’anxiété généralisée
Si Parcoursup concerne au premier plan les élèves, les parents occupent une place centrale dans la procédure. Les résultats de nos recherches montrent que les familles les plus dotées en capital culturel s’engagent très tôt dans des démarches de comparaison, de recherche d’informations et de sélection des « bonnes formations ». Elles mobilisent salons, portes ouvertes, réseaux personnels et compétences rédactionnelles.
Si elles s’investissent aussi dans la procédure, les familles populaires le font selon des modalités plus limitées : soutien moral, aide technique, relecture orthographique. Ces écarts témoignent d’une inégale familiarité avec les attendus scolaires et les codes implicites de la procédure.
Toutefois, un élément apparaît transversal : l’anxiété parentale. Les résultats de Parcoursup sont fréquemment interprétés comme une forme d’évaluation indirecte du travail éducatif réalisé au sein de la famille. Plusieurs parents rencontrés disent avoir eu le sentiment d’être « jugés » lorsque les réponses obtenues ne correspondaient pas à leurs attentes, même lorsque leurs enfants avaient de bons résultats.
À lire aussi :
Contester les verdicts de Parcoursup : les parents en première ligne ?
Cette dimension affective est renforcée par la perception d’un système perçu comme opaque ou arbitraire. L’incompréhension de l’algorithme, l’absence de communication standardisée entre établissements et les variations locales des critères nourrissent un sentiment d’incertitude. Parcoursup devient ainsi, pour les familles, une épreuve domestique, un moment de mobilisation mais aussi de mise en tension.
Les enseignants de lycée face à un rôle flou et ambigu
Les professeurs principaux et les équipes pédagogiques se retrouvent également en première ligne. Si la majeure partie des enseignants interrogés estiment que l’accompagnement à l’orientation relève des psychologues de l’Éducation nationale (PsyEN), dans les faits, ce sont plutôt les professeurs principaux qui assurent la majorité du suivi en raison non seulement du renforcement de leur mission d’orientation depuis la loi « Orientation et réussite des étudiants » de 2018, mais aussi faute de ressources suffisantes et de PsyEN dans les établissements.
Les enseignants interrogés décrivent une mission complexe, marquée par un mandat flou et des injonctions contradictoires. D’un côté, ils doivent répondre à des prescriptions institutionnelles : harmonisation des pratiques, appropriation de la plateforme, organisation des semaines de l’orientation. De l’autre, la relation avec les élèves sollicite une dimension plus expressive : écoute, soutien émotionnel, aide à la construction d’un projet, gestion des inquiétudes.
Cette tension se manifeste particulièrement lorsque les enseignants se sentent démunis face au manque de formation ou aux évolutions rapides de la procédure. Certains développent des stratégies d’accompagnement très poussées, parfois au-delà de leur rôle formel, tandis que d’autres adoptent une posture plus distante pour éviter la surcharge ou les malentendus avec les familles.
Plus largement, Parcoursup met en lumière des malentendus école-familles en raison des attentes implicites de réflexivité et d’autonomie du côté de l’école, et des attentes plus concrètes ou protectrices du côté des parents. Ces décalages peuvent générer incompréhension, frustrations et parfois même des conflits.
Un terrain où se rejouent les inégalités scolaires
Les inégalités scolaires n’attendent évidemment pas Parcoursup pour faire des différences, mais la procédure les rend visibles et parfois les amplifie. Le recours inégal aux ressources d’information, l’aisance variable dans la formulation d’un projet, la maîtrise des codes rédactionnels des « projets de formation motivés » ou la connaissance de la hiérarchie des formations structurent fortement les trajectoires.
Ces écarts renvoient à ce que les sociologues appellent des malentendus socioculturels. L’école attend des élèves (et de leurs familles) des compétences implicites : aptitude à se projeter dans l’avenir, capacité à se raconter, mobilisation stratégique, autant de compétences qui ne sont pas également partagées. Ce décalage explique en partie les incompréhensions ou les réactions divergentes face au verdict de la plateforme.
Plutôt que de considérer Parcoursup uniquement comme un outil technique, il importe de comprendre comment cette procédure reconfigure les relations entre école, familles et élèves. À travers elle se jouent des enjeux de justice scolaire, d’accompagnement, de communication et de reconnaissance des différents acteurs.
Parcoursup ne fait que traduire un système scolaire compétitif et sélectif où chacun tente de trouver sa place dans un système perçu à la fois comme indispensable et comme source de tensions. En ce sens, la plateforme ne fait que mettre en lumière les défis plus larges de l’orientation dans une école massifiée, sélective et traversée par de fortes attentes sociales.
![]()
Chloé Pannier a reçu des financements durant son contrat doctoral financé dans le cadre d’un projet lauréat d’un PIA3.
Alban Mizzi a reçu des financements du PIA3 ACCES – ACCompagner vers l’Enseignement Supérieur.
– ref. Parcoursup : comment faire le « bon » choix d’orientation, ou le défi d’accompagner les lycéens – https://theconversation.com/parcoursup-comment-faire-le-bon-choix-dorientation-ou-le-defi-daccompagner-les-lyceens-271875