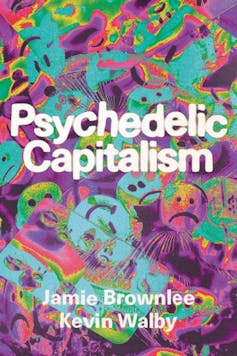Source: The Conversation – France in French (3) – By Primrose Freestone, Senior Lecturer in Clinical Microbiology, University of Leicester

Notre lit héberge quantité de bactéries, acariens et autres. Voici comment le nettoyer correctement et pourquoi c’est important pour la santé.
Nous passons environ un tiers de notre vie au lit. Ces périodes de sommeil ne sont pas seulement des moments de repos : elles sont essentielles au bon fonctionnement du cerveau et à la santé en général.
Si nous nous focalisons souvent sur le nombre d’heures de sommeil, la qualité de notre l’environnement dans lequel nous dormons est elle aussi importante. Un lit propre et accueillant, avec des draps frais, des taies d’oreiller douces et des couvertures ou des couettes régulièrement nettoyées, est non seulement agréable, mais favorise également un meilleur repos.
Mais à quelle fréquence devons-nous vraiment laver notre linge de lit ?
Selon un sondage mené en 2022 au Royaume-Uni par la société YouGov, seuls 28 % des Britanniques lavent leurs draps chaque semaine. Un nombre étonnamment élevé de personnes interrogées a admis les laisser en place beaucoup plus longtemps, certaines attendant même jusqu’à huit semaines ou plus entre deux lavages. Que dit la science de telles pratiques ?
Voyons ce qui se passe réellement dans votre lit chaque nuit, et pourquoi un lavage régulier est plus qu’une simple question de propreté.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Chaque nuit, pendant notre sommeil, nous perdons des centaines de milliers de cellules cutanées, autrement dit, des peaux mortes. Nous sécrétons aussi divers fluides, via nos glandes sébacées. Nous transpirons par exemple jusqu’à un demi-litre de liquide, même si nous nous sommes douchés juste avant de nous coucher. En outre, notre peau abrite des millions de bactéries et de champignons, dont un grand nombre est transféré sur les draps, les oreillers et les couettes lorsque nous bougeons pendant la nuit.
Lorsqu’elle est fraîche, notre sueur peut être inodore. Cependant, les bactéries présentes sur notre peau, en particulier les staphylocoques, la décomposent en sous-produits malodorants. C’est souvent la raison pour laquelle vous avez une odeur corporelle au réveil, même si vous vous êtes couché propre.
Mais la contamination de notre couchage n’est pas qu’une question de microbes. Au cours de la journée, nos cheveux et notre corps accumulent des polluants, poussières, pollens et autres allergènes, qui peuvent également être transférés sur notre literie. Ils peuvent déclencher des allergies, affecter la respiration et contribuer à la mauvaise qualité de l’air de la chambre à coucher.
Acariens, champignons et autres compagnons invisibles
Les squames cutanées que nous perdons chaque nuit servent de nourriture aux acariens – des créatures microscopiques qui se développent dans la literie et les matelas chauds et humides. Les acariens ne sont pas dangereux en eux-mêmes, cependant leurs excréments constituent de puissants allergènes qui peuvent aggraver l’eczéma, l’asthme et la rhinite allergique.
Les champignons apprécient également votre lit. Certaines espèces, comme Aspergillus fumigatus, ont été détectées dans des oreillers usagés. Ils peuvent provoquer de graves infections pulmonaires, en particulier chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.
À lire aussi :
Les décès dus aux infections fongiques ont doublé en dix ans
Si vous dormez avec des animaux domestiques, les microbes sont encore plus à la fête. Vos compagnons à quatre pattes introduisent en effet des poils, des squames, de la saleté et parfois des traces fécales dans vos draps et vos couvertures, ce qui augmente la fréquence à laquelle vous devriez les laver.
Justement, au bout de combien de temps faudrait-il laver sa literie ?
Draps et taies d’oreiller
-
Quand : Une fois par semaine, ou tous les trois à quatre jours si vous avez été malade, si vous transpirez beaucoup ou si vous partagez votre lit avec des animaux domestiques.
-
Pourquoi : Pour éliminer la transpiration, les secrétions corporelles huileuses, les microbes, les allergènes et les cellules mortes.
-
Comment : Lavez à 60 °C ou plus avec un détergent pour tuer les bactéries et les acariens. Pour désinfecter plus profondément, passez le linge au sèche-linge ou repassez-le. Pour éliminer les acariens à l’intérieur des oreillers, congelez-les pendant au moins 8 heures.
Matelas
-
Quand : Passez l’aspirateur au moins une fois par semaine et aérez le matelas tous les deux ou trois jours.
-
Pourquoi : La transpiration augmente le taux d’humidité, créant un terrain propice à la prolifération des acariens.
-
Conseils : utilisez un protège-matelas en plastique ou anti-allergène et remplacez le matelas tous les sept ans pour maintenir un bon niveau d’hygiène et de soutien (selon l’Institut national du sommeil et de la vigilance français, la durée de vie maximale recommandée pour une literie est de 10 ans, ndlr).
Les oreillers
-
Quand : tous les quatre à six mois (vérifiez d’abord l’étiquette).
-
Pourquoi : le rembourrage interne peut abriter des bactéries et des moisissures.
-
Comment : lavez soigneusement et séchez complètement pour éviter la formation de moisissures.
Couvertures et housses de couette
-
Quand : toutes les deux semaines, ou plus souvent si des animaux domestiques dorment dessus.
-
Pourquoi : elles retiennent les peaux mortes, la transpiration et les allergènes.
-
Comment : Lavez-les à 60 °C ou à la température maximale indiquée sur l’étiquette. Il est parfois conseillé de les traiter comme des serviettes : un lavage régulier à haute température permet de les garder propres.
Couettes
-
Quand : tous les trois à quatre mois, en fonction de l’utilisation et de la présence d’animaux domestiques ou d’enfants dans votre lit.
-
Pourquoi : même avec une housse, les huiles corporelles et les acariens finissent par s’infiltrer dans le rembourrage.
-
Comment : vérifiez l’étiquette : de nombreuses couettes sont lavables en machine, d’autres peuvent nécessiter un nettoyage professionnel.
Votre lit peut sembler propre, mais il regorge de microbes, d’allergènes, d’acariens et de composés irritants, qui s’accumulent rapidement. Laver et entretenir votre literie régulièrement n’est pas seulement une question de fraîcheur, c’est aussi une question de santé.
Cela permet d’éliminer le mélange de sueur, de peau, de poussière et de microbes qui s’y accumule, ce qui contribue à réduire les réactions allergiques, à prévenir les infections et à éliminer les odeurs.
Les recherches continuent de démontrer que le sommeil influe grandement sur de nombreux aspects de notre santé, depuis l’état de notre système cardiovasculaire jusqu’à notre santé mentale. S’assurer de la bonne hygiène de notre environnement de sommeil est un investissement somme toute assez modeste, mais efficace pour améliorer notre bien-être.
Alors n’hésitez plus : défaites votre lit, lavez vos draps et mettez vos oreillers au congélateur. Vos sinus (contrairement aux microbes) vous en remercieront. Bonne lessive, et faites de beaux rêves !
![]()
Primrose Freestone ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. À quelle fréquence faut-il laver le linge de lit ? – https://theconversation.com/a-quelle-frequence-faut-il-laver-le-linge-de-lit-260684