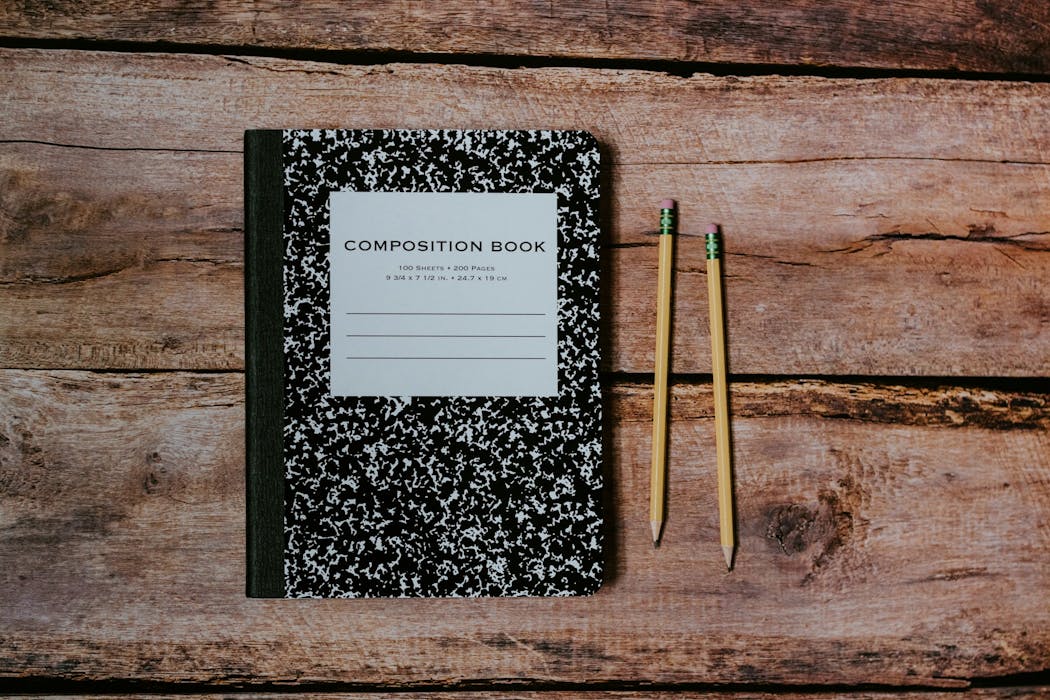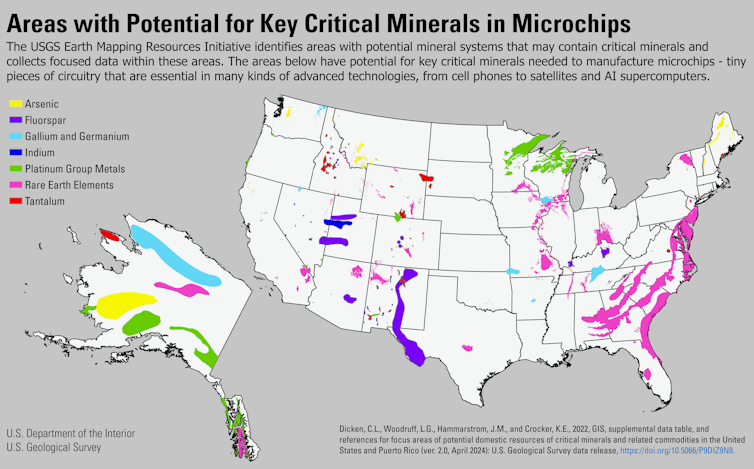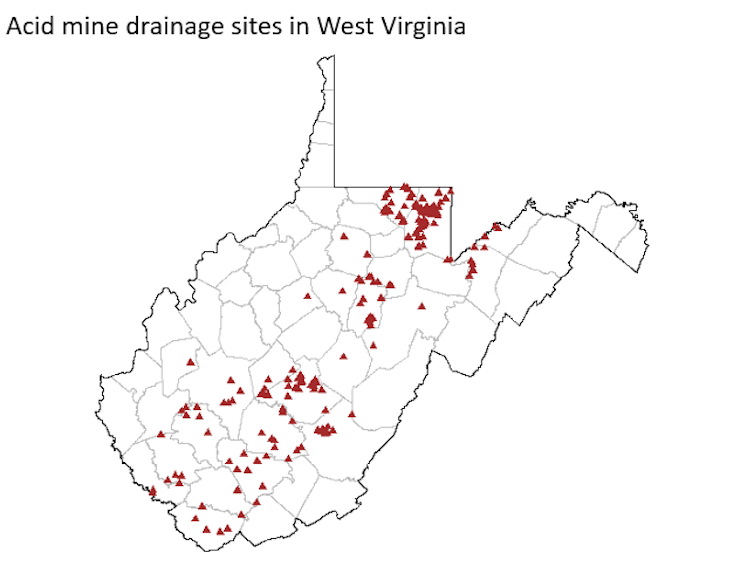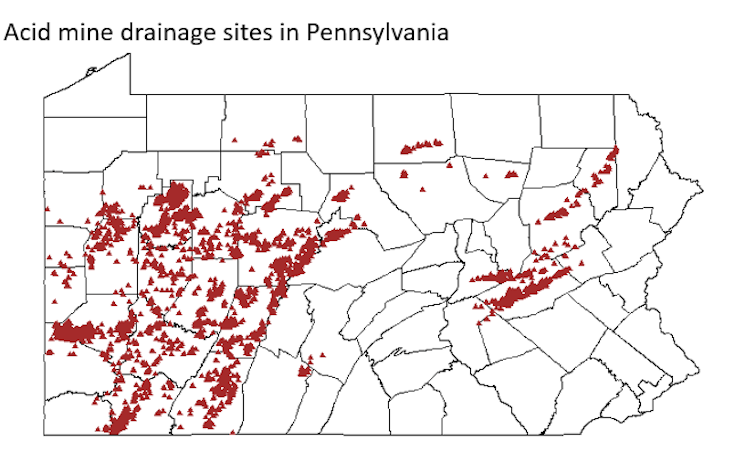Source: The Conversation – in French – By Gregory Frame, Teaching Associate in Media and Cultural Studies, University of Nottingham
Explorant les failles et la défaite de la gauche américaine, les films Une bataille après l’autre, de Paul Thomas Anderson, et The Mastermind, de Kelly Reichardt, sont sortis en 2025, tandis que Donald Trump faisait un retour en force. Chacun à leur manière, ils invitent les membres et les partisans du parti démocrate comme les activistes de la gauche radicale à faire leur introspection.
La victoire de Donald Trump en novembre 2024 a provoqué une profonde remise en question dans les forces de gauche de la politique états-unienne. Après avoir échoué, les dirigeants du Parti démocrate ont passé l’essentiel de l’année 2025 à panser leurs plaies, tandis que Trump lançait ce que ses opposants considèrent comme une attaque frontale contre la démocratie américaine.
La nouvelle année a commencé par de nouveaux scandales, tant sur le plan intérieur qu’extérieur, l’administration Trump agissant avec une impunité de plus en plus effrayante.
À lire aussi :
Le raid de Donald Trump sur le Venezuela laisse présager un nouveau partage du monde entre les grandes puissances
Combinée à la poursuite de la montée du populisme de droite et de l’autoritarisme dans le monde entier, la version « 2.0 » de Trump est vécue comme une crise existentielle pour la gauche.
Le pays a déjà connu une telle situation. Les mouvements de protestation de gauche des années 1960 aux États-Unis ont contribué à d’importants changements législatifs – en particulier dans le domaine des droits civiques –, mais ils ont souvent été caricaturés comme étant « antipatriotiques », notamment s’agissant de la guerre du Vietnam. Le sentiment que le pays se désagrégeait sous l’action de jeunes radicaux violents a conduit la « majorité silencieuse » conservatrice à offrir la victoire électorale à Richard Nixon en 1968.
Depuis lors, la gauche institutionnelle étasunienne s’est détournée de l’idéalisme des années 1960 et a plutôt proposé des changements progressifs et limités. Mais cette stratégie ne s’est sans doute pas révélée très efficace au cours du dernier demi-siècle.
Dans le contexte d’une nouvelle défaite et d’un énième cycle d’introspection, il semble donc approprié que deux films portant sur les échecs de la politique révolutionnaire de gauche des années 1960 et 1970 émergent presque simultanément avec le retour en force de Trump.
Explorer l’activisme de gauche
Bien que très différents par leur style et leur ton, Une bataille après l’autre (2025), de Paul Thomas Anderson, et The Mastermind (2025), de Kelly Reichardt, critiquent ce qu’ils présentent comme l’insuffisance stratégique et l’autosatisfaction de l’activisme de gauche, tout en explorant son coût personnel.
Une bataille après l’autre met en scène l’ancien révolutionnaire Pat Calhoun, alias Bob, (Leonardo DiCaprio) qui tente de sauver sa fille Willa (Chase Infiniti) des griffes d’un colonel suprémaciste blanc, qui a tout d’un psychopathe, Lockjaw (Sean Penn). Bien que Bob ait autrefois résisté aux politiques d’immigration cruelles et racistes du gouvernement fédéral à travers une série de raids audacieux contre des centres de détention, la paternité et une consommation excessive de cannabis ont émoussé son ardeur révolutionnaire.
Au lieu de cela, Bob est désormais un bouffon quelque peu incompétent. Le film exploite à des fins comiques ses tentatives chaotiques pour communiquer avec la « French 75 », l’armée révolutionnaire dont il faisait autrefois partie, inspirée de groupes révolutionnaires réels des années 1960 et 1970, comme les Weathermen.
Déambulant en peignoir, il a oublié tous les codes et les conventions nécessaires pour évoluer dans cet univers. Des mots de passe aux pronoms, Bob est en décalage avec son époque.
Cependant, le film se permet aussi de se moquer du moralisme de la gauche. Alors que Bob devient de plus en plus agressif faute d’obtenir des informations sur un point de rendez-vous crucial, le radical à qui il parle au téléphone l’informe que le langage qu’il emploie nuit à son bien-être. Si Bob manque de compétences pour soutenir la révolution, ceux qui la dirigent sont trop fragiles pour en mener une à bien.
À l’inverse, The Mastermind suit J. B. Mooney (Josh O’Connor) dans ses tentatives d’échapper aux autorités après avoir orchestré le vol de quatre œuvres d’art dans un musée de banlieue. Mari, père et fils d’un juge, Mooney est privilégié, sans direction, désorganisé, égoïste et, semble-t-il, indifférent à l’impact de la guerre du Vietnam alors que le conflit fait rage autour de lui.
Sa désorganisation est évidente dès le moment où il réalise que l’école de ses enfants est fermée pour une journée de formation des enseignants, le jour du casse. Son privilège apparaît clairement lorsqu’il lui suffit de mentionner le nom de son père lors de son premier interrogatoire par la police pour qu’on le laisse tranquille.
Même ses tentatives de convaincre sa femme, Terri (Alana Haim), qu’il a agi pour elle et pour leurs enfants sont maladroites, puisqu’il finit par admettre qu’il l’a aussi fait pour lui-même.
Alors qu’il est en fuite, Mooney semble ignorer ce qui se passe réellement autour de lui, des jeunes hommes noirs qui discutent de leur déploiement imminent au Vietnam, aux bulletins d’information relatant la réalité de la guerre. Sans rien dévoiler, Mooney ne peut finalement échapper aux conséquences de la guerre du Vietnam sur la société américaine.
Des moments révélateurs dans les deux films suggèrent également l’engagement vacillant envers la révolution de la part de ses anciens adeptes. Dans The Mastermind, Mooney se cache chez Fred (John Magaro) et Maude (Gaby Hoffmann), un couple avec lequel il a fréquenté l’école d’art. Malgré son passé militant, Maude refuse de l’héberger plus d’une nuit par crainte d’attirer l’attention des autorités. Dans Une bataille après l’autre, la volonté de Bob de prendre des risques pour sa sécurité et sa liberté diminue lorsqu’il devient parent et il est, de manière assez problématique, prompt à juger la mère de Willa, Perfidia (Teyana Taylor), qui continue à agir à ses risques et périls.
Le cinéma politique des années 1970
Les deux films rappellent inévitablement les œuvres tout aussi politiques produites par le cinéma états-unien à la fin des années 1960 et au début des années 1970, telles que Cinq pièces faciles (1970), Macadam à deux voies (1971) et Chinatown (1974). Au cœur du contrecoup nixonien face au radicalisme des années 1960, ces films adoptent un ton de résignation défaitiste, mettant en scène des protagonistes sans direction et des fins malheureuses.
La conclusion de The Mastermind ressemble à celle de ces films des années 1970. Le film s’achève sur des policiers présents lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam, se félicitant mutuellement après avoir arrêté un nouveau groupe de manifestants et de les avoir envoyés en prison.
Bien qu’Une bataille après l’autre soit beaucoup plus pétillant dans son style, la politique révolutionnaire de gauche y apparaît aussi comme une impasse. Des victoires à plus petite échelle restent possibles : Sergio (Benicio del Toro) continue de se battre pour les immigrés sans papiers, et Willa s’enfuit pour rejoindre une manifestation Black Lives Matter à la fin du film.
Mais en regardant ces deux films depuis la perspective d’une nouvelle année où l’administration Trump menace de provoquer de nouveaux bouleversements violents, tant au plan national qu’international, je repense à la lamentation mélancolique de Captain America (Peter Fonda) vers la fin du classique de la contre-culture Easy Rider (1969) :
« On a tout gâché. »
![]()
Gregory Frame ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. « Une bataille après l’autre » et « The Mastermind » : quand le cinéma révèle les échecs de la gauche aux États-Unis – https://theconversation.com/une-bataille-apres-lautre-et-the-mastermind-quand-le-cinema-revele-les-echecs-de-la-gauche-aux-etats-unis-274060