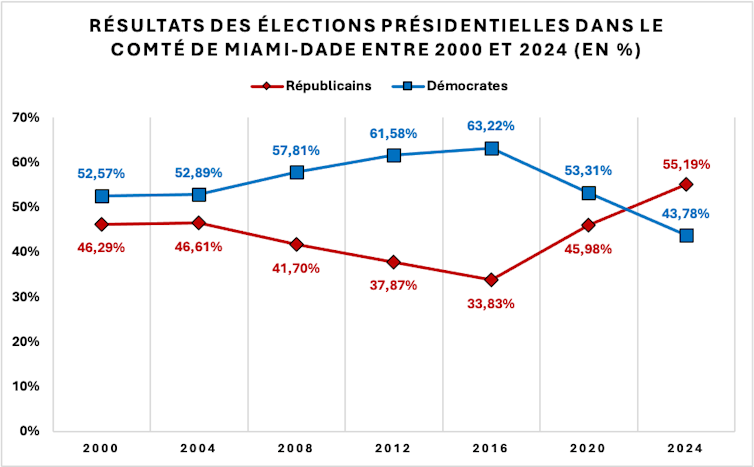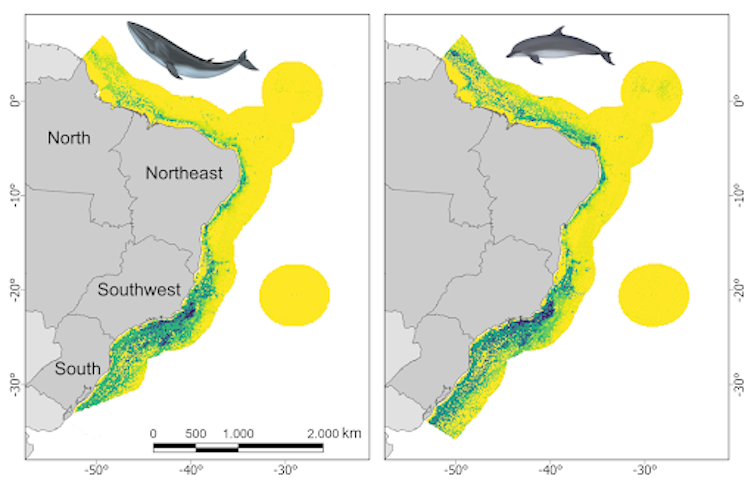Source: The Conversation – in French – By Miranda Sheild Johansson, Senior Research Fellow in Social Anthropology, UCL
Quels sont les impacts de la suppression d’un impôt au-delà des personnes et des agents économiques concernés ? Les Suédois ont aboli l’impôt sur la fortune en 2007. Ce faisant, c’est toute la vision de la société partagée jusque-là qui pourrait avoir été ébranlée. Car la fiscalité n’est pas qu’une affaire économique. Elle a aussi un rôle social, voire individuel.
Pendant une grande partie du XXe siècle, la Suède jouissait à juste titre de la réputation d’être l’un des pays les plus égalitaires d’Europe. Pourtant, au cours des deux dernières décennies, elle s’est transformée en ce que le journaliste et auteur Andreas Cervenka qualifie de « paradis pour les super-riches ».
Aujourd’hui, la Suède affiche l’un des ratios de milliardaires en dollars les plus élevés au monde et abrite de nombreuses start-up « licornes », valorisées à au moins un milliard de dollars américains (850 millions d’euros), dont la plateforme de paiement Klarna et le service de streaming audio Spotify
La suppression de l’impôt sur la fortune (förmögenhetsskatten) il y a vingt ans s’inscrit pleinement dans cette évolution, tout comme, la même année, l’instauration de généreuses déductions fiscales pour les travaux domestiques et la rénovation des logements. Vingt ans plus tard, le nombre de foyers suédois qui emploient du personnel de ménage est devenu l’un des signes révélateurs d’un pays de plus en plus fracturé socialement.
Dans le cadre de mes recherches anthropologiques sur les relations sociales que produisent les différents systèmes fiscaux, j’ai travaillé avec des retraités dans les banlieues sud de la capitale suédoise, Stockholm, afin de comprendre comment ils perçoivent la baisse du niveau de taxation au cours de leurs dernières années de vie.
Cette évolution s’est accompagnée d’un recul progressif de l’État-providence. Beaucoup des personnes que j’ai interrogées regrettent que la Suède n’ait plus de projet collectif visant à construire une société plus cohésive.
« Nous, les retraités, voyons la destruction de ce que nous avons bâti, de ce qui a commencé quand nous étions de très jeunes enfants », explique Kjerstin, 74 ans.
« Je suis née après la fin de la guerre et j’ai contribué à construire cette société tout au long de ma vie, avec mes concitoyens. Mais avec la baisse des impôts et le démantèlement de notre sécurité sociale… aujourd’hui, nous ne construisons plus rien ensemble. »
Le coefficient de Gini de la Suède, l’indicateur le plus couramment utilisé pour mesurer les inégalités, a atteint 0,3 ces dernières années (0 correspondant à une égalité totale et 1 à une inégalité totale), contre environ 0,2 dans les années 1980. L’Union européenne dans son ensemble se situe à 0,29. « Il y a désormais 42 milliardaires en Suède – c’est une hausse considérable », m’a confié Bengt, 70 ans.
« D’où viennent-ils ? Ce n’était pas un pays où l’on pouvait devenir aussi riche aussi facilement. »
Mais, comme d’autres retraités que j’ai rencontrés, Bengt reconnaît aussi la part de responsabilité de sa génération dans cette évolution.
« J’appartiens à une génération qui se souvient de la manière dont nous avons construit la Suède comme un État-providence, mais tellement de choses ont changé. Le problème, c’est que nous n’avons pas protesté. Nous n’avons pas réalisé que nous devenions ce pays de riches. »
À l’opposé de l’American Dream
L’impôt sur la fortune a été instauré en Suède en 1911. Son montant était alors calculé à partir d’une combinaison du patrimoine et des revenus. À la même période, les premières pierres de l’État-providence suédois étaient posées, notamment via l’introduction de la retraite publique en 1913.
Le terme utilisé pour désigner ce modèle, folkhemmet (« la maison du peuple »), renvoyait à l’idée d’un confort et d’une sécurité garantis à tous de manière égale. Il constituait, à bien des égards, l’exact opposé idéologique du rêve américain : non pas la recherche de l’exceptionnel, mais celle de niveaux de vie décents pour tous et de services universels.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’impôt sur la fortune – désormais dissocié de l’impôt sur le revenu – a de nouveau été relevé par étapes, jusqu’à atteindre dans les années 1980 un niveau historiquement élevé, avec un taux marginal de 4 % pour les patrimoines les plus importants, même si la charge fiscale réelle reste difficile à établir en raison de règles d’exonération complexes. Malgré cela, les recettes totales générées par cet impôt sont restées relativement modestes. Rapportées au PIB annuel de la Suède, elles n’ont jamais dépassé 0,4 % sur l’ensemble de la période d’après-guerre.
À la fin des années 1980, les vents politiques commencent toutefois à tourner en Suède, dans le sillage d’un mouvement plus large de privatisation des services publics et de dérégulation des marchés financiers observé dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni sous Margaret Thatcher, ainsi qu’aux États-Unis.
L’un des reproches récurrents adressés à l’impôt sur la fortune en Suède était alors son caractère régressif : il taxait surtout le patrimoine des classes moyennes, principalement constitué de logements et d’actifs financiers, tout en épargnant les plus grandes fortunes, notamment celles détenues par des propriétaires de grands groupes ou des dirigeants occupant des postes élevés dans des entreprises cotées. Une autre critique tenace était que cet impôt encourageait l’optimisation fiscale, en particulier sous la forme de fuites de capitaux vers des paradis fiscaux offshore.
Si l’existence d’un impôt sur la fortune pouvait sembler incarner l’engagement du pays en faveur de l’égalité socioéconomique, les personnes que j’ai interrogées disent ne pas y avoir vraiment prêté attention avant son abolition en 2006 par le gouvernement de droite alors en place, après la suppression, un an plus tôt, des droits de succession par le précédent gouvernement social-démocrate.
« Quand l’impôt sur la fortune a été supprimé, raconte Marianne, 77 ans, je ne pensais pas que l’on faisait un cadeau aux millionnaires, parce que… nous n’avions pas de riches aristocrates possédant tout. La suppression de l’impôt sur la fortune et des droits de succession semblait être une mesure pratique, pas vraiment politique. »
Marianne, comme les autres retraités à qui j’ai parlé, racontent tous une histoire dans laquelle l’État-providence a été construit par un effort collectif, plutôt que comme un projet à la Robin des Bois consistant à prendre aux riches pour donner aux pauvres. Cette vision de l’État-providence suédois comme l’œuvre d’égaux, issus à l’origine d’une population majoritairement rurale et pauvre, a sans doute détourné ces retraités des questions liées à l’accumulation des richesses.
Si la Suède continue de taxer la propriété et différentes formes de revenus du capital, avec le recul, nombre de mes interlocuteurs âgés considèrent aujourd’hui que la suppression de l’impôt sur la fortune, intervenue « alors qu’ils en étaient les témoins directs », a constitué une étape décisive dans la transformation de la société suédoise, l’éloignant du modèle social-démocrate de l’État-providence pour l’orienter vers autre chose : un pays de milliardaires à la fragmentation sociale accrue.
« Je pense à mes enfants, à mes deux filles qui travaillent et ont de jeunes familles, m’a confié Jan, 72 ans. Quand elles étaient enfants, l’État-providence s’occupait d’elles : elles allaient dans de bonnes écoles, avaient accès au football, au théâtre, au dentiste…, mais aujourd’hui, je crains que la société ne se dégrade pour elles. »
Comme d’autres personnes interrogées, Jan exprime des regrets quant à son propre rôle dans cette évolution.
« Je pense maintenant que c’est en partie de ma faute, dit-il. Nous sommes devenus paresseux et complaisants, convaincus que l’État-providence suédois était solide, nous ne nous sommes pas inquiétés de la suppression de l’impôt sur la fortune, nous pensions que cela ne changerait rien… mais je crois que ça a changé beaucoup de choses. »
« Une société plus humaine »
Mes recherches suggèrent que les effets de l’existence – ou de l’absence – d’un impôt sur la fortune ne se limitent pas aux recettes fiscales ou à la redistribution des richesses. Ils ont des répercussions sociales plus larges et peuvent être constitutifs de la manière dont les individus se représentent la société.
À l’heure actuelle, seuls trois pays européens appliquent un véritable impôt sur la fortune : la Norvège, l’Espagne et la Suisse. Par ailleurs, la France, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas prélèvent des impôts sur le patrimoine ciblant certains actifs, sans toutefois taxer la richesse globale des individus.
En Suède du moins, la question aujourd’hui n’est pas seulement de savoir si l’impôt sur la fortune fonctionne ou non, mais aussi quel type de société il dessine : celle du folkhemmet, ou celle d’un paradis pour les riches.
« L’impôt allait de soi quand j’ai grandi dans les années 1950, se souvient Kjerstin. Je me rappelle avoir pensé, alors que j’étais en deuxième année de primaire, que je serais toujours prise en charge, que je n’aurais jamais à m’inquiéter. »
Revenant sur le sentiment que la vie en Suède est aujourd’hui très différente, elle ajoute :
« Désormais, les gens ne veulent plus payer d’impôts – parfois même moi, je n’ai plus envie d’en payer. Tout le monde réfléchit à ce qu’il reçoit en retour et à la manière de s’enrichir, au lieu de penser à construire quelque chose ensemble. »
« Je ne pense pas qu’on puisse dire : “Je paie tant d’impôts, donc je devrais récupérer exactement la même chose.” Il faut plutôt prendre en compte le fait que l’on vit dans une société plus humaine, où chacun sait, dès le CE1, qu’il sera pris en charge. »
Les noms des personnes interrogées ont été modifiés.
![]()
Miranda Sheild Johansson a reçu des financements de UK Research And Innovation.
– ref. « Paresseux et complaisants » : des retraités suédois racontent comment la suppression de l’impôt sur la fortune a transformé leur pays – https://theconversation.com/paresseux-et-complaisants-des-retraites-suedois-racontent-comment-la-suppression-de-limpot-sur-la-fortune-a-transforme-leur-pays-273907