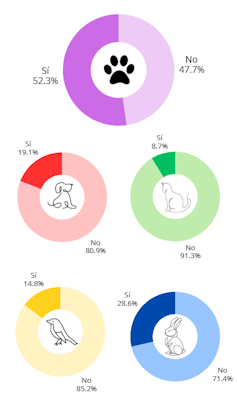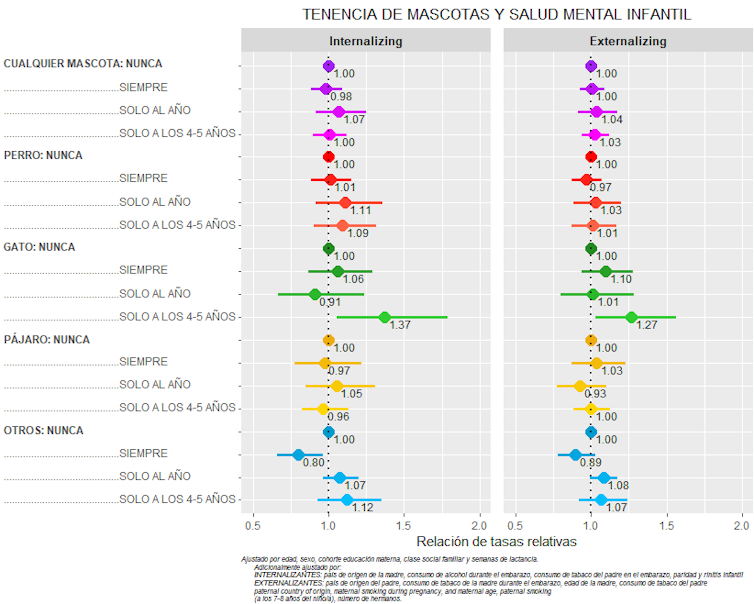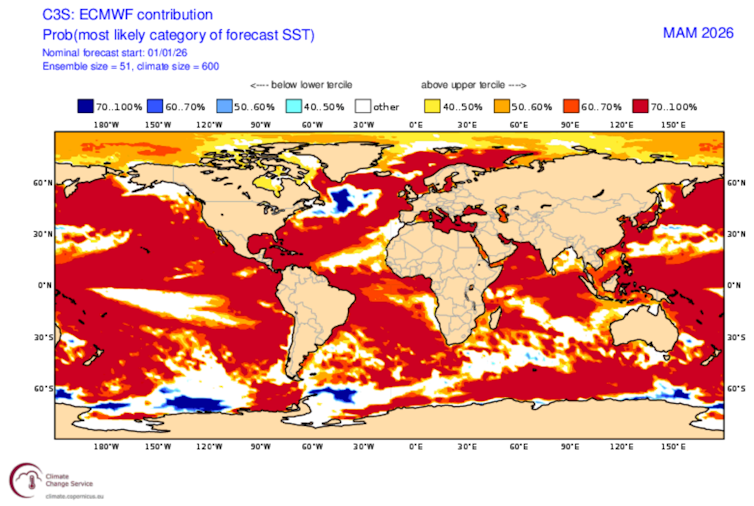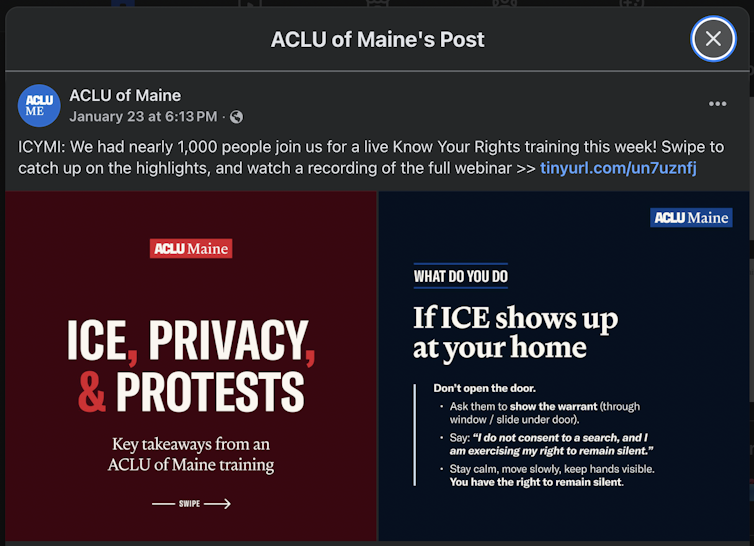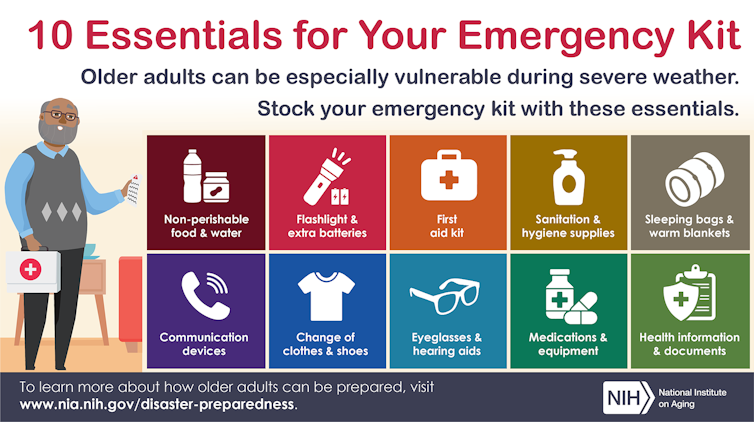Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ricardo Fernández Rafael, Investigador Predoctoral en Ocio, Cultura y Comunicación, Universidad de Deusto

Imagine entrar en su videojuego favorito y que cada personaje no jugable (NPC) le ofrezca una conversación única e improvisada a su medida. O que el juego ajuste la dificultad en tiempo real según detecte su frustración, calma o modo de jugar.
Escenarios así están dejando de ser ciencia ficción: gracias a los avances tecnológicos, la forma en la que jugamos se está transformando radicalmente. Casi uno de cada cinco juegos nuevos publicados en la plataforma Steam durante 2025 utiliza ya alguna forma de IA generativa.
De NPC predecibles a personajes que improvisan
La IA en videojuegos ha existido durante décadas para controlar el comportamiento de enemigos o aliados, pero seguía guiones rígidos o programas muy definidos. Ahora, con modelos generativos de lenguaje –similares a ChatGPT– los personajes no jugables pueden hablar e interactuar de forma mucho más libre y natural.
Un ejemplo reciente es Retail Mage (2024), un videojuego de rol (RPG) en el que se atiende una tienda mágica cuyos clientes son NPC impulsados por IA generativa. En lugar de limitarse a frases predefinidas, el jugador puede teclear cualquier consulta o respuesta y el personaje no jugable improvisa un diálogo coherente en tiempo real. Esto permite conversaciones insospechadas y situaciones cómicas o creativas: los desarrolladores reportan que las posibilidades y la experiencia se multiplican al no haber “líneas de diálogo” agotables o que puedan repetirse fácilmente.
Otro caso es Mecha BREAK (2025), un videojuego de disparos multijugador (shooter). En la gran feria del videojuego europea, la Gamescom de 2024, se mostró una versión piloto con un personaje no jugable que hablaba e interactuaba gracias a la IA. El jugador podía preguntarle libremente sobre la próxima misión y este respondía con consejos tácticos generados en ese mismo momento.
Mundos creados sobre la marcha
La IA generativa no solo da voz improvisada a personajes, también puede inventar historias, misiones y mundos enteros conforme jugamos.
AI Roguelite (2023) es un caso llamativo: se presenta como “el primer videojuego de rol de texto en el que la inteligencia artificial determina al 100 % cada ubicación, enemigo, objeto y mecánica”. En cada partida, el juego genera descripciones, escenarios, eventos e incluso imágenes y música diferentes usando modelos de IA. Los jugadores destacan la flexibilidad casi infinita de este enfoque: es posible vivir desde la épica clásica de caballeros contra dragones hasta disparatadas aventuras surrealistas, todo dependiendo de las entradas del usuario y la creatividad del modelo.
También hay proyectos híbridos que combinan contenido artesanal con generación por IA. Por ejemplo, Nyric permite crear mundos sandbox en 3D (entornos virtuales en los que el jugador tiene libertad para explorar, construir y modificar sin una línea argumental predefinida) a partir de simples descripciones de texto, usando la IA para rellenarlos y adaptarlos sobre la marcha. Imagine escribir “un bosque encantado bajo una noche estrellada” y ver cómo el juego construye un paisaje inmersivo que puede explorar.
Del mismo modo, inZOI utiliza IA para generar texturas y objetos únicos según indicaciones del usuario, y emplea pequeños modelos de lenguaje integrados para dotar de mayor “profundidad psicológica” a sus personajes no jugables. Es decir, estos no solo tienen diálogos diferentes en cada partida, sino que “piensan” y actúan con cierta autonomía simulando motivaciones más complejas.
Estos ejemplos muestran cómo la IA puede servir de director creativo auxiliar, produciendo narrativas y contenido que antes requerían mucho trabajo manual. Algunos estudios en 2016 ya auguraban esta posibilidad, señalando que los juegos con adaptación basada en el afecto podían modificar sus características “de forma dinámica para mejorar la inmersión y el desafío del jugador”. Ahora, con las herramientas generativas modernas, esa adaptabilidad se extiende a la creación de tramas y escenarios enteros en tiempo real.
Juegos que sienten
Otra faceta revolucionaria es la IA afectiva, aquella que mide y responde a las emociones del jugador. La premisa es sencilla: si jugar es una experiencia emocional, ¿por qué no hacer que el juego reaccione a cómo nos sentimos?
Un pionero en este campo ha sido Nevermind (2015), un juego de terror psicológico que utiliza biofeedback. Mediante un sensor de frecuencia cardíaca o la cámara, el sistema detecta el estrés y el miedo del jugador. Si nota que está demasiado tranquilo, incrementa la dificultad y los sustos para inducirle presión, y si detecta pánico puede aliviar la intensidad. En otras palabras, el juego nos observa y adapta la experiencia para mantenernos en esa franja óptima entre el aburrimiento y la ansiedad conocida como flow.

Nevermind/Flying Mollusk
Imaginemos títulos futuros que integren un lazo afectivo completo y logren involucrar emocionalmente al usuario. Por ejemplo, juegos de terror que calibren dinámicamente su atmósfera según nuestro miedo real, o aventuras narrativas que cambien la música, los diálogos o incluso el desenlace según detecten tristeza, frustración o euforia en el jugador.
Investigaciones recientes han demostrado que esto es viable. Así, se ha logrado clasificar el nivel de experiencia y compromiso de un jugador midiendo sus ondas cerebrales (EEG) con algoritmos de machine learning.
El jugador en el centro: dificultad y experiencias a medida
Más allá de las emociones, la IA está permitiendo adaptar juegos a las preferencias y estilo de cada jugador de formas inéditas. Durante años hemos visto sistemas básicos de ajuste de dificultad: desde elegir modo fácil/difícil hasta el “AI Director” de Left 4 Dead que modulaba la intensidad de los enemigos según nuestro desempeño.
La nueva generación de IA lleva esto mucho más lejos. Por ejemplo, MIR5, un videojuego de rol de acción de próximo lanzamiento, anunció que contará con “jefes finales” controlados por IA. Los jefes finales son los enemigos principales de un nivel o de la propia narrativa del juego. Estos personajes están diseñados para suponer un gran reto y suelen marcar momentos clave de la historia. En este caso, y gracias a la IA, aprenderán y se adaptarán a las tácticas del jugador, de forma que cada enfrentamiento sea personalizado y siempre constituya un desafío.
La personalización de contenidos es otra área en crecimiento. Si un jugador tiende a explorar mucho y hablar con todos los personajes, la IA podría detectar ese patrón y generarle más misiones narrativas; si otro prefiere la acción rápida, el juego podría ofrecerle combates adicionales u omitir diálogos extensos. De cierta manera, se podrá “perfilar” al jugador y presentar la versión de la historia más acorde a los gustos y comportamiento del usuario.
Diversos estudios académicos llevan tiempo trabajando en el modelado de los jugadores (player modeling) para identificar estas preferencias y estados óptimos de compromiso e interacción. La diferencia ahora es que el motor del juego podría reconfigurarse sobre la marcha gracias a la IA generativa.
Así, en el futuro se podrá ajustar a un modelo del jugador y no permanecer estático o enfocado en un número determinado de perfiles.
¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.
![]()
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. Cómo la inteligencia artificial está transformando los videojuegos – https://theconversation.com/como-la-inteligencia-artificial-esta-transformando-los-videojuegos-266198