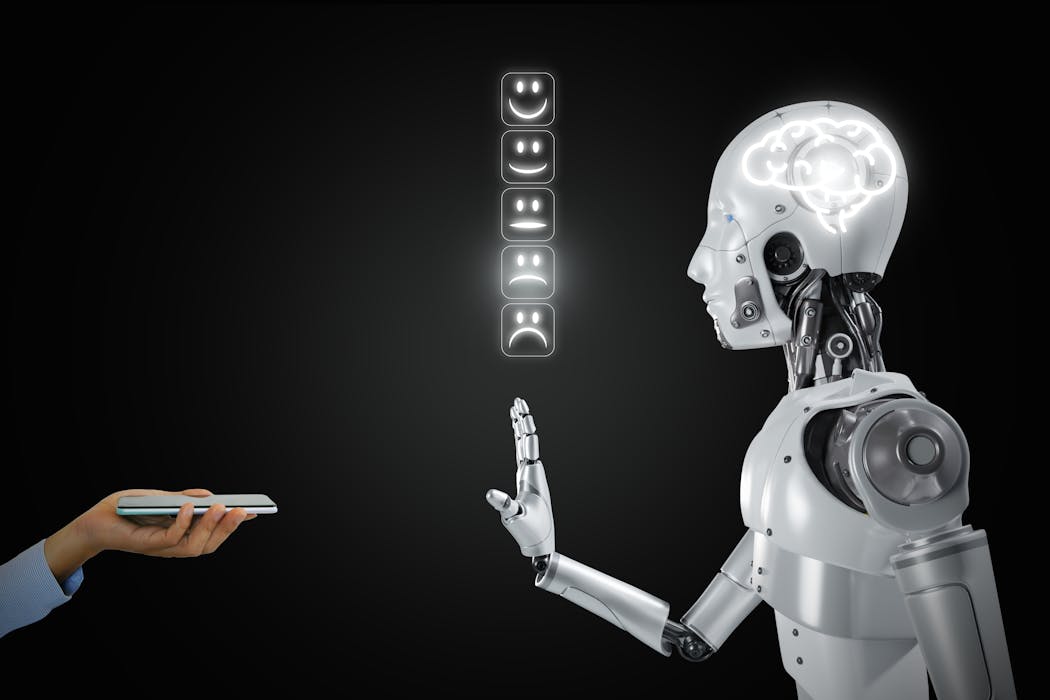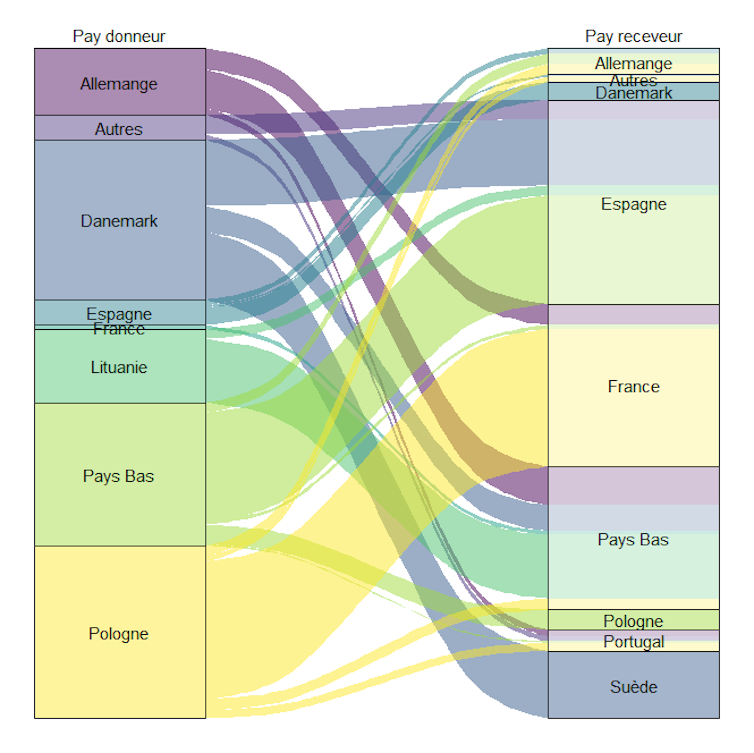Source: The Conversation – in French – By Mathilde Touvier, Directrice de l’Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inrae, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Cité, Université Paris Cité
Souvent trop sucrés, trop salés et trop caloriques, les aliments ultratransformés contiennent en outre de nombreux additifs, arômes et autres substances résultant de leurs modes de fabrication industriels. Or, les preuves des liens entre leur consommation et divers troubles de santé s’accumulent. Le point sur l’état des connaissances.
The Kraft Heinz Company, Mondelez International, Post Holdings, The Coca-Cola Company, PepsiCo, General Mills, Nestlé USA, Kellogg’s, Mars Incorporated et Conagra Brands… au-delà de leur secteur d’activité – l’agroalimentaire – et de leur importance économique, ces dix entreprises partagent désormais un autre point commun : elles sont toutes visées par une procédure judiciaire engagée par la Ville de San Francisco, aux États-Unis. Selon le communiqué de presse publié par les services du procureur de la ville David Chiu, cette plainte est déposée, car
ces sociétés « savai[en]t que [leurs] produits rendaient les gens malades, mais [ont] continué à concevoir et à commercialiser des produits de plus en plus addictifs et nocifs afin de maximiser [leurs] profits ».
Cette procédure survient quelques jours après la publication, dans la revue médicale The Lancet, d’un long dossier consacré aux effets des aliments ultratransformés sur la santé. Parmi les travaux présentés figure l’analyse approfondie de la littérature scientifique disponible sur ce sujet que nous avons réalisée.
Voici ce qu’il faut savoir des conséquences de la consommation de tels aliments, en tenant compte des connaissances les plus récentes sur le sujet.
Qu’appelle-t-on « aliments ultratransformés » ?
À l’heure actuelle, en France, on estime qu’en moyenne de 30 à 35 % des calories consommées quotidiennement par les adultes proviennent d’aliments ultratransformés. Cette proportion peut atteindre 60 % au Royaume-Uni et aux États-Unis. Si dans les pays occidentaux, les ventes de ces produits se sont stabilisées (quoiqu’à des niveaux élevés), elles sont en pleine explosion dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
Comme leur nom l’indique, les aliments ultratransformés sont des aliments, ou des formulations issues d’aliments, qui ont subi des transformations importantes lors de leur élaboration. Ils sont fabriqués de façon industrielle, selon une grande diversité de procédés (chauffage à haute température, hydrogénation, prétraitement par friture, hydrolyse, extrusion, etc.) qui modifient radicalement la matrice alimentaire de départ.
Par ailleurs, les aliments ultratransformés sont caractérisés dans leur formulation par la présence de « marqueurs d’ultra-transformation », parmi lesquels les additifs alimentaires destinés à en améliorer l’apparence, le goût ou la texture afin de les rendre plus appétissants et plus attrayants : colorants, émulsifiants, édulcorants, exhausteurs de goût, etc. À l’heure actuelle, 330 additifs alimentaires sont autorisés en France et dans l’Union européenne.
En outre, des ingrédients qui ne sont pas concernés par la réglementation sur les additifs alimentaires entrent aussi dans la composition des aliments ultratransformés. Il s’agit par exemple des arômes, des sirops de glucose ou de fructose, des isolats de protéines, etc.
En raison des processus de transformation qu’ils subissent, ces aliments peuvent également contenir des composés dits « néoformés », qui n’étaient pas présents au départ, et dont certains peuvent avoir des effets sur la santé.
Dernier point, les aliments ultratransformés sont généralement vendus dans des emballages sophistiqués, dans lesquels ils demeurent souvent conservés des jours voire des semaines ou mois. Ils sont aussi parfois réchauffés au four à micro-ondes directement dans leurs barquettes en plastique. De ce fait, ils sont plus susceptibles de contenir des substances provenant desdits emballages.
Les procédés possibles et les additifs autorisés pour modifier les aliments sont nombreux. Face à la profusion d’aliments présents dans les rayons de nos magasins, comment savoir si un aliment appartient à la catégorie des « ultratransformés » ?
Une classification pour indiquer le niveau de transformation
Un bon point de départ pour savoir, en pratique, si un produit entre dans la catégorie des aliments ultratransformés est de se demander s’il contient uniquement des ingrédients que l’on peut trouver traditionnellement dans sa cuisine. Si ce n’est pas le cas (s’il contient par exemple des émulsifiants, ou des huiles hydrogénées, etc.), il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un aliment ultratransformé.
La classification NOVA
Dans les années 2010, le chercheur brésilien Carlos Monteiro et son équipe ont proposé une classification des aliments fondée sur leur degré de transformation. Celle-ci comporte quatre groupes :
- les aliments pas ou peu transformés ;
- les ingrédients culinaires (sel, sucre, matières grasses animales et végétales, épices, poivre…) ;
- les aliments transformés combinant les deux premiers groupes ;
- les aliments ultratransformés.
Dans le groupe des aliments ultratransformés figurent par exemple les sodas, qu’ils soient sucrés ou édulcorés, les légumes assaisonnés de sauces contenant des additifs alimentaires, les steaks végétaux reconstitués ou les pâtisseries, les confiseries et barres chocolatées avec ajout d’additifs, les nouilles déshydratées instantanées, les yaourts édulcorés…
Saucisses et jambons, qui contiennent des nitrites, sont classés comme « aliments ultratransformés », tandis qu’une viande simplement conservée en salaison est considérée comme des « transformée ». De la même façon, les soupes liquides en brique préparées uniquement avec des légumes, des herbes et des épices sont considérées comme des « aliments transformés », alors que les soupes déshydratées, avec ajout d’émulsifiants ou d’arômes sont classées comme « aliments ultratransformés ».
Des aliments qui contiennent plus de sucre, plus de sel, plus de gras
Les aliments ultratransformés sont en moyenne plus pauvres en fibres et en vitamines que les autres aliments, tout en étant plus denses en énergie et plus riches en sel, en sucre et en acides gras saturés. En outre, ils pousseraient à manger davantage.
De nombreuses études ont également montré que les régimes riches en aliments ultratransformés étaient par ailleurs associés à une plus faible consommation d’aliments nutritionnellement sains et favorables à la santé.
Or, on sait depuis longtemps maintenant que les aliments trop sucrés, trop salés, trop riches en graisses saturées ont des impacts délétères sur la santé s’ils sont consommés en trop grande quantité et fréquence. C’est sur cette dimension fondamentale que renseigne le Nutri-Score.
Il faut toutefois souligner que le fait d’appartenir à la catégorie « aliments ultratransformés » n’est pas systématiquement synonyme de produits riches en sucres, en acides gras saturés et en sel. En effet, la qualité nutritionnelle et l’ultra-transformation/formulation sont deux dimensions complémentaires, et pas colinéaires.
Cependant, depuis quelques années, un nombre croissant de travaux de recherche ont révélé que les aliments ultratransformés ont des effets délétères sur la santé qui ne sont pas uniquement liés à leur qualité nutritionnelle.
Des effets sur la santé avérés, d’autres soupçonnés
Afin de faire le point sur l’état des connaissances, nous avons procédé à une revue systématique de la littérature scientifique sur le sujet. Celle-ci nous a permis d’identifier 104 études épidémiologiques prospectives.
Ce type d’étude consiste à constituer une cohorte de volontaires dont les consommations alimentaires et le mode de vie sont minutieusement renseignés, puis dont l’état de santé est suivi sur le long terme. Certains des membres de la cohorte développent des maladies, et pas d’autres. Les données collectées permettent d’établir les liens entre leurs expositions alimentaires et le risque de développer telle ou telle pathologie, après prise en compte de facteurs qui peuvent « brouiller » ces associations (ce que les épidémiologistes appellent « facteurs de confusion » : tabagisme, activité physique, consommation d’alcool, etc.).
Au total, 92 des 104 études publiées ont observé une association significative entre exposition aux aliments ultratransformés et problèmes de santé.
Les 104 études prospectives ont dans un second temps été incluses dans une méta-analyse (autrement dit, une analyse statistique de ces données déjà publiées), afin d’effectuer un résumé chiffré de ces associations.
Les résultats obtenus indiquent que la mortalité prématurée toutes causes confondues était l’événement de santé associé à la consommation d’aliments transformés pour lequel la densité de preuve était la plus forte (une vingtaine d’études incluses dans la méta-analyse).
Pour le formuler simplement : les gens qui consommaient le plus d’aliments ultratransformés vivaient en général moins longtemps que les autres, toutes choses étant égales par ailleurs en matière d’autres facteurs de risques.
Les preuves sont également solides en ce qui concerne l’augmentation de l’incidence de plusieurs pathologies : maladies cardiovasculaires, obésité, diabète de type 2 et dépression ou symptômes dépressifs.
La méta-analyse suggérait également une association positive entre la consommation d’aliments ultratransformés et le risque de développer une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (quatre études incluses).
En ce qui concerne les cancers, notamment le cancer colorectal, les signaux indiquant une corrélation potentielle sont plus faibles. Il faudra donc mener d’autres études pour confirmer ou infirmer le lien.
Des résultats cohérents avec les travaux expérimentaux
Au-delà de ces études de cohorte, ces dernières années, diverses études dites « interventionnelles » ont été menées. Elles consistent à exposer des volontaires à des aliments ultratransformés et un groupe témoin à des aliments pas ou peu transformés, afin de suivre l’évolution de différents marqueurs biologiques (sur une période courte de deux ou trois semaines, afin de ne pas mettre leur santé en danger).
C’est par exemple le cas des travaux menés par Jessica Preston et Romain Barrès, qui ont montré avec leurs collaborateurs que la consommation d’aliments ultratransformés entraînait non seulement une prise de poids plus importante que les aliments non ultratransformés, à calories égales, mais qu’elle perturbait aussi certaines hormones, et était liée à une baisse de la qualité du sperme.
Ces résultats suggèrent que ce type de nourriture serait délétère à la fois pour la santé cardiométabolique et pour la santé reproductive. Les résultats de plusieurs essais randomisés contrôlés menés ces dernières années vont dans le même sens. Cinq ont été répertoriés et décrits dans notre article de revue, et d’autres sont en cours.
Les aliments ultratransformés impactent donc la santé, et ce, très en amont du développement de maladies chroniques comme le diabète.
D’autres travaux expérimentaux, comme ceux de l’équipe de Benoît Chassaing, révèlent que la consommation de certains émulsifiants qui sont aussi des marqueurs d’ultra-transformation perturbe le microbiote. Elle s’accompagne d’une inflammation chronique, et a été associée au développement de cancers colorectaux dans des modèles animaux.
À lire aussi :
Comment le plastique est devenu incontournable dans l’industrie agroalimentaire
Rappelons que la majorité des additifs contenus dans les aliments ultratransformés n’ont pas d’intérêt en matière de sécurité sanitaire des aliments. On parle parfois d’additifs « cosmétiques », ce terme n’ayant pas de valeur réglementaire.
Ils servent uniquement à rendre les produits plus appétissants, améliorant leur apparence ou leurs qualités organoleptiques (goût, texture) pour faire en sorte que les consommateurs aient davantage envie de les consommer. Ils permettent aussi de produire à plus bas coût, et d’augmenter les durées de conservation.
Au-delà du principe de précaution
En 2019, à la suite de l’avis du Haut Conseil de la santé publique, le quatrième programme national nutrition santé (PNNS) introduisait pour la première fois la recommandation officielle de favoriser les aliments pas ou peu transformés et limiter les aliments ultratransformés, tels que définis par la classification NOVA.
À l’époque, cette recommandation se fondait sur un nombre relativement restreint de publications, notamment les premières au monde ayant révélé des liens entre aliments ultratransformés et incidence de cancers, maladies cardiovasculaires et diabète de type 2, dans la cohorte française NutriNet-Santé. Il s’agissait donc avant tout d’appliquer le principe de précaution.
Aujourd’hui, les choses sont différentes. Les connaissances accumulées grâce aux nombreuses recherches menées ces cinq dernières années dans le monde ont apporté suffisamment de preuves pour confirmer que la consommation d’aliments ultratransformés pose un réel problème de santé publique.
Dans le cadre de la cohorte NutriNet-Santé, nous avons, par exemple, désormais publié une douzaine d’articles montrant des liens entre la consommation d’émulsifiants, de nitrites, d’édulcorants ainsi que celle de certains mélanges d’additifs et une incidence plus élevée de certains cancers, maladies cardiovasculaires, d’hypertension et de diabète de type 2.
De potentiels « effets cocktails » ont également été suggérés grâce à un design expérimental mis en place par des collègues toxicologues. Des indices collectés lors de travaux toujours en cours suggèrent également que certains colorants et conservateurs pourraient eux aussi s’avérer problématiques. Rappelons en outre qu’en 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé l’aspartame comme « possiblement cancérigène » pour l’être humain (groupe 2B).
Le problème est que nous sommes exposés à de très nombreuses substances. Or, les données scientifiques concernant leurs effets, notamment sur le long terme ou lorsqu’elles sont en mélange, manquent. Par ailleurs, tout le monde ne réagit pas de la même façon, des facteurs individuels entrant en ligne de compte.
Il est donc urgent que les pouvoirs publics, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes, s’emparent de la question des aliments ultratransformés. Mais par où commencer ?
Quelles mesures prendre ?
Comme souvent en nutrition de santé publique, il est nécessaire d’agir à deux niveaux. Au niveau du consommateur, le cinquième programme national nutrition santé, en cours d’élaboration, devrait pousser encore davantage la recommandation de limiter la consommation d’aliments ultratransformés.
Il s’agira également de renforcer l’éducation à l’alimentation dès le plus jeune âge (et la formation des enseignants et des professionnels de santé) pour sensibiliser les publics à cette question.
En matière d’information des consommateurs, l’étiquetage des denrées alimentaires joue un rôle clé. La première urgence reste de rendre obligatoire le Nutri-Score sur l’ensemble des produits, comme cela est plébiscité par plus de 90 % de la population française, d’après Santé publique France. Les citoyennes et citoyens ont leur rôle à jouer en ce sens, en signant la pétition sur le site de l’Assemblée nationale.
À ce sujet, soulignons que des évolutions du logo Nutri-Score sont envisagées pour mieux renseigner les consommateurs, par exemple en entourant de noir le logo lorsqu’il figure sur des aliments appartenant à la catégorie NOVA « ultratransformé ». Un premier essai randomisé mené sur deux groupes de 10 000 personnes a démontré que les utilisateurs confrontés à un tel logo nutritionnel sont nettement plus à même d’identifier si un produit est ultratransformé, mais également que le Nutri-Score est très performant lorsqu’il s’agit de classer les aliments selon leur profil nutritionnel plus ou moins favorable à la santé.
Il est également fondamental de ne pas faire porter tout le poids de la prévention sur le choix des consommateurs. Des modifications structurelles de l’offre de nos systèmes alimentaires sont nécessaires.
Par exemple, la question de l’interdiction de certains additifs (ou d’une réduction des seuils autorisés), lorsque des signaux épidémiologiques et/ou expérimentaux d’effets délétères s’accumulent, doit être posée dans le cadre de la réévaluation de ces substances par les agences sanitaires. C’est en particulier le cas pour les additifs « cosmétiques » sans bénéfice santé.
Les leviers économiques
Au-delà de la réglementation liée à la composition des aliments ultratransformés, les législateurs disposent d’autres leviers pour en limiter la consommation. Il est par exemple possible de réguler leur marketing et de limiter leur publicité, que ce soit à la télévision, dans l’espace public ou lors des événements sportifs, notamment.
Ce point est d’autant plus important en ce qui concerne les campagnes qui ciblent les enfants et les adolescents, particulièrement vulnérables au marketing. Des tests d’emballage neutre – bien que menés sur de petits effectifs – l’ont notamment mis en évidence.
Autre puissant levier : le prix. À l’instar de ce qui s’est fait dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, il pourrait être envisageable de taxer les aliments ultratransformés et ceux avec un Nutri-Score D ou E et, au contraire, de prévoir des systèmes d’incitations économiques pour faire en sorte que les aliments les plus favorables nutritionnellement, pas ou peu ultratransformés, et si possible bio, soient les plus accessibles financièrement et deviennent les choix par défaut.
Il s’agit aussi de protéger les espaces d’éducation et de soin en interdisant la vente ou la distribution d’aliments ultratransformés, et en y améliorant l’offre.
Il est également fondamental de donner les moyens à la recherche académique publique, indemne de conflits d’intérêt économiques, de conduire des études pour évaluer les effets sur la santé des aliments industriels. Ce qui passe par une amélioration de la transparence en matière de composition de ces produits.
Un manque de transparence préjudiciable aux consommateurs
À l’heure actuelle, les doses auxquelles les additifs autorisés sont employés par les industriels ne sont pas publiques. Lorsque les scientifiques souhaitent accéder à ces informations, ils n’ont généralement pas d’autre choix que de faire des dosages dans les matrices alimentaires qu’ils étudient.
C’est un travail long et coûteux : lors de nos travaux sur la cohorte NutriNet-Santé, nous avons dû réaliser des milliers de dosages. Nous avons aussi bénéficié de l’appui d’associations de consommateurs, comme UFC-Que Choisir. Or, il s’agit d’informations essentielles pour qui étudie les impacts de ces produits sur la santé.
Les pouvoirs publics devraient également travailler à améliorer la transparence en matière de composition des aliments ultratransformés, en incitant (ou en contraignant si besoin) les industriels à transmettre les informations sur les doses d’additifs et d’arômes employées, sur les auxiliaires technologiques utilisés, sur la composition des matériaux d’emballages, etc. afin de permettre l’évaluation de leurs impacts sur la santé par la recherche académique.
Cette question de la transparence concerne aussi l’emploi d’auxiliaires technologiques. Ces substances, utilisées durant les étapes de transformation industrielle, ne sont pas censées se retrouver dans les produits finis. Elles ne font donc pas l’objet d’une obligation d’étiquetage. Or, un nombre croissant de travaux de recherche révèle qu’en réalité, une fraction de ces auxiliaires technologiques peut se retrouver dans les aliments.
C’est par exemple le cas de l’hexane, un solvant neurotoxique utilisé dans l’agro-industrie pour améliorer les rendements d’extraction des graines utilisées pour produire les huiles végétales alimentaires.
Le poids des enjeux économiques
Le manque de transparence ne se limite pas aux étiquettes des aliments ultratransformés. Il est également important de vérifier que les experts qui travaillent sur ces sujets n’ont pas de liens d’intérêts avec l’industrie. L’expérience nous a appris que lorsque les enjeux économiques sont élevés, le lobbying – voire la fabrique du doute – sont intenses. Ces pratiques ont été bien documentées dans la lutte contre le tabagisme. Or, les aliments ultratransformés génèrent des sommes considérables.
Enjeux économiques
- Entre 2009 et 2023, les ventes mondiales sur le marché des aliments ultratransformés sont passées de 1 500 milliards de dollars à 1 900 milliards de dollars (en dollars américains constants de 2023, à prix constants ; soit environ de 1 290 milliards à 1 630 milliards d’euros), principalement tirés par la croissance rapide des ventes dans les pays à faible et moyen revenu ;
- Entre 1962 et 2021, plus de la moitié des 2 900 milliards de dollars (environ 2 494 milliards d’euros aujourd’hui) versés aux actionnaires par les entreprises opérant dans les secteurs de la production alimentaire, de la transformation, de la fabrication, de la restauration rapide et de la vente au détail, l’ont été par les fabricants de produits ultratransformés.
Cependant, si élevés que soient ces chiffres, les découvertes scientifiques récentes doivent inciter la puissance publique à prendre des mesures qui feront passer la santé des consommateurs avant les intérêts économiques.
Il s’agit là d’une impérieuse nécessité, alors que l’épidémie de maladies chroniques liées à la nutrition s’aggrave, détruit des vies et pèse de plus en plus sur les systèmes de santé.

Mathilde Touvier a reçu des financements publics ou associatifs à but non lucratif de l’European Research Council, l’INCa, l’ANR, la DGS…
Bernard Srour a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche (ANR), de INRAE et de l’Institut national du cancer (INCa) dans le cadre de ses recherches. Il a reçu des honoraria dans le cadre d’expertises ou de présentations scientifiques de la part de l’American Heart Association, l’European School of Oncology, et de la Danish Diabetes and Endocrine Academy.
– ref. Aliments ultratransformés : quels effets sur notre santé et comment réduire notre exposition ? – https://theconversation.com/aliments-ultratransformes-quels-effets-sur-notre-sante-et-comment-reduire-notre-exposition-271447

![]()