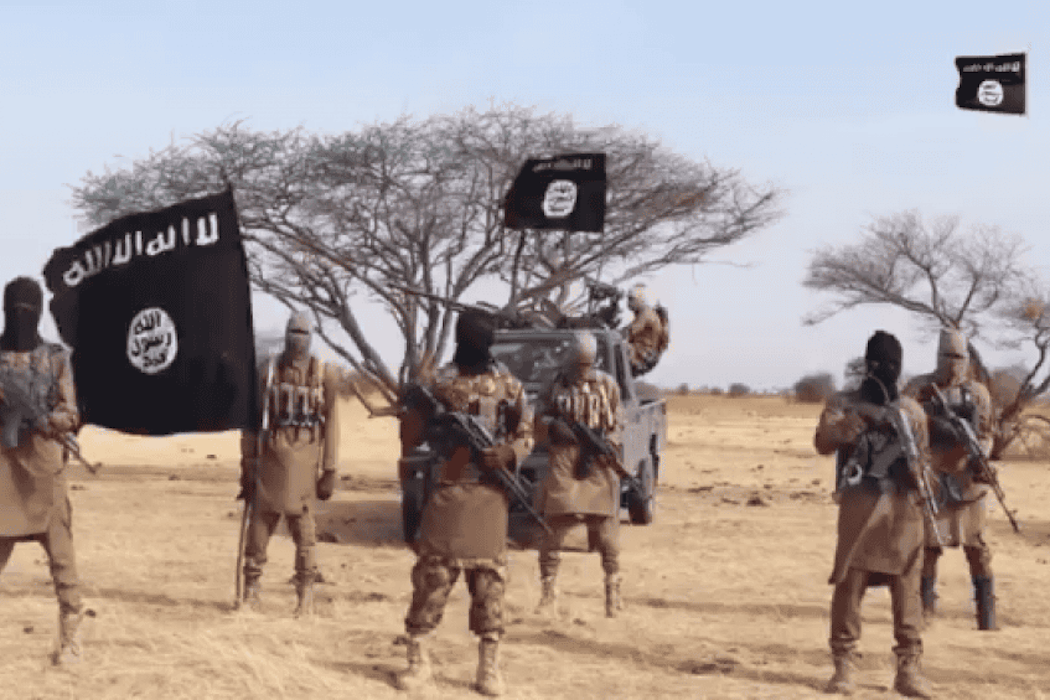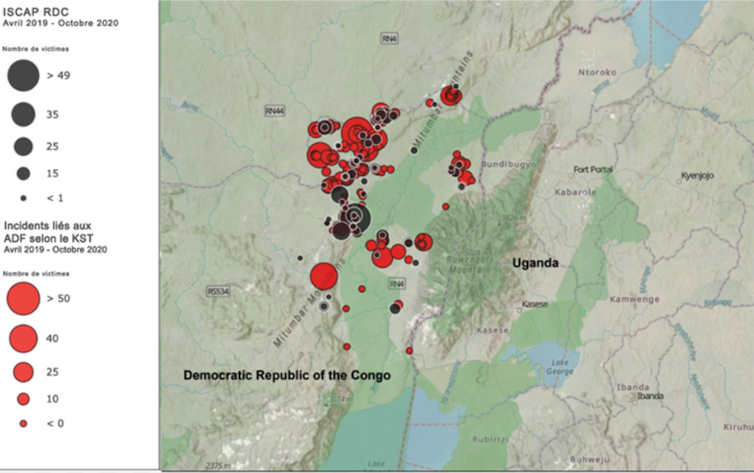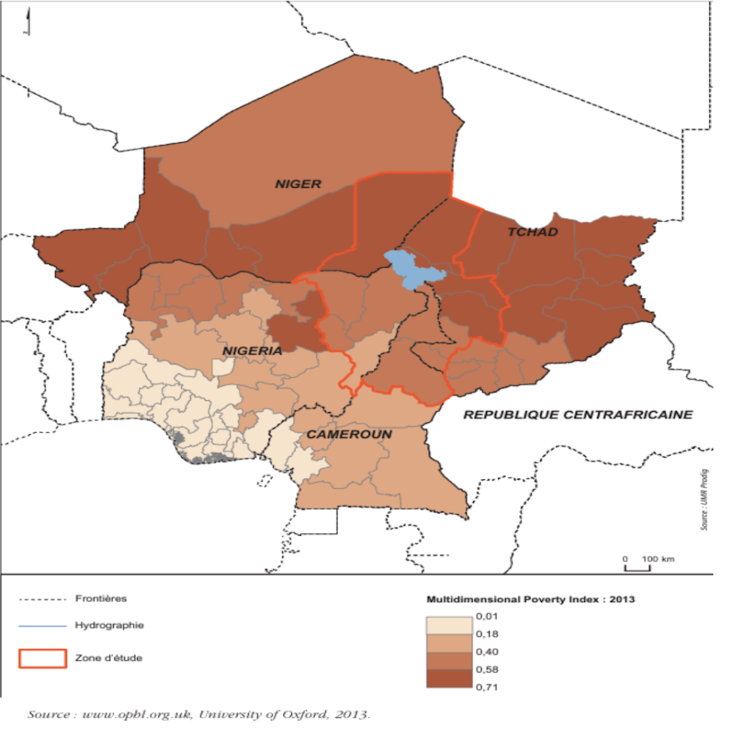Source: The Conversation – (in Spanish) – By Nísia Trindade Lima, Ministra da Saúde, de janeiro de 2023 a fevereiro de 2025; presidente da Fiocruz, de 2017 a 2022, e pesquisadora titular da Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Las pandemias agravan las desigualdades y las desigualdades hacen que las sociedades sean más vulnerables a las pandemias. Esta es la conclusión principal del informe publicado en noviembre por el Consejo Global sobre Desigualdades, Sida y Pandemias, vinculado al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA).
El documento muestra que las desigualdades no solo son el resultado de las crisis sanitarias, sino que contribuyen a que estas sean más frecuentes, letales y prolongadas. Las pruebas recopiladas revelan un círculo vicioso: las desigualdades internas y globales aumentan la vulnerabilidad de las sociedades. Y las pandemias refuerzan esas mismas desigualdades, una dinámica que se observa en emergencias como las de la covid-19, el VIH/sida, el ébola, la influenza y el mpox.
Mi participación en este foro, coordinado por Joseph Stiglitz, Monica Geingos, Michael Marmot y Winnie Byanyima, contribuyó a expresar la visión de Brasil y a reflexionar con otros países sobre los retos que tenemos por delante.
Los datos del informe señalan que, en el caso de la covid-19, alrededor de 165 millones de personas se vieron empujadas a la pobreza entre 2020 y 2023, mientras que la fortuna de los más ricos creció un 27,5 % en los primeros meses de la pandemia. Con contribuciones de diversos especialistas, el documento refuerza la urgencia de abordar las raíces sociales de las crisis sanitarias.
Menos recursos, más probabilidades de morir
Los determinantes sociales de la salud son uno de los ejes principales del informe. La educación, los ingresos, la vivienda y las condiciones ambientales definen los grupos más afectados por las emergencias.
En Brasil, según el informe de ONUSIDA, las personas sin educación básica tenían hasta tres veces más probabilidades de morir por covid-19 que aquellas con educación superior. Las poblaciones negras, indígenas y residentes en favelas y periferias también registraron tasas más altas de infección y mortalidad. Casos similares se repitieron en otros países. Según los datos, la densificación urbana y las viviendas superpobladas aumentaron las muertes en Inglaterra.
Acceso a las vacunas
Las desigualdades entre países también aumentan las vulnerabilidades. Cuando los países de bajos ingresos no tienen acceso a vacunas, diagnósticos o recursos fiscales, todo el planeta se expone a riesgos. En 2021, solo diez países concentraban el 75 % de las dosis administradas contra la covid-19, lo que dejó al mundo entero susceptible al surgimiento de variantes.
Seis meses después de la aprobación de las vacunas, los países de ingresos altos tenían dosis suficientes para cubrir al 90 % de sus poblaciones prioritarias, mientras que los países de bajos ingresos solo tenían suficientes para inmunizar al 12 % de esos grupos.
El informe de ONUSIDA estima que esta desigualdad puede haber causado 1,3 millones de muertes evitables. En contraste con la práctica del llamado nacionalismo vacunal, el concepto de seguridad sanitaria se redefine a partir de una interdependencia radical, que debe reflejar una coordinación de la preparación para ampliar el acceso. La descentralización de la investigación y el desarrollo y de la producción e innovación de productos sanitarios son partes esenciales de este proceso.
Gestión desastrosa
Brasil fue uno de los países más afectados por la covid-19. En marzo de 2022, concentraba el 10,7 % de las muertes, a pesar de representar el 2,7 % de la población mundial. Una proporción cuatro veces superior a la media mundial.
Esto no se debió solo al virus, sino a la desastrosa gestión de la pandemia, que desalentó las medidas preventivas, retrasó acciones como la compra de vacunas, difundió desinformación y negacionismo científico, y aún debe ser profundamente revisada para pensar en la rendición de cuentas.
Si una región no está segura frente a una amenaza sanitaria, ninguna lo estará. Ante estas constataciones, el informe de ONUSIDA enfatiza que las respuestas sensibles a la desigualdad, con acciones intersectoriales y comunitarias, son más eficaces que las estrategias exclusivamente biomédicas para romper el ciclo.
Recomendaciones
Prepararnos para futuras emergencias requiere sistemas de salud resilientes, una gestión cualificada e inversiones continuas en políticas sociales, ciencia, tecnología e innovación. Hoy en día se reconoce que fortalecer la producción local y regional de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos y otros suministros es una vía esencial para garantizar el acceso a los recursos sanitarios.
El informe de ONUSIDA plantea algunas recomendaciones en este sentido. La primera es hacer frente a las barreras financieras globales, con propuestas como la renegociación de la deuda de los países vulnerables y mecanismos automáticos de financiación de emergencias, evitando políticas de austeridad que reduzcan el gasto social.
La segunda es invertir en los determinantes sociales: protección social, educación, vivienda, trabajo decente y reducción de las desigualdades regionales. Fortalecer la producción local de tecnologías sanitarias, tratando los conocimientos esenciales como bienes públicos y, de acuerdo con lo establecido en la Declaración de Doha de 2001, entendiendo que el derecho a la propiedad intelectual no puede prevalecer sobre el derecho a la salud y a la vida, es la tercera recomendación.
Y por último, pero no menos importante, es necesario construir una gobernanza multisectorial que integre al Estado, la ciencia, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil.
A partir de 2023, la reanudación de las políticas sociales permitió a Brasil participar en la construcción de este entendimiento expresado en el informe. El fortalecimiento del Sistema Único de Salud, con la recuperación de la cobertura vacunal, el fortalecimiento del Complejo Económico-Industrial de la Salud, la Atención Primaria y la Atención Especializada, junto con el fortalecimiento de programas sociales, entre otras acciones, reducen las vulnerabilidades.
Solidaridad global para romper el ciclo de desigualdad-pandemia
La política exterior brasileña actúa en el mismo sentido: en el G20, en el BRICS y en la COP30. El país defendió acciones integradas entre el clima, la salud y las desigualdades, además de iniciativas como la Alianza Global contra el Hambre y la Coalición Global para la Producción Local y Regional, la Innovación y el Acceso Equitativo, así como el fortalecimiento del Acuerdo sobre Pandemias de la OMS.
Los debates recientes del G20, incluidos los cumbre de noviembre en Sudáfrica, muestran avances en el reconocimiento de temas centrales del informe, especialmente en lo que respecta a la deuda, la producción regional y las desigualdades.
Pasos como estos son importantes para avanzar en las recomendaciones estructurales del documento, poniendo en la agenda la deuda de los países y su canje por inversiones en salud, la protección social y la revisión del actual sistema de propiedad intelectual, entre otros temas. Hay dificultades en este camino, como la ausencia de Estados Unidos en el Acuerdo sobre Pandemias y la persistencia del negacionismo científico, que está presente no solo en sectores de la población, sino también en las políticas públicas de algunos países.
Romper el ciclo de desigualdad-pandemia es un imperativo ético y práctico para garantizar la seguridad sanitaria mundial. La dimensión biológica de las pandemias es evidente, pero las dimensiones social, política y fiscal siguen siendo subestimadas. Ignorar las desigualdades es perpetuar los riesgos de futuras emergencias sanitarias e impedir que enfermedades como el sida y la tuberculosis sean finalmente superadas.
El mundo tiene una oportunidad decisiva, con los resultados de la COP30 y las agendas en curso en el G20 y la OMS. El informe pone de manifiesto que invertir en equidad genera resiliencia y que la omisión tiene un alto precio, tanto en la economía como, sobre todo, en vidas humanas.
Necesitamos solidaridad global y compromiso con los avances sociales, a fin de transformar las economías y hacer efectiva la salud para todos, antes de que una nueva pandemia nos recuerde, una vez más, los costes de la inacción.
![]()
Nísia Trindade Lima no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Las desigualdades agravan las pandemias y viceversa: ¿cómo podemos romper este círculo vicioso? – https://theconversation.com/las-desigualdades-agravan-las-pandemias-y-viceversa-como-podemos-romper-este-circulo-vicioso-272143