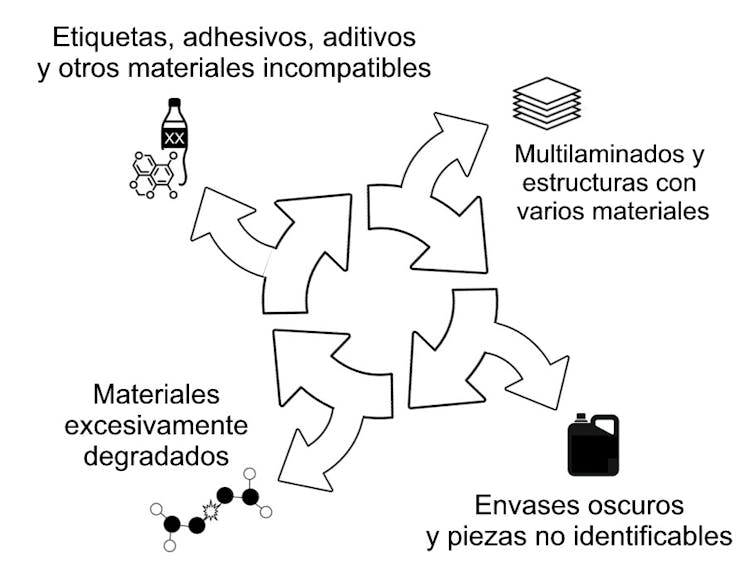Source: The Conversation – in French – By Sébastien Le Gall, Professeur des Universités en Stratégie et Management, Université Bretagne Sud (UBS)
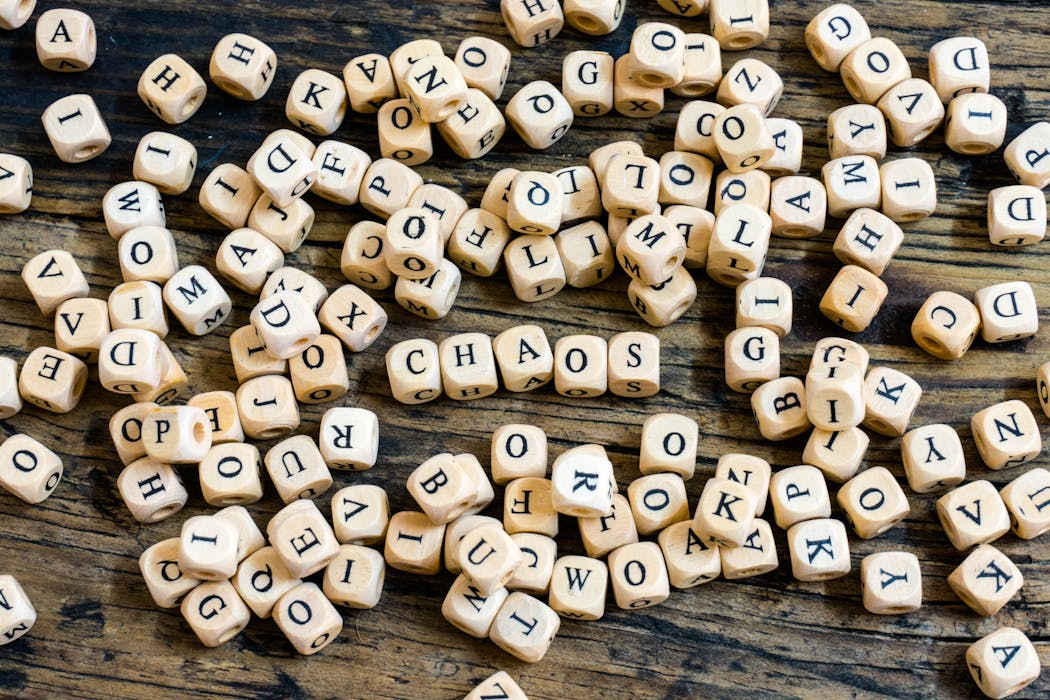
En temps de crise, de guerre ou de pandémie, les entreprises n’ont d’autres choix que d’apprendre à danser dans un chaos permanent en s’adaptant. C’est le principe du « chaos management ». Pour autant, en 2025, des entrepreneurs, comme Elon Musk ou Mark Zukerbeg, le galvaudent avec une montée de l’autoritarisme et des licenciements massifs. Une préfiguration d’un nouveau « KO management » ?
Le chaos management a été popularisé par le consultant en management Tom Peters en 1988. Le constat énoncé par l’auteur pour en justifier la pertinence garde toute son actualité. « Plus rien n’est prévisible. Il est impossible de prévoir d’un jour à l’autre le prix de l’énergie […] de savoir si le protectionnisme entraînera la fermeture des frontières. »
Le chaos a un homophone qui nécessite de préciser son sens quand on l’applique au management. « Les leaders créent le chaos sur les lieux de travail » titre le journal Forbes en 2025. Le chaos management peut alors s’apparenter à un « KO (knock-out) management » : licenciements massifs avec une communication agressive, pression maximale et autoritarisme.
Les nouvelles tendances du chaos management seraient-elles désormais marquées par le culte du chef, la violence des propos et des actes des leaders, une forme de KO pour les collectifs ?
Cet article vise à analyser les principes du chaos management tels que présentés par Tom Peters. Nous avons étudié le cas de l’entreprise bretonne Socomore pour rendre compte de ce qui la distingue du « KO management » en revenant aux fondamentaux du management, à savoir la nécessité d’interroger les valeurs.
Principes du chaos management
Dans les années 1990, des chercheurs en management, comme Margaret Wheatkey, Ralph Stacey ou Kevin Dooley, se sont inspirés des enseignements de la théorie du chaos en reconnaissant les caractères chaotiques, incertains, dynamiques des entreprises et de leur environnement.
Le consultant Tom Peters a largement contribué à diffuser une pensée managériale « chaotique », fondée sur le changement permanent et l’adaptation. Les principes managériaux énoncés pour y faire face sont les suivants :
-
une réponse obsessionnelle aux besoins et attentes des clients,
-
une innovation constante dans tous les domaines de l’entreprise,
-
un esprit de partenariat entre tous pour gagner une totale adhésion aux objectifs,
-
chez les dirigeants, une passion du changement (au lieu d’un rejet acharné) et une capacité à rallier les individus autour d’une vision inspiratrice,
-
des tableaux de bord simples mais capables d’assurer un pilotage efficace.
Le chaos management dans l’entreprise Socomore
« Le principe même du chaos, c’est d’arriver à déclencher des actions qui permettent à tout système de ne jamais s’arrêter. Le but du jeu, c’est que la bille roule tout le temps. Dès que tu sens que la bille va perdre de la vitesse, tu organises quelque chose qui va permettre de maintenir le mouvement. »
Selon Frédéric Lescure, président de Socomore, une entreprise spécialisée dans la chimie, le chaos n’est pas funeste pour l’entreprise, mais bénéfique. Les données l’attestent. En vingt-cinq ans, le chiffre d’affaires de l’entreprise bretonne a été multiplié par plus de 20. Parmi les facteurs clés de succès : l’innovation.
Chaque pilier recensé par Tom Peters apparaît dans le projet stratégique et les pratiques managériales de Socomore. L’impératif d’innovation passe par la « capacité à être perçue par nos partenaires, nos clients, comme étant fiables pour qu’eux-mêmes optimisent leur impact carbone », rappelle Frédéric Lescure. Le partage est défendu comme un principe clé de la création de valeur : « On a accouché, dans le bonheur, de notre cinquième plan stratégique. Les gens qui sont présents, ce n’est pas que du hiérarchique, c’est du transversal, des experts. »
Laurent Sanchez souligne le rôle essentiel de Frédéric Lescure dans la croissance de Socomore : « L’ambition d’un homme est no limit. Tout est possible, sans altérer son intégrité physique, physiologique et psychlologique. » Et conformément aux recommandations de Tom Peters, le pilotage repose sur des indicateurs clés. « Les KPI que l’on doit se choisir doivent être des indicateurs simples. Des indicateurs qui mettent plus d’une demi-heure à être calculés, on ne les choisira pas », précise Frédéric Lescure.
Les dérives du KO management
Au sein de Socomore, le chaos management est essentiellement du ressort du président qui porte une attention « à ne jamais être là où on (l’)attend ». Cette pratique managériale peut être mal comprise et apparaître touchy.
La rupture actuelle du point de vue du management vient du fait que le chaos peut mettre à mal les collaborateurs. Il émane moins de l’environnement de l’entreprise que des dirigeants qui provoquent des perturbations pour servir des objectifs stratégiques principalement financiers et asseoir leur pouvoir. Selon le chercheur Laurent Taskin, ces logiques sont à la source d’un management déshumanisé qui implique « une dégradation importante de l’exercice même du travail, l’affaiblissement des liens sociaux entre collègues, la perte du sens au travail ».
Les provocations d’Elon Musk sont régulières et conduisent aux départs des collaborateurs, par exemple au sein des équipes dirigeantes de X. D’autres prises de position, celles de Mark Zukenberg, président-directeur général de Meta, considérant les vertus de « l’agressivité », ont pu interroger.
À lire aussi :
Dérives masculinistes de Zuckerberg et de Musk : le numérique en mâle de virilité ?
Les formes de leadership mobilisées peuvent se révéler « destructives » selon la chercheuse Leïla Lakhdhdar : supervision abusive, leadership tyrannique, leadership intolérable, etc. Être chef ne signifie pas être manager !
À l’extrême, la chercheuse Isabelle Barth a mis en évidence un système, la kakistocratie, où la promotion par l’incompétence est la règle. Si le chaos n’est alors pas une intention managériale du dirigeant, le KO de ses équipes devient en revanche très probable.
Leadership congruent
Rappelons que le management a une mission essentielle, celle « de faire produire du résultat à collectif » comme l’explique le chercheur Maurice Thévenet. À ce titre, les valeurs incarnées par le dirigeant sont essentielles. « Le chaos management tel que je le pratique, il est plutôt chez Patagonia ou chez Gore. Un des principes fondateurs du chaos, c’est la congruence », précise Frédéric Lescure, le président de Socomore. Ce besoin de leadership congruent apparaît essentiel pour instaurer un climat de confiance.
Cela suppose « d’agir en homme de pensées et penser en homme d’action », indique Laurent Sanchez. Ce leadership s’appuie sur un alignement entre une vision, des valeurs et les pratiques managériales. Si la vision stratégique est basée essentiellement sur la croissance, les valeurs reposent sur le respect et le partage. Et la qualité des pratiques managériales est reconnue. En décembre 2025, Socomore est lauréate du prix QVT de l’Observatoire de la qualité de vie au travail.
Cette capacité à embarquer le collectif a été testée pendant la pandémie de Covid-19 où l’entreprise Socomore a basculé en un temps record son organisation vers la production de gel hydroalcoolique. « Le système Socomore est fait de telle façon qu’il a pu répondre à cela. Ce qui a été dur, c’est l’intensité et la coordination, mais elle s’est faite. » Dans des temps désormais plus sereins, Frédéric Lescure perçoit en définitive une condition pour la réussite du chaos management : « Le management par le chaos exige un environnement stable. »
![]()
Sébastien Le Gall ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Quand le chaos management se distingue du KO management – https://theconversation.com/quand-le-chaos-management-se-distingue-du-ko-management-257411