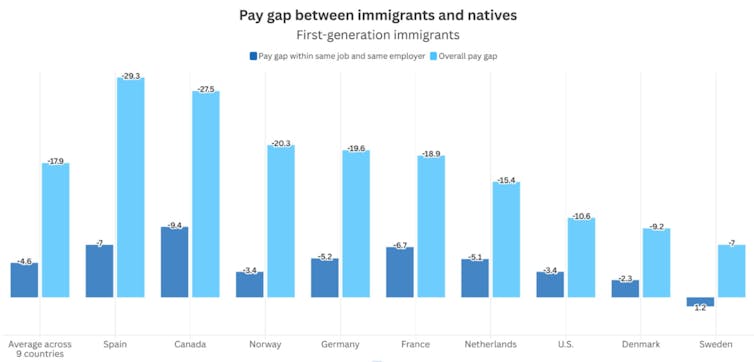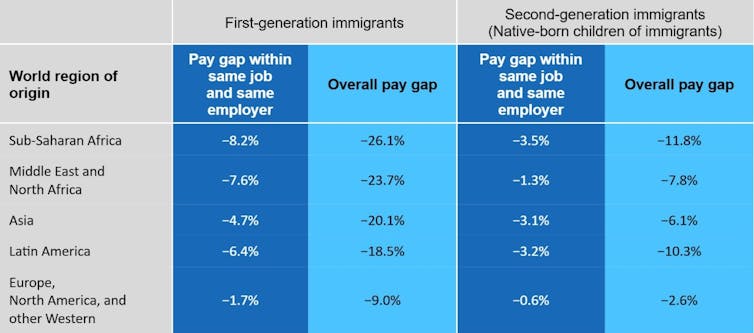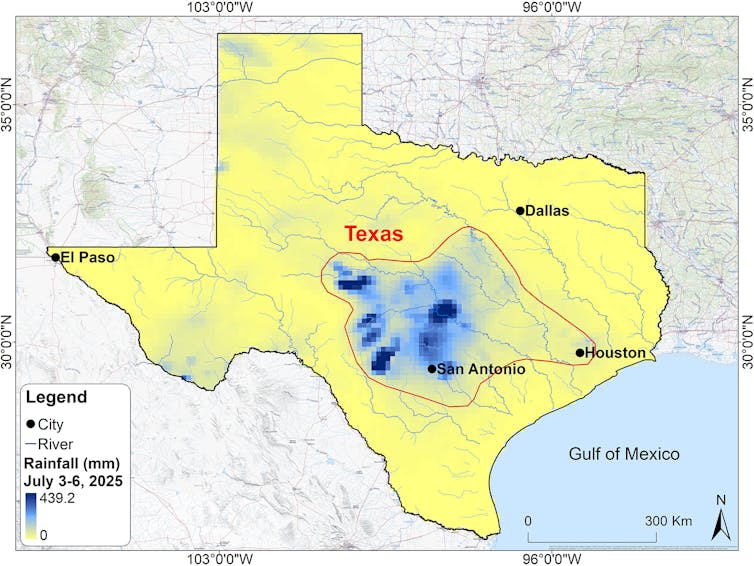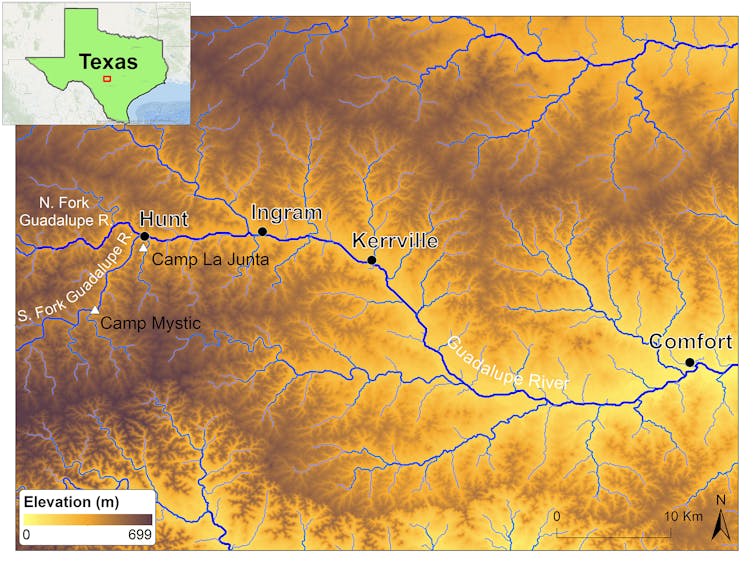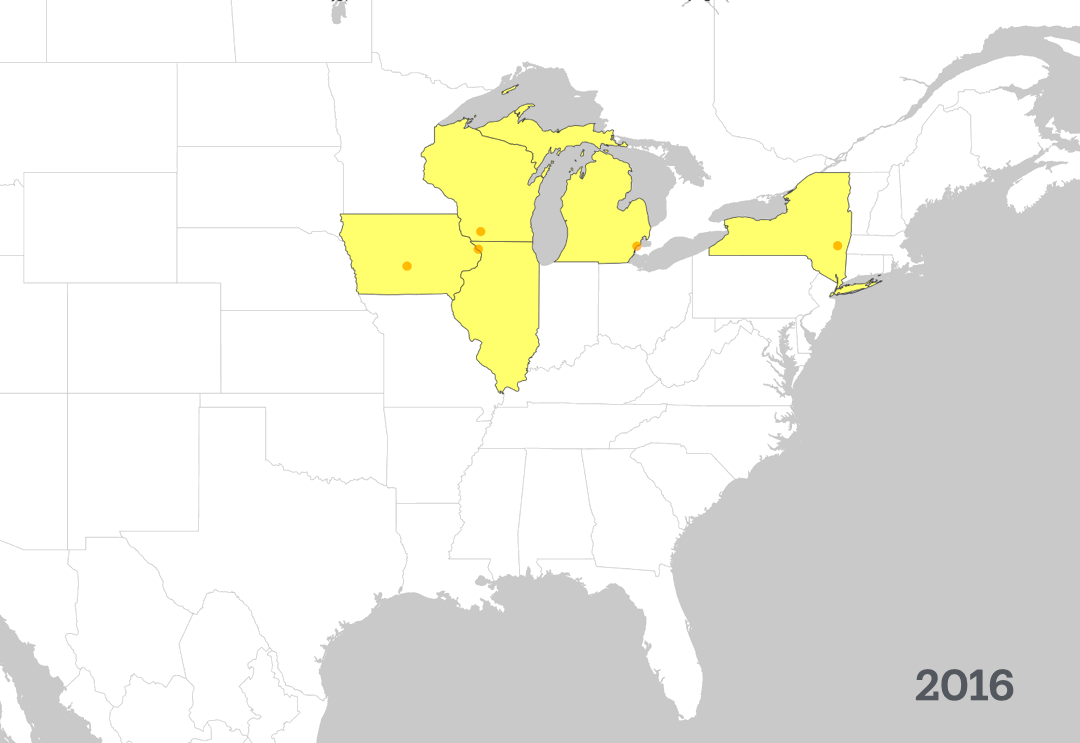Source: The Conversation – France (in French) – By Sandrine Stervinou, Professeur Associé, Audencia
Galapiat, une compagnie de cirque contemporain basée en Bretagne, a délaissé le statut d’association pour celui de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Comment réussir ce changement de gouvernance ? En créant de nouvelles pratiques managériales.
Le cirque contemporain, narratif, engagé et inspiré de diverses disciplines artistiques, tient une place non négligeable dans notre pays. Les compagnies se sont multipliées, leur nombre passant de 15 à 600 en 40 ans. Elles complètent l’offre du cirque traditionnel, généralement familial et sous chapiteau – Bouglione, Arlette Gruss ou Pinder. Ces troupes proposent des spectacles dans lesquels les artistes s’emparent de questions de société et font appel tout autant à la raison… qu’aux émotions des spectateurs.
Dans ce monde du cirque contemporain, Galapiat Cirque a piqué notre intérêt, car la compagnie est considérée comme atypique grâce à sa taille, son succès et sa longévité. Le modèle de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) lui a permis de développer une activité commerciale tout en préservant l’esprit collaboratif. Galapiat Cirque est une référence en Bretagne, la région qui l’a accueilli il y a près de 20 ans. La compagnie offre de 100 à 160 représentations par an, avec un budget avoisinant les 800 000 € et un collectif de 37 membres-associés.
A la suite d’une première rencontre avec son administrateur en 2015, peu de temps après que Galapiat Cirque soit devenu une SCIC, nous avons voulu comprendre le choix du modèle coopératif et son impact sur le succès de la compagnie. À partir de quinze entretiens et de la participation à différentes réunions, nous avons publié une étude de cas. Elle permet d’identifier les leçons à tirer pour les organisations culturelles qui choisiraient ce modèle de gouvernance.
Société coopérative d’intérêt collectif
« Les coopératives sont des acteurs clés dans la préservation et le développement du patrimoine culturel mondial. Elles offrent de bonnes conditions de travail, la possibilité […] de transmettre notre patrimoine aux générations futures de manière durable et inclusive », rappelle Iñigo Albuzuri, président de l’Organisation internationale des coopératives de production industrielle, d’artisanat et de services (CICOPA).
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) est un modèle hybride alliant mission sociale, non lucrativité et activité commerciale. Divers acteurs – salariés, usagers, associations, collectivités locales, partenaires privés – peuvent détenir des parts sociales de l’entreprise pour en devenir membres-associés. Ce statut leur permet de participer aux grandes décisions de l’organisation selon le principe « une personne (morale ou physique), une voix ».
Les bénéfices doivent majoritairement être mis en réserves impartageables pour soutenir la structure – à hauteur d’au minimum 57,4 %. Souvent, ils le sont à 100 % sur décision des membres-associés. Certains commentateurs y voient le croisement entre la coopérative, la société commerciale et l’association. Créé en 2001, ce statut attire régulièrement de nouveaux candidats. En 2024, on compte 417 SCIC en France, employant plus de 15 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros.
Les SCIC culturelles, elles, restent rares. Selon le site des SCIC, elles représentent, en 2024, seulement 8,5 % des coopératives, en comptant les SCIC dans le domaine sportif. Pourtant dès 2015, l’État a encouragé leur création, notamment dans le cadre d’évènements tels que les forums « entreprendre dans la culture ».
Pourquoi l’association Galapiat Cirque a-t-elle fait le choix de la SCIC et avec quel impact ?
Pas de chef
Galapiat Cirque a été créé sous forme associative en 2006 par six artistes fraîchement sortis du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) à Châlons-en-Champagne, l’une des trois grandes écoles de cirque françaises. Ces cinq hommes et une femme, venus de pays et d’horizons différents, rêvent d’un spectacle collectif itinérant. Allant à l’encontre de l’avis de leurs professeurs, ils se lancent dans la création de leur premier spectacle sans metteur en scène. Ce sont les prémisses du principe du « pas de chef ».
À lire aussi :
La coopérative, un modèle d’innovation sociale et écologique
Si le succès artistique et financier est rapidement au rendez-vous pour le spectacle Risque Zéro, le statut associatif montre, lui, ses limites. Chacun des six artistes veut pouvoir affirmer sa propre voix et créer les spectacles qui lui ressemblent. Chaque projet se gère indépendamment, avec son propre budget. En cas de déficit, c’est le bureau de l’association – président, secrétaire et trésorier – qui en assume la responsabilité. Or, comme souvent dans les associations, les personnes du bureau sont assez éloignées du cœur de l’activité. Avec la croissance, la situation se tend pour l’équipe administrative qui prend des décisions sans en avoir la légitimité, créant un sentiment d’inconfort voire de mal-être.
« C’est un des paradoxes du milieu culturel : on est tous sous forme associative, alors que la plupart du temps, les associations sont totalement fantoches […]. J’ai l’impression que la forme SCIC a changé des choses, en tout cas a accéléré ce processus de légitimation des salariés. […] Une tentative de faire coller la forme à la réalité le plus possible » souligne un associé de Galapiat.
Après une longue période de gestation ponctuée de nombreuses rencontres et discussions, le statut de SCIC est finalement adopté en 2015.
Décider collectivement
Choisir le statut SCIC structure la vision du projet de cirque collectif. Il permet de donner une voix identique à tous les membres – sont membres ceux qui ont pris au minimum une part sociale, d’un montant symbolique de 25 euros. Selon l’administrateur de la compagnie, le projet est avant tout motivé par la volonté d’entériner un fonctionnement le plus démocratique possible, en prenant en compte l’ensemble des avis, les positions de toutes les personnes investies – soit trente-sept membres.
Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Chaque lundi, recevez gratuitement des informations utiles pour votre carrière et tout ce qui concerne la vie de l’entreprise (stratégie, RH, marketing, finance…).
Les artistes approchant ou dépassant la quarantaine, l’envie de transmettre, d’accompagner de jeunes compagnies, de partager et de se sédentariser se fait sentir. Un groupe de travail, composé de volontaires (artistes et administratifs) se met à la recherche d’un lieu. Au bout de trois ans, un lieu atypique a été proposé, discuté et validé en assemblée générale.
« On aura pris une décision collective. Et oui, ça prend du temps. Alors c’est imparfait, hein ? Cette recherche permanente de trouver un chemin commun à 37 est unique. C’est vraiment pour ça que je suis chez Galapiat en fait. Aujourd’hui, plus que pour le cirque en fait » estime un des salariés-associés
« Statut n’est pas vertu »
Se structurer en coopérative ne garantit pas une participation réelle de tous à la prise de décision et à l’absence de chef. « Statut n’est pas vertu. » Pour éviter la concentration de pouvoir et favoriser le partage des responsabilités, la SCIC étudiée a établi une co-gérance tournante à trois personnes, chaque membre devenant co-gérant à un moment donné pour une durée de trois ans.
« L’idée est de ne pas tout mettre sur les épaules d’une personne. C’est mon interprétation de la raison pour laquelle on a décidé de passer sur une co-gérance tournante » rappelle un artiste-associé
Au quotidien, les co-gérants sont aidés par le Groupement d’Accompagnement à la Gérance (GAG), groupe de six volontaires nommés pour un an renouvelable. Il se réunit chaque mois et gère la vie coopérative : organisation des Assemblées générales (AG), lien avec les structures partenaires, questions juridiques, relations avec les associés, etc. Il assume également la responsabilité d’employeur et mène, par exemple, les entretiens annuels des salariés.
Trois bonnes pratiques managériales
Dans les fondamentaux de la coopérative circassienne, on trouve la volonté de faire vivre le collectif, d’assurer une juste rémunération des salariés, d’incarner au maximum les valeurs coopératives et de s’engager dans l’environnement local et la défense du milieu culturel.
La SCIC reprend les trois bonnes pratiques managériales qui ont fait leurs preuves en coopérative : la clarification de l’organisation, la co-gérance, la co-contruction du projet. Mais, elle va plus loin, cherchant l’équilibre entre partage du pouvoir et des responsabilités, incitant chaque membre à en prendre une part équitable, au nom du collectif.
Cet art de la coopération permet d’éviter la dégénérescence des coopératives, souvent présentée comme inéluctable. Galapiat Cirque garde une vision optimiste et continue d’imaginer des futurs organisationnels désirables tout en ayant une vision lucide des risques que le collectif doit affronter. Comme ils le disaient il y a 20 ans, dans le cirque, le risque zéro n’existe pas.
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Comment le cirque réimagine la coopération ? – https://theconversation.com/comment-le-cirque-reimagine-la-cooperation-258421