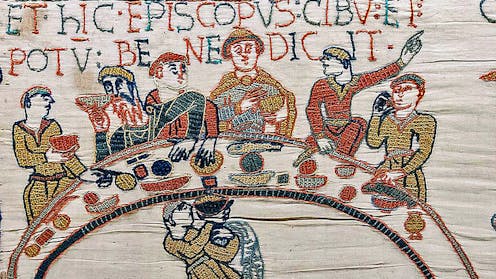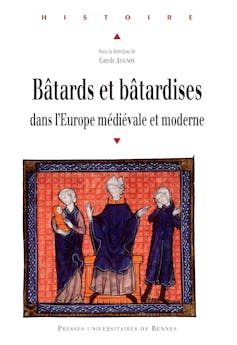Source: The Conversation – France in French (3) – By Mélissa Mialon, Inserm, Université Paris Cité
Maladies rares, cancers, VIH, troubles « dys » de l’enfant… dans différents domaines de la santé, la recherche participative permet une collaboration fructueuse entre des scientifiques et des citoyens concernés par la thématique étudiée. Cette approche innovante, qui se développe notamment à l’initiative de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), ambitionne de rapprocher la société civile et le monde de la recherche académique.
La recherche participative dans le domaine de la santé progresse petit à petit en France. Afin de développer cette manière de faire recherche, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), au travers de son service « Sciences et Société », a organisé une journée sur cette thématique en juin 2024 à Lyon.
L’objectif était de favoriser les interactions entre le monde de la recherche scientifique et la société civile, de présenter des projets de recherche participative déjà en cours à l’Inserm, et de susciter l’émergence de nouveaux projets. Un des ateliers thématiques de la journée portait sur « Comment créer des échanges fructueux entre Sciences et Société ? » Voici quelques-unes des réflexions qui en ont émané.
Impliquer société civile, recherche académique et pouvoirs locaux
La recherche participative est une approche reposant sur l’implication active, à chaque étape du processus de recherche, de citoyens concernés par la problématique explorée. Elle valorise les savoirs issus de l’expérience et vise à créer un dialogue entre les chercheurs et les autres citoyens afin de co-construire des savoirs et des actions.
La recherche participative implique différents acteurs, tels que :
-
la société civile, en particulier les populations concernées par la question de recherche ;
-
la recherche académique ;
-
les pouvoirs publics locaux, afin d’assurer une mise en pratique concrète.
La participation citoyenne s’exerce tout au long du processus de recherche : identification de la problématique, collecte et analyse des données, diffusion des résultats et éventuelle existence du collectif après la fin du projet.
Une approche avec des retombées parfois concrètes
Dans la pratique quotidienne, les savoirs et méthodes des différents acteurs peuvent diverger, ce qui favorise un apprentissage mutuel. Chacun s’enrichit des connaissances et expériences des autres. Cela contribue ainsi à une production de savoirs plus ancrée dans les réalités sociales.
Les retombées de cette approche sont parfois très concrètes. Caroline Huron, chercheuse à l’Inserm, mène ainsi une recherche-action participative avec des enfants dyspraxiques et leurs familles, étudiant par exemple la qualité de vie des parents.
La chercheuse a même créé une association, « Le cartable fantastique », « pour concevoir des ressources pédagogiques adaptées aux enfants dyspraxiques ».
Démocratiser la science
La participation citoyenne répond à certains problèmes (d’environnement, de santé publique, etc.) par des approches transdisciplinaires et inclusives. La diversité des perspectives favorise l’émergence d’idées nouvelles et de solutions inédites.
La recherche participative participe à la démocratisation de la science en rendant le savoir plus accessible et en facilitant l’appropriation des résultats par les acteurs concernés. Elle permettrait ainsi, dans l’idéal, de favoriser l’inclusion des populations marginalisées dans les processus de décision. Inscrite dans une démarche éthique, elle met l’accent sur le bien-être collectif et une science plus ouverte.
Recrutement, engagement, temps : les défis à relever
Mener une recherche participative nécessite une gestion attentive des relations de pouvoir et une réelle volonté de collaboration. Divers défis peuvent ainsi se présenter en cours de route :
-
le recrutement : un des défis importants en matière de recherche participative concerne le recrutement des citoyens-chercheurs. La recherche participative ne doit pas être élitiste, là où il peut être difficile d’atteindre certains groupes d’individus ;
-
l’engagement : un autre défi, plus insidieux, est l’épuisement et la démobilisation des citoyens. Lorsqu’on sollicite intensément des participants sans reconnaissance adéquate (financière, symbolique ou professionnelle), cela peut créer une lassitude et réduire leur engagement sur le long terme. Or, parfois, les financements disponibles ne sont pas mobilisables à cette fin, pour des questions juridiques – la recherche participative ne peut pas se traduire en contrat de travail pour le citoyen – ou sont insuffisants pour une indemnisation ;
-
le temps : les délais et démarches pour l’établissement des conventions, ou encore l’approbation éthique concernant l’aspect participatif des projets, représentent également des barrières à l’implication citoyenne.
En somme, il est nécessaire d’imaginer de nouvelles formes de rapprochement permettant d’aller vers les personnes qui ne connaissent pas la recherche, ou vers les chercheurs qui ne sont pas sensibilisés à la recherche participative, en organisant des formations adéquates sur ce sujet.
Faire connaissance pour faciliter la recherche participative
Il est important que les chercheurs soient accessibles et prennent le temps de découvrir les acteurs de la société civile, pas seulement pour des raisons lucratives (obtention de financements), mais également afin d’être à l’écoute des besoins de chacun. Un des moyens d’apprendre à se connaître passe par l’organisation de rencontres fréquentes, au travers des visites de laboratoire, d’évènements où les associations peuvent se présenter, ou même de ciné-débats.
Ces rencontres multiples doivent se tenir dans des lieux publics, sans hégémonie de savoir (mairies, bibliothèques, maisons de quartier), où chacun se sente légitime d’entrer. Les boutiques des sciences, par exemple, ont vocation à créer ce type de rapprochement. Ces rencontres aussi doivent conduire à une meilleure connaissance et reconnaissance de l’expertise de l’autre, un des piliers nécessaires à la co-construction de projets de recherche participative.
Appels à projets et autres modes de financement
Il faut souligner que les financeurs européens de la recherche incitent à la participation de la société civile dans les projets. En France, plusieurs dispositifs de financement soutiennent cette approche de la recherche : des plates-formes de financement participatif ou bien des services et appels à projets comme au sein de l’Inserm. De plus, des appels à projets sont lancés par des organismes publics comme l’Agence Nationale de la Recherche pour encourager l’implication citoyenne dans la recherche. Toutefois, le financement de ces initiatives demeure souvent limité (en nombre de projets lauréats) et plus modeste que celui des recherches classiques.
Les projets de recherche participative voient parfois le jour à l’initiative des chercheurs : c’est le cas de l’étude sur la constitution d’une cohorte de patients atteints de polypose adénomateuse, une maladie rare qui se caractérise par le développement d’adénomes (ou tumeurs bénignes) dans le côlon, le rectum, puis le duodénum, qui induisent un risque majeur de cancer du côlon.
Ils peuvent aussi émaner des citoyens. Chercheur en neurosciences cognitives, Guillaume Sescousse raconte ainsi une expérience de recherche participative avec des collégiens, à l’initiative d’un de ses amis :
« Mon impact a été plus fort en une journée de recherche participative qu’avec mon dernier article », rapporte-t-il.
On citera aussi les recherches de Marie Préau concernant l’identification de troubles cognitifs qui impactent le quotidien de personnes souffrant d’un cancer du sein, également autour du partage du diagnostic par les personnes séropositives.
Enfin, les projets peuvent être coconstruits, comme pour la recherche participative menée par Caroline Huron avec les familles d’enfants dyspraxiques mentionnée plus haut.
Une dérive possible : minimiser la parole citoyenne
Le premier écueil sur lequel la vigilance des chercheurs ne devrait faiblir à aucun moment est l’instrumentalisation des citoyens. En effet, l’effort et le temps que représente l’apprentissage de l’approche participative peuvent mener l’équipe de recherche à abaisser le degré de participation citoyenne dans la prise de décision.
Cette minimisation de la parole citoyenne est souvent symptomatique d’une hiérarchisation des savoirs à laquelle il faut prêter attention, pour ne pas rompre la confiance des citoyens.
Il apparaît aussi crucial de se soucier de l’appropriation des résultats par la société et donc de leur traduction : la rencontre entre la recherche et la société civile fait inévitablement émerger de nouveaux questionnements, voire une certaine urgence à y répondre. Une relation chercheur – citoyen de qualité, comme précisé plus haut, nécessite du temps. Il est donc d’importance de pérenniser le partenariat pour rapprocher durablement ces deux mondes.
Il existe une pluralité de façons de faire de la recherche participative, et une pluralité de degrés de participation. De ce fait, cette approche peut ne pas revêtir exactement la même définition pour l’ensemble de la communauté scientifique.
Avec les garde-fous énoncés dans cet article, nous imaginons la recherche participative comme l’opportunité unique d’une autre contribution de la science à la société, et de la société à la science.
Elsa Bombrun, ingénieure agronome, a également participé à la rédaction de cet article.
![]()
Jean-Michel Escoffre est trésorier de Centre-Sciences. Il a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche, l’Inserm, l’université de Tours, la Région Centre-Val de Loire, la Ligue contre le cancer.
Virginie Hamel a reçu des financements des Fonds de Recherche en Santé du Québec (FRQS).
Claudie Lemercier, Elsa Bombrun, Houda El Azzaoui et Mélissa Mialon ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
– ref. Recherche participative en santé : rapprocher les citoyens et les scientifiques au sein de projets de recherche – https://theconversation.com/recherche-participative-en-sante-rapprocher-les-citoyens-et-les-scientifiques-au-sein-de-projets-de-recherche-258100