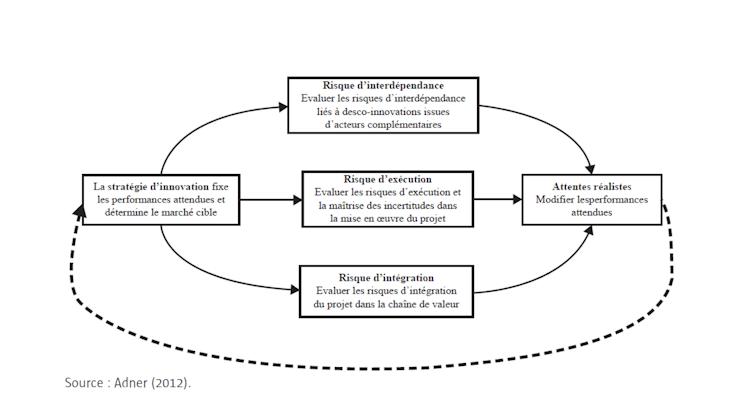Source: The Conversation – UK – By Amy Wilcockson, Research Fellow, English Literature, Queen Mary University of London
Last year marked 250 years since the birth of the English novelist Jane Austen. The Conversation celebrated this important literary milestone with a series of articles and a dedicated podcast, Jane Austen’s Paper Trail. This special year saw a variety of high-profile celebratory events across the country, from regency balls and film screenings, to special tours and literary talks.
But literary anniversaries are not just limited to famous and well-loved authors, however significant. Many dates pass us by unmarked, despite the fact that we are in the midst of a golden era of key dates of literary significance.
The 2020s has been a decade of major Romantic-period milestones, including the bicentenaries of the deaths of the poets John Keats (2021), Percy Bysshe Shelley (2022), and Byron (2024). Last year’s Austen anniversary was particularly notable because the writer was so widely and enthusiastically celebrated.
Yet it also was the centenary year of F. Scott Fitzgerald’s jazz-age classic The Great Gatsby, alongside Virginia Woolf’s modernist favourite Mrs Dalloway. Brideshead Revisited by Evelyn Waugh, George Orwell’s Animal Farm and Nancy Mitford’s The Pursuit of Love all turned 80, while children’s classic The Lion, The Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis celebrated its 75th birthday.
Celebrating in 2026
In 2026 there is another slew of big anniversaries, marking the tercentenary of Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels, and 200 years since the ever-relevant Mary Shelley’s The Last Man (her 1826 novel about the near extinction of humanity after a global plague) was first released.
A.A. Milne’s Winnie-the-Pooh first indulged in his favourite “hunny” in 1926, and it was the start of Agatha Christie’s reign as queen of crime, as the immensely popular The Murder of Roger Ackroyd captured the public imagination.
Fifty years later her last novel, Sleeping Murder, was published posthumously, after her death on January 12 1976. Special re-issues of Christie’s books, new audiobook recordings, lectures, conferences, Netflix adaptations, and even a major British Library exhibition have been organised to celebrate some of these momentous literary milestones.
Anne Rice’s Interview with a Vampire, which reshaped the genre with a more complex, nuanced portrayal of the archetypal character, also celebrates 50 years since its 1976 publication.
But why do we celebrate literary anniversaries? Why do museums, academics and the public rush to commemorate our favourite authors? And why do some authors receive more celebration than others?
First, literary anniversaries are significant as they create a shared sense of heritage and a feeling of unity within communities and cultures. As Shakespeare scholars Monika Smialkowska and Edmund G.C. King observed when considering the Bard’s many anniversary celebrations: “Each event has also been an occasion for the community commemorating him to celebrate itself.”
In 2016, when British and global audiences commemorated the 400th anniversary of Shakespeare’s death, gala concerts, special coins and exhibitions were the tip of the iceberg. Shakespeare represents to many the pinnacle of British culture and many believe his plays are vital as they allow us to examine ourselves and our place in the world.
General historical events don’t seem to capture the public imagination in the same way. And of course, major authors like Shakespeare and Austen become universal. They are not just a symbol of British culture, their fame and embodiment of “Britishness” have gone global. Shakespeare has been recognised by and claimed as a part of American, European, African and wider global contexts.
For instance, the Jane Austen Society of Aotearoa New Zealand celebrated its tenth anniversary last year. Marking anniversaries allow us to build connections not just with the time period or world that the author has built, but with fellow enthusiasts through shared interests in particular genres, texts and authors. We celebrate not just the writers, but our own personal, national and global networks and cultures too.
Nostalgia and literary tourism
Literary anniversaries are also a prime example of nostalgia – of thinking that a place, event or period from the past is preferable to the present. Rituals such as anniversary celebrations are the physical embodiment of this feeling.
This is why enthusiasts dress up in the costumes of the Regency period or in military attire – to transport themselves back to a less complex time, perhaps. By reading an author’s books, visiting their house, and seeing the quills and pens with which they wrote, visitors are similarly invited to step back into the past and into the writer’s world.
It is no surprise then that literary museums put on huge events to mark particularly important author milestones. Literary tourism is growing, with Travel Weekly noting that Austen tourism in particular is – obviously – popular at the moment.
While final visitor figures have not yet been released, a spokesperson for the Jane Austen’s House museum stated that they expected to have surpassed their usual annual 40,000 visitors in 2025.
These anniversaries are of course a global draw, with entire marketing campaigns built around significant dates. For example, 2017 was not only coined by Visit Britain as a Year of Literary Heroes, but an interactive Magical Britain campaign and map were also launched to celebrate 20 years since the the first Harry Potter book.
Anniversaries of popular books and authors boost the local and national economy as visitors flood to visit locations from the author’s writings, as well as their birthplaces, homes and graves.
But why do some authors stick in the public imagination more than others? Author and academic H.J. Jackson notes in her book on Romantic reputations that recognition usually begins with a collected edition of the author’s work, before interest develops into biographies, translations and adaptations. The texts become taught in schools, societies are named in the author’s honour, and then finally anniversary celebrations commence to celebrate their great achievements.
According to Jackson, authors need to win over different audiences to be successful and gain worldwide renown. Given their solid and wide-reaching appeal, I have little doubt we will still be celebrating Keats, Austen, Orwell and Christie in a hundred years’ time.
Looking for something good? Cut through the noise with a carefully curated selection of the latest releases, live events and exhibitions, straight to your inbox every fortnight, on Fridays. Sign up here.
![]()
Amy Wilcockson does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
– ref. Why we love literary anniversaries – https://theconversation.com/why-we-love-literary-anniversaries-273375