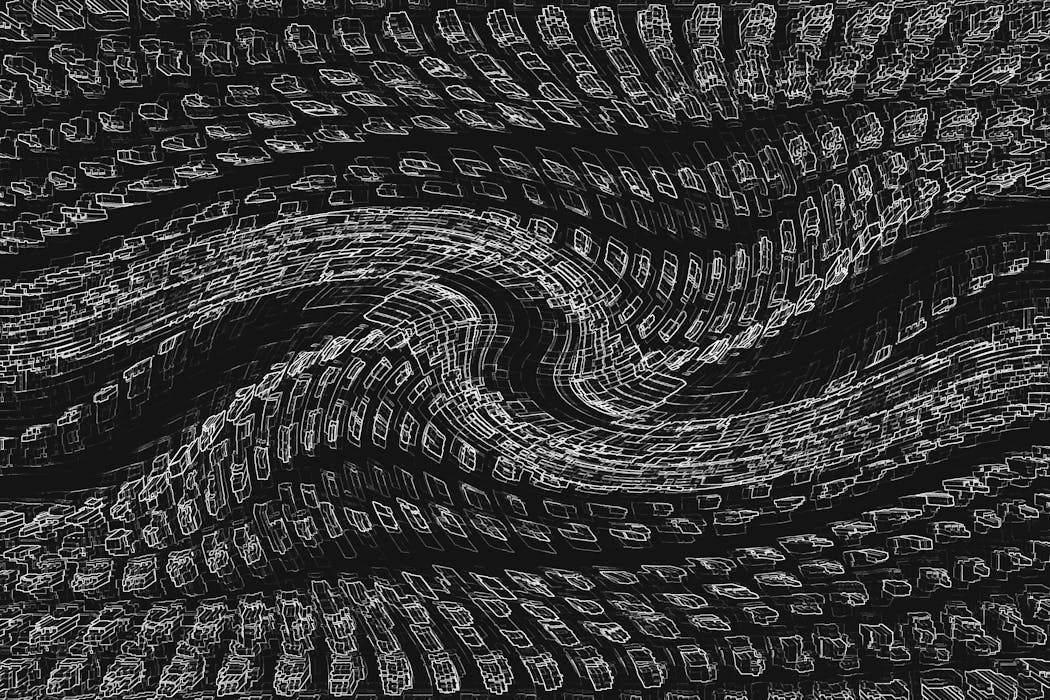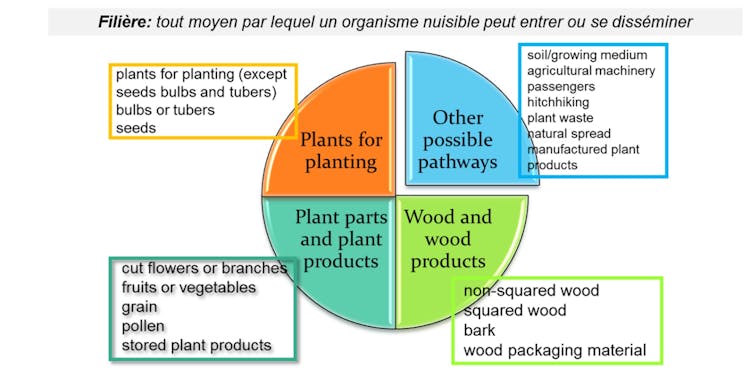Source: The Conversation – in French – By Jean-Ignace Olazabal, Responsable de programmes, Université de Montréal
Les personnes âgées de 65 ans et plus (environ 2 250 000 personnes en 2033) représenteront 25 % de la population du Québec au début des années 2030, les enfants du baby-boom composant dès lors la presque totalité de la population aînée.
Le taux de mortalité augmentera cela dit progressivement à partir de 2036, avec plus de 100 000 décès par année, et dépassera de loin le nombre de naissances, maintenant le Québec dans un contexte de post-transition démographique qui pourrait provoquer un déclin de la population globale.
Quoi qu’il en soit, l’augmentation de la longévité prévue fera que ces nouveaux vieux, les enfants du baby-boom, seront plus nombreux à devenir octogénaires et nonagénaires que ceux des générations précédentes. En effet, les 80+ pourraient représenter près de 8 % de la population en 2033, alors que l’espérance de vie prévue par Statistique Canada sera de 82 ans pour les hommes et de 86 ans pour les femmes.
Il est clair que la balise 65+ n’est plus la même qu’il y a 50 ans, et que la vieillesse est désormais un cycle de vie long, avec les enjeux et défis que cela comporte. Or, paradoxe remarquable, alors que le Québec figure au palmarès des sociétés où l’espérance de vie est la plus haute, elle est également celle où la demande d’aide médicale à mourir est la plus importante.
Anthropologue de la vieillesse et du vieillissement, je suis responsable de la formation en vieillissement à la Faculté de l’apprentissage continu (FAC) de l’Université de Montréal et je m’intéresse aux aspects sociaux du vieillissement des enfants du baby-boom au Québec.
Cet article fait partie de notre série La Révolution grise. La Conversation vous propose d’analyser sous toutes ses facettes l’impact du vieillissement de l’imposante cohorte des boomers sur notre société, qu’ils transforment depuis leur venue au monde. Manières de se loger, de travailler, de consommer la culture, de s’alimenter, de voyager, de se soigner, de vivre… découvrez avec nous les bouleversements en cours, et à venir.
Des vieux nouveaux genres ?
Si le baby-boom est un phénomène démographique englobant les personnes nées entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 1960, il est convenu, ici comme en France ou aux États-Unis, de réserver le nom baby-boomers aux personnes nées entre 1946 (1943 au Québec) et 1958.
Dans son livre intitulé Le fossé des générations, publié en 1971, l’anthropologue Margaret Mead disait des baby-boomers états-uniens qu’ils constituaient une génération préfigurative, en ce sens qu’ils ont inversé les termes de la transmission intergénérationnelle, les jeunes instruisant leurs aînés et, du coup, leurs pairs, plutôt que l’inverse, défiant ainsi la tradition.
À lire aussi :
La génération des boomers a profondément changé la société… et continue de le faire
Cette inscription en faux contre les valeurs parentales et ancestrales aura permis l’essor de la contreculture dans les années 1960-1970, comme l’expliquent les sociologues Jean-François Sirinelli dans le cas de la France et Doug Owram dans celui du Canada, à travers des valeurs jeunes (la musique pop, la consommation de drogues récréatives ou l’amour libre par exemple). Elle aura également permis de rompre avec la traditionnelle transmission des rôles et des statuts au sein de la famille, comme le souligne le sociologue québécois Daniel Fournier.
Un effet de génération
On parle ici d’un effet de génération au sens sociologique du terme. Au Québec, les baby-boomers seraient, selon le sociologue québécois Jacques Hamel, ceux qui constituent cette fraction des enfants du baby-boom ayant souscrit au slogan « qui s’instruit, s’enrichit » et qui détiennent ces « diplômes universitaires, expression par excellence de cette modernisation » que connut le Québec dans les années 1960.
Ces derniers auront fomenté, sous l’égide des aînés ayant réfléchi la Révolution tranquille (soit les René Lévesque, Paul Gérin-Lajoie et autres révolutionnaires tranquilles), des transformations majeures au sein d’institutions sociales et d’idéaux aussi fondamentaux que la famille (en la réinventant), la nation (en la rêvant) ou la religion catholique (en la reniant de façon massive).
Le sociologue américain Leonard Steinhorn reconnaît dans cette génération des personnes aux valeurs progressistes ayant tendance à une plus grande reconnaissance de la diversité culturelle, des nouvelles mœurs (comme la légalisation du mariage homosexuel, de l’aide médicale à mourir, ou du cannabis récréatif), ou de l’égalité entre les hommes et les femmes, par rapport aux générations précédentes.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Mais ce qui distingue surtout ces baby-boomers vieillissants des générations de personnes âgées d’antan, c’est la persévérance dans la conviction de la primauté du sujet, par delà les conventions sociales, même dans la dépendance et la fin de vie.
L’effet de génération, bien qu’il diffère chez chacun des membres d’un même ensemble générationnel, est un produit de l’histoire et des conditionnements sociohistoriques auxquels le sujet aura été exposé au cours des premières décennies de sa vie. Les premières générations du baby-boom ont dès leur jeune âge adulte participé activement à la laïcité de l’État et de l’espace public et privé, et souscrit à l’État technobureaucratique promu par la Révolution tranquille, libérant le sujet des attaches communautaristes pour le rendre autonome.
Les enfants du baby-boom et la fin de vie
L’affranchissement des contraintes religieuses chez les Québécois d’origine canadienne-française, le difficile accès aux soins palliatifs pour les personnes âgées et, surtout, la volonté de contrôler sa propre destinée, sont autant de facteurs qui risquent d’influer sur la fin de vie et la mort des enfants du baby-boom au Québec.
En 2023, 7 % des personnes décédées au Québec – majoritairement des personnes âgées – ont choisi la mort médicalement assistée, dans un contexte d’acceptation sociale presque unanime. En effet, 90 % de la population québécoise appuie la loi sur l’aide médicale à mourir, selon un sondage Ipsos, soit le plus haut taux au Canada.
La détresse existentielle face à la fin de vie et le refus de la souffrance et de l’agonie pourraient expliquer l’engouement des enfants du baby-boom pour ce qu’ils considèrent une mort digne.
Or le grand volume de personnes qui constituent l’ensemble des cohortes du baby-boom, soit les personnes nées entre 1943 et 1965, invite à réfléchir au sort qui sera réservé à beaucoup d’entre eux et elles quant à la qualité et à la quantité des soins et des services publics qui leur seront alloués. Étant donné le contexte plutôt critique du Réseau québécois de la santé et des services sociaux, se pose la question des conditions dans lesquelles se dérouleront ces nombreux décès, estimés à plus de 100 000 par année dès 2036.
Pas tous égaux devant la vieillesse
Certes, une bonne proportion de personnes parmi ce grand ensemble populationnel seront effectivement à l’aise financièrement et jouiront d’un bon état de santé grâce à leur niveau d’éducation, à de généreuses pensions et autres fonds de retraite, à de saines habitudes de vie, et à la biomédecine. Cela étant dit, une proportion non négligeable vieillira appauvrie et malade. Les inégalités sociales de santé demeureront importantes au sein de ces nouvelles générations de personnes âgées.
Les hommes bénéficieront globalement d’un avantage sur les femmes en termes de conditions de retraite et de qualité de vie, tout comme les natifs par rapport aux immigrants, soulignent les démographes Patrik Marier, Yves Carrière et Jonathan Purenne dans un chapitre de l’ouvrage Les vieillissements sous la loupe. Entre mythes et réalités. Cela aura une incidence sur les conditions d’habitation et de résidence, sur les coûts privés en santé et sur la qualité du vieillissement en général.
Ces inégalités sociales de santé feront que les dernières années de vie de plusieurs, des femmes surtout, risquent de l’être en mauvaise santé, appauvries et sans forcément un entourage de qualité. Mais vivre plus longtemps à n’importe quel prix n’est pas le souhait de beaucoup parmi les enfants du baby-boom, et ce indépendamment de leur statut socioéconomique.
L’aide médicale à mourir deviendra-t-elle, dès lors, un acte médical ordinaire, alors que le système public de santé et de services sociaux connaîtra une pression accrue ? Quoi qu’il en soit, ce geste médical ultime devrait toujours jouir d’une popularité incontestable parmi les nouveaux vieux Québécois, du moins ceux d’origine canadienne-française qui ont rompu avec le catholicisme, ce qui pourrait contribuer à freiner l’augmentation de l’espérance de vie au Québec.
Mais encore faut-il que la fin de vie se déroule également dans la dignité.
![]()
Jean-Ignace Olazabal a reçu des financements du CRSHC, IRSC.
– ref. Comment les boomers vivront-ils leur fin de vie au Québec ? – https://theconversation.com/comment-les-boomers-vivront-ils-leur-fin-de-vie-au-quebec-252148