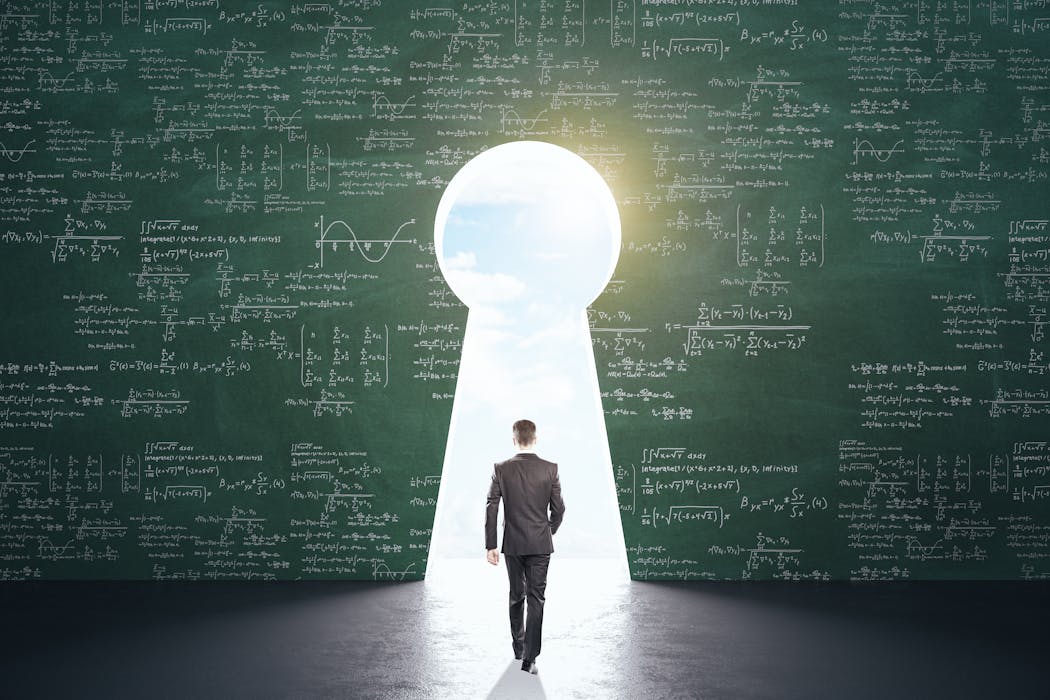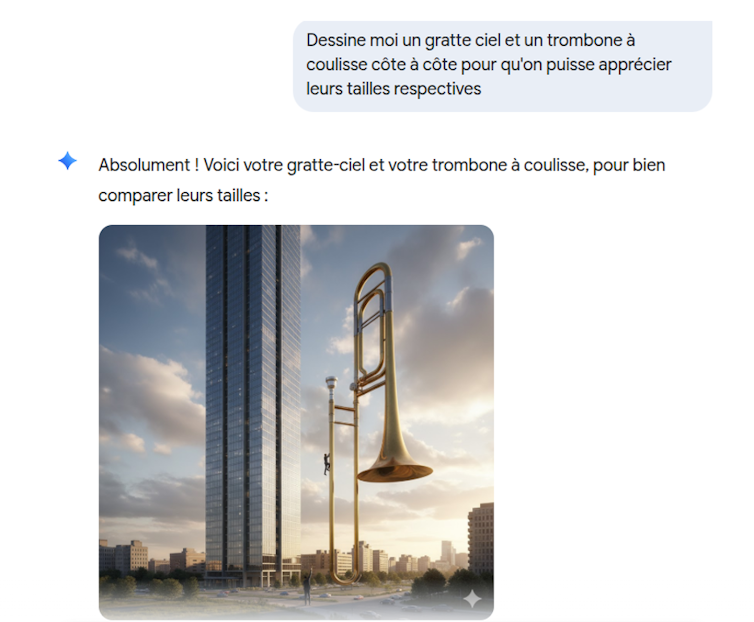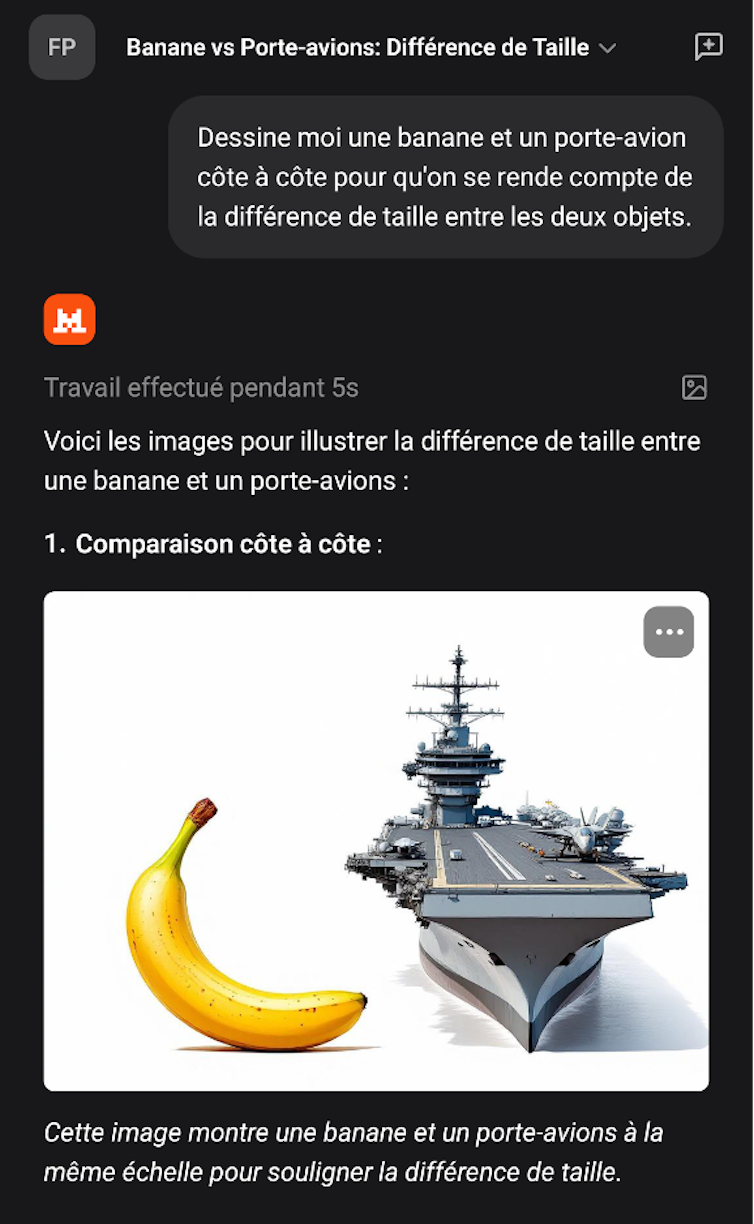Source: The Conversation – France (in French) – By Diane Sam-Mine, Doctorante en psychologie sociale, Université d’Artois
« Je suis nul », s’exclament certains élèves à la vue d’une mauvaise note. Cette phrase banale en apparence peut avoir bien plus de conséquences sur leur parcours scolaire qu’on ne l’imagine.
Prenons les cas de Lucie et d’Asha, deux bonnes élèves. Alors qu’elles découvrent leurs notes de leur dernière évaluation en français, elles se rendent compte avec stupeur qu’elles ont toutes les deux une mauvaise note. Lucie se dit qu’elle est bête : elle a travaillé, et pourtant… Elle se sent moins motivée, relâche ses efforts : à quoi bon ? Elle préfère se concentrer sur les mathématiques, elle est beaucoup plus forte dans ce domaine.
Asha, au contraire, pense directement que c’est une opportunité pour progresser. Elle n’a pas encore maîtrisé cette leçon, peut-être une mauvaise méthode d’apprentissage ? Elle est encore plus motivée pour comprendre ses erreurs et essaie de faire plus d’exercices pour maîtriser les notions qu’elle n’a pas encore acquises.
Lucie et Asha sont dans la même situation mais ont des réactions opposées. D’un côté, Lucie a l’impression que sa mauvaise note indique que ses capacités intellectuelles sont en défaut. De l’autre, Asha comprend que sa mauvaise note indique seulement que sa maîtrise du chapitre 4 à ce moment-là n’était pas suffisante.
Deux états d’esprit, deux visions de l’intelligence
Comment expliquer ces deux réactions très différentes entre Lucie et Asha ? La psychologue Carol Dweck théorise qu’on peut adopter deux états d’esprit face à l’intelligence. Un état d’esprit désigne la croyance qu’une personne peut avoir sur son intelligence. L’état d’esprit fixe (fixed mindset) est défini comme la croyance que nos capacités intellectuelles sont immuables, tandis que l’état d’esprit de développement (growth mindset) se réfère à la croyance que nos capacités intellectuelles peuvent évoluer avec le temps, grâce à nos efforts, avec des stratégies adaptées, en demandant de l’aide et en voyant les erreurs comme des opportunités d’apprentissage.
Ici, Lucie a un état d’esprit fixe et, Asha, un état d’esprit de développement. Les élèves ayant un état d’esprit fixe ont peur de l’échec qui est perçu comme une menace à leur intelligence, et indique qu’ils sont incapables. Le fait de réussir ou non est lié à l’identité de la personne : compétente et intelligente si on réussit, incompétente et manquant d’intelligence dans le cas contraire. Les élèves ayant un état d’esprit fixe vont avoir peur d’essayer de nouveaux exercices, des niveaux plus durs ou de demander de l’aide.
Lucie, en voulant se concentrer sur les mathématiques où elle se sent plus à l’aise, se catégorise : « Je ne suis pas littéraire, plutôt logique », typique d’un état d’esprit fixe. En perdant sa motivation, il se peut que Lucie se désengage et continue à avoir de mauvaises notes en français.
Asha qui a un état d’esprit de développement ne considère pas sa mauvaise note comme une menace à son intelligence. En percevant l’intelligence comme malléable, elle sait qu’elle n’a pas encore compris mais qu’en persévérant, elle y arrivera. Les erreurs sont vues comme des opportunités pour apprendre. Demander de l’aide n’indique pas de la faiblesse pour Asha, mais la force de se fier à une personne plus experte (camarade de classe ou enseignante). Asha progressera de plus en plus en français.
En quelques mots, nos états d’esprit, ou plus simplement notre manière de considérer notre intelligence, influencent nos pensées, nos comportements, et même parfois, nos performances.
Voir l’intelligence comme malléable, quels bénéfices ?
Avoir un état d’esprit de développement impacte l’approche des élèves face aux études, leur réussite ainsi que leur bien-être général. Une élève qui pense que ses capacités peuvent évoluer aura tendance à persévérer, à passer plus de temps sur les exercices et à demander des devoirs plus difficiles, pour se confronter à ce qu’elle ne sait pas pour pouvoir progresser.
Si les élèves avec un état d’esprit fixe accordent beaucoup d’importance à la note, les élèves qui ont une vision malléable de l’intelligence sont plus motivés par le fait de maîtriser une notion. Ainsi, les personnes avec un état d’esprit de développement ont moins peur de l’échec et ont également plus confiance en eux afin de mener à bien une tâche. Les élèves qui pensent que l’intelligence est malléable perçoivent les efforts positivement alors que les élèves avec un état d’esprit fixe les voient comme un manque de capacité.
En sachant qu’ils peuvent s’améliorer, les élèves avec un état d’esprit de développement se sentent moins impuissants et sont plus attentifs à leurs erreurs. L’état d’esprit de développement peut ainsi être corrélé à de meilleures performances scolaires. Pour finir, les personnes ayant une vision malléable de l’intelligence se sentent mieux, ont plus d’émotions positives et sont plus susceptibles d’être satisfaites de leur vie.
Des interventions pour modifier les croyances sur l’intelligence
Les interventions pour promouvoir l’état d’esprit de développement sont de plus en plus mises en place dans les établissements scolaires. On explique aux élèves la plasticité du cerveau, l’importance des efforts et la nécessité des échecs, les bénéfices d’un état d’esprit de développement.
Ces interventions sont plutôt peu coûteuses et nécessitent peu de ressources, avec des effets positifs conséquents. Les études ont montré que ces interventions bénéficient aux élèves vulnérables, en décrochage scolaire, issus de minorités ethniques). Les interventions sont alors également vues comme un moyen possible de lutter contre les différences de performances liées aux inégalités sociales. Les élèves défavorisés avec un état d’esprit de développement ont des résultats similaires que des élèves plus favorisés ayant un état d’esprit fixe.
L’importance de l’environnement dans notre perception de l’intelligence
Les états d’esprit sont toujours influencés par l’environnement : par les pairs et les professeurs. Les chercheurs ont démontré que l’état d’esprit d’un élève pouvait être prédit par les croyances sur l’intelligence de ses camarades de classe. Entouré d’élèves qui perçoivent l’intelligence comme fixe, un élève aura plus de chances de le penser également. Les adultes influencent également très fortement les états d’esprit des élèves.
Les interventions sont beaucoup plus efficaces sur les élèves lorsque les professeurs ont également un état d’esprit de développement. Les interventions ciblant les enseignants ont été démontrées comme efficaces, pouvant changer les états d’esprit des enseignants et les pratiques pédagogiques.
Ces interventions deviennent de plus en plus populaires auprès de la communauté éducative. Si les interventions centrées sur les élèves peuvent les aider, elles ne peuvent contrer seules les inégalités sociales. Ces interventions sont donc complémentaires d’une approche plus systémique afin de lutter contre les inégalités éducatives.
Croire qu’on est bête ne nous condamne pas à être bêtes, tout comme croire qu’on est intelligent ne nous rend pas intelligents. Cependant, croire que nos capacités peuvent évoluer constitue la première étape pour progresser !
Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.
![]()
Diane Sam Mine a reçu des financements de la région Hauts-de-France.
– ref. À l’école, ce que les élèves pensent de leur intelligence influence leurs résultats – https://theconversation.com/a-lecole-ce-que-les-eleves-pensent-de-leur-intelligence-influence-leurs-resultats-270711