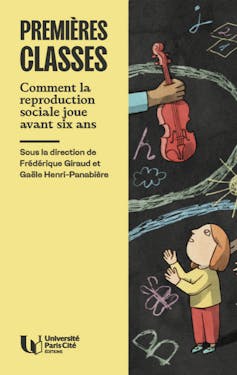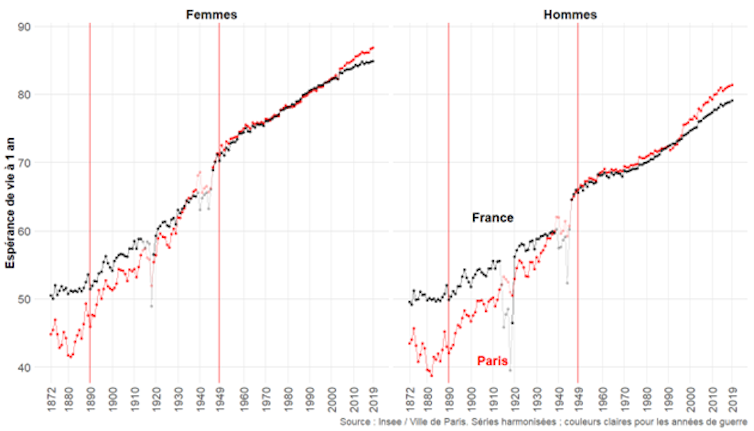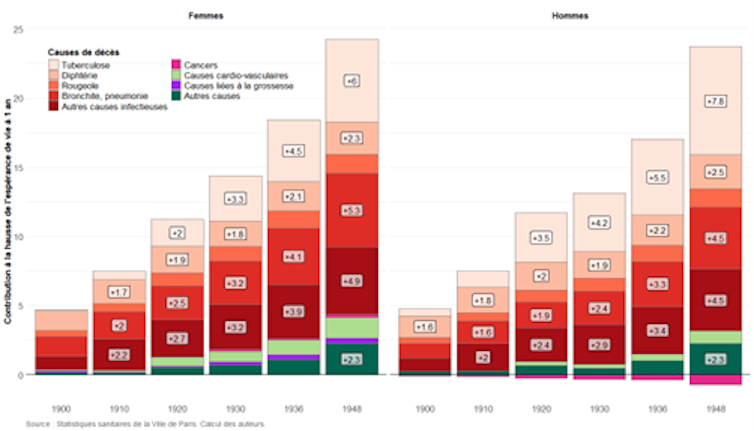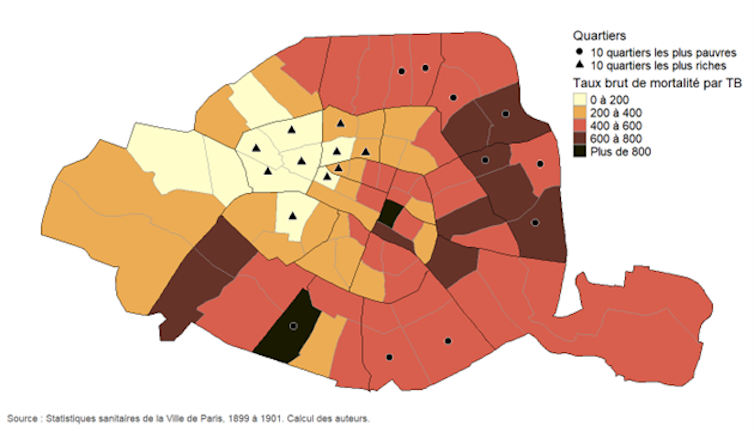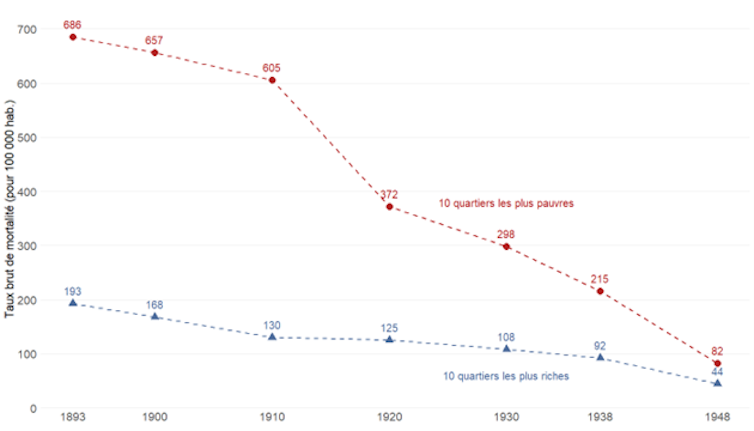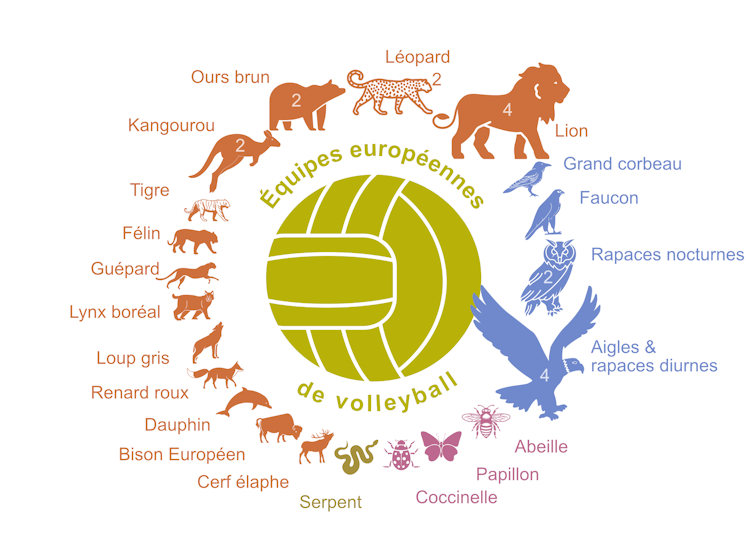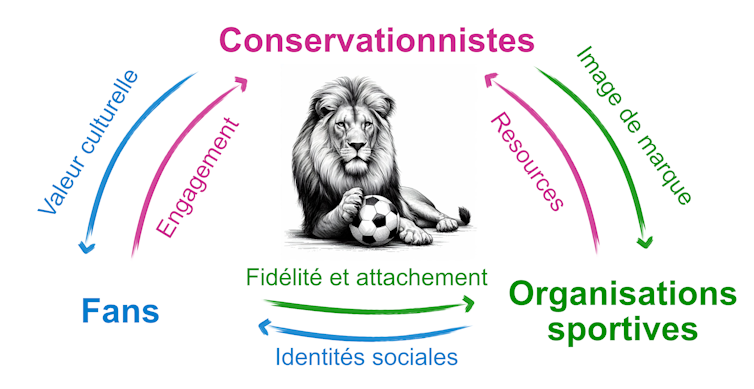Source: The Conversation – in French – By Nick Revington, Professeur de logement et dynamiques urbaines, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Avec l’augmentation des prix des maisons au cours des deux dernières décennies, l’accès à la propriété est devenu de plus en plus difficile pour les jeunes ménages au Canada, et ce, malgré un fort soutien dans les politiques publiques. Devenir propriétaire de son chez-soi demeure néanmoins désiré par les jeunes pour assurer une stabilité résidentielle difficilement retrouvée ailleurs.
Chercheurs en études urbaines à l’Institut national de la recherche scientifique, nous nous sommes penchés sur la question des aspirations des jeunes à accéder à la propriété dans ce contexte difficile à travers des entretiens approfondis avec une vingtaine de ménages dans le grand Montréal.
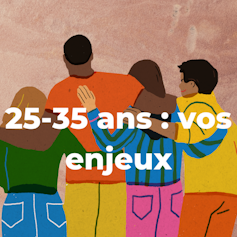
Chacun vit sa vingtaine et sa trentaine à sa façon. Certains économisent pour contracter un prêt hypothécaire quand d’autres se démènent pour payer leur loyer. Certains passent tout leur temps sur les applications de rencontres quand d’autres essaient de comprendre comment élever un enfant. Notre série sur les 25-35 ans aborde vos défis et enjeux de tous les jours.
Des dispositifs pour l’accès à la propriété
Le dispositif le plus connu pour encourager l’achat d’une maison est peut-être le Compte d’épargne libre d’impôts pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), mais il existe d’autres programmes dont le Régime d’accession à la propriété, qui permet de retirer des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour l’achat ou la construction d’une maison.
À lire aussi :
Des choix faits il y a près d’un siècle sont responsables de l’actuelle crise du logement
L’État fédéral assure les prêts hypothécaires par le biais de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), ce qui accroît la disponibilité du capital destiné à l’achat de la propriété résidentielle.
Plusieurs municipalités offrent également des incitatifs pour les premiers acheteurs. Par exemple, dépendamment du statut du ménage et de la propriété, un nouveau propriétaire à Montréal pourrait obtenir une aide financière de la Ville, allant de 5000 $ à 15 000 $. La Ville de Québec, quant à elle, offre à des familles qui respectent certains critères d’admissibilité des prêts sans intérêt ni versement représentants 5,5 % du prix d’achat d’un logement neuf pour compléter une mise de fonds.
Le Canada en fait assez… pour les propriétaires
En parallèle cependant des dispositifs mis en place par le gouvernement pour encourager l’achat d’une première maison, d’autres dispositifs plus importants et souvent moins connus travaillent à enrichir les propriétaires existants. Cela représente une incitation majeure à rejoindre les rangs des propriétaires.
C’est le cas, par exemple, de l’exonération de l’impôt sur le gain en capital pour résidence principale. Autrement dit, le profit réalisé lors de la revente de votre maison n’est pas imposable. Cette subvention d’autour de 15 milliards $ par année dépasse le budget annuel de la Stratégie nationale sur le logement.
Encore plus ésotérique est la notion de « loyer imputé » : elle désigne tout propriétaire qui occupe le logement dont il est propriétaire. En occupant sa propriété, le propriétaire se verse à lui-même un loyer fictif. Contrairement aux Pays-Bas et à la Suisse, ce loyer imputé n’est pas imposable au Canada. Cette absence d’imposition représente un biais fiscal favorisant les propriétaires, car si le propriétaire décidait de louer ce logement plutôt que de l’occuper, il paierait des impôts sur ce revenu, qui sont, au final, payés par le locataire.
Toutefois, l’accession à la propriété promue par le Canada semble être une « fausse promesse ». Avec les politiques en place, les jeunes et les ménages à revenu modeste se trouvent progressivement exclus des opportunités d’accumulation de richesse qu’offre la propriété. Le logement devient dans ces conditions un vecteur d’inégalités importantes.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Politiques pour la propriété, contre la location
En même temps, les politiques publiques canadiennes et québécoises défavorisent la location, ce qui rend la propriété encore plus attrayante. Les politiques actuelles s’éloignent du modèle des logements sociaux et communautaires, où les loyers sont déterminés en fonction de la capacité des ménages à payer. Elles promeuvent à la place le logement « abordable » relatif à la valeur marchande, avec des loyers qui sont en dessous du prix courant, mais qui sont parfois néanmoins hors de la portée des ménages à faible revenu.
À lire aussi :
Deux femmes victimes d’éviction se confient : « Les propriétaires n’avaient aucune empathie »
Dans le marché locatif, la pression du marché immobilier rend visibles les limites du régime québécois de protection des locataires à travers les hausses de loyers, reprises de logements, et rénovictions.
En permettant au locateur de refuser sans motif sérieux une cession de bail, la loi 31 adoptée en 2024 a éliminé l’un des derniers moyens de trouver un appartement à bon prix.
Une diversité de motivations pour accéder à la propriété
Nos recherches menées auprès de jeunes ménages aspirant à la propriété dans la grande région de Montréal révèlent une diversité de motivations. Si l’ensemble des ménages rencontrés se heurtent à la difficulté d’accéder à la propriété, pour la plupart, l’achat d’une maison n’est pas un objectif en soi.
Certains désirent un espace convenable pour leurs jeunes enfants, qu’ils ont de la difficulté à trouver dans le marché locatif. D’autres perçoivent la propriété comme un bon investissement. Plusieurs sont préoccupés par leurs expériences de précarité résidentielle, ou expriment des craintes face aux rénovictions, aux hausses de loyer ou à la négligence de propriétaires dans le marché locatif.
D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ne sont pas contre la location à long terme. Ils sont nombreux à être attachés à la vie de leur quartier. Dans la mesure où l’achat d’une propriété nécessite souvent de se relocaliser dans un quartier dont les prix sont plus bas, la location reste fréquemment désirable. À cela s’ajoute que l’achat est souvent perçu comme un surétirement financier, qui amène un risque plutôt qu’une stabilité.
À lire aussi :
« Pas dans ma cour » : Les deux faces du NIMBYisme québécois
Une remise en cause des politiques favorisant la propriété ?
À la lumière de cette diversité des motivations, serait-il nécessaire de remettre en cause les politiques publiques favorisant l’accession à la propriété ?
Au lieu de promouvoir la propriété dans l’espoir qu’elle répondra aux besoins des ménages, nos politiques en logement devraient satisfaire directement à ces besoins.
En tenant compte de la littérature scientifique sur le sujet, les politiques publiques devraient favoriser la stabilité ou la sécurité résidentielle, peu importe le mode d’occupation, en mettant en place une approche centrée sur une politique d’habitation neutre en matière de mode d’occupation. C’est ce qu’on appelle en anglais la « tenure-neutral housing policy ». Cette approche, contrairement aux politiques actuelles, ne privilégie aucun mode d’occupation par rapport à un autre.
Nos politiques en logement devraient, de la même manière, augmenter le financement du logement social et communautaire, et inciter la construction d’appartements qui répondent aux besoins des ménages avec enfants, par exemple avec une meilleure insonorisation et un accès à une cour intérieure.
Elles devraient enfin renforcer les protections des locataires contre des hausses abusives des loyers, des rénovictions et la discrimination.
Réduire la dépendance à la propriété
L’attrait de la propriété comme investissement demeure indéniable. Favoriser d’autres types d’investissements, comme des fonds de placement ou des actions, aurait le double avantage de diversifier les opportunités d’investissement des ménages et de libérer des capitaux qui sont investis dans l’immobilier en raison des augmentations des prix et non en raison de l’augmentation de l’offre.
Une amélioration des régimes de retraite publics ferait que l’achat d’une propriété ne soit pas perçu comme nécessaire pour sécuriser son avenir.
Plusieurs obstacles freinent toutefois la refonte des politiques de logement. Environ deux tiers des ménages canadiens et la majorité des ménages québécois sont propriétaires de leur logement. Il serait politiquement difficile de réduire les avantages dont bénéficie ce bloc électoral pour mettre en œuvre des solutions plus équitables.
Il demeure toutefois essentiel de maintenir ce débat, surtout pour assurer la sécurité résidentielle de la part des ménages qui sera inévitablement exclue de l’accession à la propriété.
![]()
Nick Revington a reçu des financements du Fonds de recherche du Québec (FRQ) et du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).
Emory Shaw a reçu des financements du Fonds de recherche du Québec (FRQ).
Mathiaz Lazo Mackay a reçu des financements du Fonds de recherche du Québec (FRQ).
– ref. L’accès à la propriété, la fausse promesse canadienne – https://theconversation.com/lacces-a-la-propriete-la-fausse-promesse-canadienne-268154