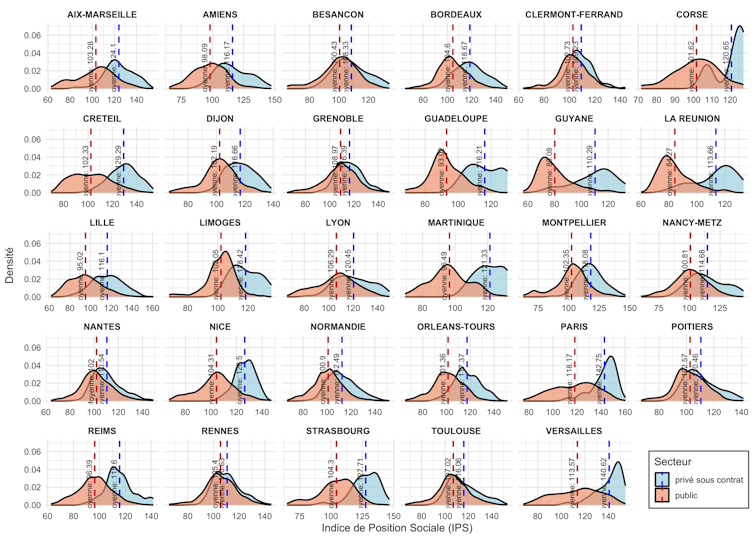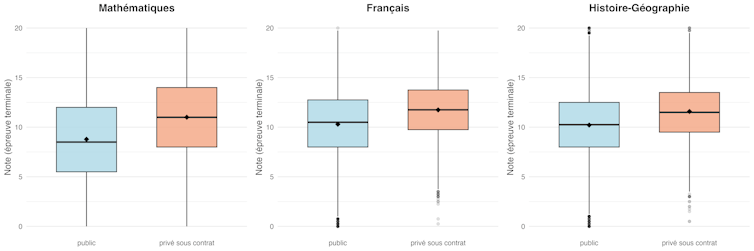Source: The Conversation – France in French (3) – By Allane Madanamoothoo, Associate Professor of Law, EDC Paris Business School
Le Belge Jean-Marc Bosman, joueur modeste des années 1990, restera peut-être dans l’histoire comme le footballeur qui aura eu le plus grand impact sur son sport. En effet, l’arrêt portant son nom, adopté il y a exactement trente ans, a permis aux joueurs en fin de contrat de rejoindre un autre club sans l’exigence d’une indemnité de transfert. Il a également mis fin à la règle qui prévalait jusqu’alors de trois étrangers maximum par équipe, ouvrant la voie à une aspiration des joueurs du monde entier vers les clubs les plus riches.
« Toi, avec ton arrêt, tu vas rester dans l’histoire, comme Bic ou Coca-Cola », avait dit Michel Platini à Jean-Marc Bosman en 1995. Platini n’avait sans doute pas tort.
Les faits remontent à 1990. Le contrat de travail de Bosman, footballeur professionnel du Royal Football Club (RFC) de Liège (Belgique), arrive à échéance le 30 juin. Son club lui propose un nouveau contrat, mais avec un salaire nettement inférieur. Bosman refuse et est placé sur la liste des transferts. Conformément aux règles de l’Union européenne des associations de football (UEFA) en vigueur à l’époque, le transfert d’un joueur, même en fin de contrat, s’effectue en contrepartie d’une indemnité versée par le club acheteur au club vendeur. Autrement dit, pour acquérir Bosman, le nouveau club devra verser une indemnité de transfert au RFC.
En juillet, l’Union sportive du littoral de Dunkerque (USL) en France est intéressée. Mais le club belge, craignant l’insolvabilité de l’USL, bloque l’opération. Bosman se retrouve sans employeur. Pis, il continue d’appartenir à son ancien club, lequel maintient ses droits de transfert. Par ailleurs, en vertu de la règle des quotas – trois étrangers maximum par équipe –, il est difficile pour le joueur de rejoindre un club dans un autre État de la Communauté européenne.
S’estimant lésé, Bosman saisit les tribunaux belges. L’affaire est par la suite portée devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
Coup de tonnerre : le 15 décembre 1995, la CJCE tranche en faveur de Bosman.
Décision de la CJCE
La Cour précise que le sport professionnel, comme toute activité économique au sein de la Communauté européenne, est soumis au droit communautaire. Elle considère dès lors que toute disposition restreignant la liberté de mouvement des footballeurs professionnels ressortissants de la Communauté européenne est contraire à l’article 48 du Traité de Rome, lequel prévoit la libre concurrence et la liberté de circulation des travailleurs entre les États membres.
La CJCE reprend ses jurisprudences antérieures (arrêts Walrawe et Koch en 1974 et Doña en 1976) et déclare que les règles de quotas fondées sur la nationalité des joueurs ressortissants communautaires constituent des entraves au marché commun.
En outre, la Cour va plus loin dans son jugement et estime que les indemnités de transfert pour les joueurs en fin de contrat (encore appliquées par certains clubs européens en 1995) sont contraires au droit communautaire.
Enjeux et impacts de l’arrêt Bosman
Le socle de cette décision a été la standardisation ou plutôt l’universalité des règles sportives au niveau de l’UEFA (54 fédérations) et de la Fédération Internationale de Football Association, FIFA (211 fédérations), qui ont dû s’aligner sur la jurisprudence Bosman.
Ainsi, cet arrêt de la CJCE a conduit les instances du football à réformer le système des transferts (Réformes dites « Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs », (RSTJ) 2001, 2005, 2017-2022). Conséquemment, l’arrêt Bosman a drastiquement accentué la libéralisation du marché des transferts.
Cela s’est traduit par la suppression des obstacles à la libre circulation des sportifs. Les joueurs en fin de contrat sont devenus libres de rejoindre un autre club sans que celui-ci soit tenu de verser une indemnité de transfert à leur ancien club. Fin de l’ « esclavage » sportif ! Fin également du « régime de quotas » pour les joueurs ressortissants communautaires au sein des effectifs dans les clubs européens !
De facto, il y a eu une augmentation du nombre de joueurs étrangers communautaires, désormais illimité pour les joueurs des pays de l’Union européenne (UE). C’est le cas également pour les joueurs de l’Espace économique européen et pour ceux issus des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE à la suite des arrêts Malaja dans le basket en 2002, Kolpak dans le handball en 2003 et Simutenkov dans le football en 2005. Il en est de même, depuis l’accord de Cotonou en 2000 (remplacé par l’accord de Samoa en 2023), pour les détenteurs des nationalités de 47 pays d’Afrique, 15 pays des Caraïbes et 15 pays du Pacifique. En France, le nombre de joueurs considérés comme « extra-communautaires » est limité à quatre.
Par ailleurs, comme le souligne Vincent Chaudel, co-fondateur de l’Observatoire du Sport Business, l’arrêt
Bosman a inversé le rapport de force entre joueurs et clubs. L’inflation des salaires, qui avait commencé dans les années 1980, s’est accélérée dès les premières années après cet arrêt, puis de manière exponentielle chez les superstars par la suite.
Selon le magazine Forbes, les cinq footballeurs les mieux rémunérés en 2024 étaient Cristiano Ronaldo (environ 262,4 millions d’euros), Lionel Messi (environ 124,3 millions d’euros), Neymar (environ 101,3 millions d’euros), Karim Benzema (environ 95,8 millions d’euros) et Kylian Mbappé (environ 82,9 millions d’euros). L’écart salarial entre les footballeurs et les footballeuses reste néanmoins encore béant.
À lire aussi :
Equal play, equal pay : des « inégalités » de genre dans le football
L’arrêt Bosman a aussi fortement impacté la spéculation de la valeur marchande des superstars et des jeunes talents.
À lire aussi :
À qui profite le foot ?
Au-delà, cet arrêt s’est matérialisé par l’extension de la libre circulation des joueurs formés localement dans un État membre de l’UE, au nom de la compatibilité avec les règles de libre circulation des personnes ; cette mesure a ensuite été étendue à d’autres disciplines sportives.
Une autre particularité concerne le prolongement de la jurisprudence Bosman aux amateurs et aux dirigeants sportifs.
Enfin, il est important de rappeler que si l’arrêt Bosman a permis à de nombreux acteurs du football (joueurs, agents, clubs, investisseurs, etc.) de s’enrichir, ce fut loin d’être le cas pour Jean-Marc Bosman lui-même. Dans un livre autobiographique poignant, Mon combat pour la liberté, récemment publié, l’ancien joueur raconte son combat judiciaire de cinq ans, ainsi que sa longue traversée du désert (trahisons, difficultés financières, dépressions, etc.) après la décision de la CJCE.
Perspectives : du 15 décembre 1995 au 15 décembre 2025, 30 ans de libéralisation
L’arrêt Bosman a dérégulé, explosé et exposé le marché des transferts. Le récent article de la Fifa consacré au marché estival de 2025 en témoigne : cet été-là, 9,76 milliards de dollars d’indemnités de transfert ont éé versés dans le football masculin et 12,3 millions de dollars dans le football féminin.
Ainsi, l’arrêt a ouvert la voie à une libéralisation inédite des opérations, conduisant parfois à des montages financiers particulièrement complexes.
À lire aussi :
Football financiarisé : l’Olympique lyonnais, symptôme d’un modèle de multipropriété en crise
Au-delà de l’explosion des indemnités de transfert, l’arrêt Bosman a creusé les inégalités entre les clubs, tant au niveau national qu’européen. Pendant que les clubs les moins riches servent de pépinières pour former les futurs talents, les clubs les plus riches déboursent des sommes astronomiques pour acquérir les meilleurs footballeurs : Neymar, 222 millions d’euros ; Mbappé, 180 millions d’euros ; Ousmane Dembelé et Alexander Isak, 148 millions d’euros ; Philippe Coutinho, 135 millions d’euros, etc. Cela se traduit par l’ultra-domination des gros clubs dans les championnats européens avec le risque d’un « déclin général de l’équilibre compétitif dans le football européen » selon l’Observatoire du football CIES.
Enfin, avec la libéralisation du marché des transferts, des réseaux internationaux se tissent – et par la même occasion s’enrichissent – pour dénicher les futures « poules aux œufs d’or ». L’Amérique du Sud, l’Afrique (notamment depuis l’accord Cotonou) et l’Europe de l’Est sont devenues les principaux exportateurs des footballeurs (certains partent à un âge très précoce à l’étranger et se retrouvent loin de leur famille) vers les clubs d’Europe de l’Ouest.
Pour conclure, il serait souhaitable de réguler le marché, d’assainir l’écosystème et d’apaiser les ardeurs. L’arrêt Diarra (qualifié de « Bosman 2.0 ») de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – anciennement la CJCE – le 4 octobre 2024 est une avancée dans ce sens. Bien que la Cour n’ait pas remis en cause tout le système des transferts, elle a enjoint la FIFA à modifier sa réglementation afin que les footballeurs ne soient plus sous le joug de leur club en cas de rupture unilatérale de leur contrat.
Les joueurs doivent pouvoir y mettre un terme sans craindre de devoir verser une indemnité « disproportionnée » à leur club, et sans que le nouveau club désireux de les recruter soit tenu de verser solidairement et conjointement cette indemnité en cas de rupture sans « juste cause ». Dans l’urgence, un cadre réglementaire provisoire relatif au RSTJ a été adopté par la FIFA en décembre 2024 – jugé pour autant non conforme à la décision de la CJUE.
Le monde du football a besoin d’une transformation systémique où le plafonnement des coûts de transfert, mais aussi la gestion vertueuse des clubs et des institutions, l’encadrement et l’égalité des salaires homme-femme, la prise en compte du bien-être psychologique des acteurs, etc. constitueraient un socle fort pour un renouveau du marché des transferts et de l’industrie du football dans sa globalité.
Mieux, l’industrie du football ne doit plus constituer un mobile pour creuser les écarts et les disparités sociales et sociétales.
Annexe : 11 dates et événements clés
1891 : J. P. Campbell de Liverpool est le premier agent à faire la promotion de joueurs auprès des clubs par des publicités via la presse.
1905 : William McGregor, ancien président du club d’Aston Villa et fondateur de la ligue anglaise déclare, en une formule visionnaire pour l’époque, « Football is big business ».
1930 : la première Coupe du Monde de football a lieu en Uruguay.
1932 : la mise en place du premier championnat professionnel de football en France avec des dirigeants employeurs et des joueurs salariés sans aucun pouvoir ainsi que l’établissement du contrat à vie des footballeurs, liés à leur club jusqu’à l’âge de 35 ans.
1961 : le salaire minimum des joueurs de football est supprimé. Cette décision a pour effet d’équilibrer le pouvoir de négociation entre joueurs et clubs.
Entre 1960 et 1964 : les salaires des joueurs de la première division française évoluent drastiquement (augmentation de 61 % par rapport à ceux des années 1950).
1963 : la Haute Cour de Justice anglaise dispose, dans l’affaire Georges Eastham, que le système de « conservation et transfert » est illégal.
1969 : la mise en place du contrat de travail à durée librement déterminée.
1973 : l’adoption de la Charte du football professionnel.
1991 : la première Coupe du monde de football féminin se déroule en Chine.
1995 : l’arrêt Bosman de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 15 décembre 1995 crée un véritable bouleversement dans le système de transfert des joueurs au sein de l’UE – anciennement la Communauté européenne.
![]()
Moustapha Kamara a reçu une Bourse de recherche Havelange de la FIFA.
Allane Madanamoothoo et Daouda Coulibaly ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
– ref. Football : 30 ans après l’arrêt Bosman, quel bilan pour le marché des transferts ? – https://theconversation.com/football-30-ans-apres-larret-bosman-quel-bilan-pour-le-marche-des-transferts-270916