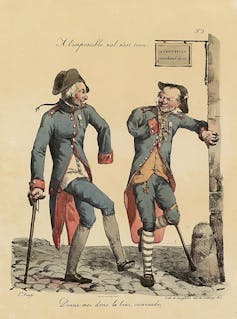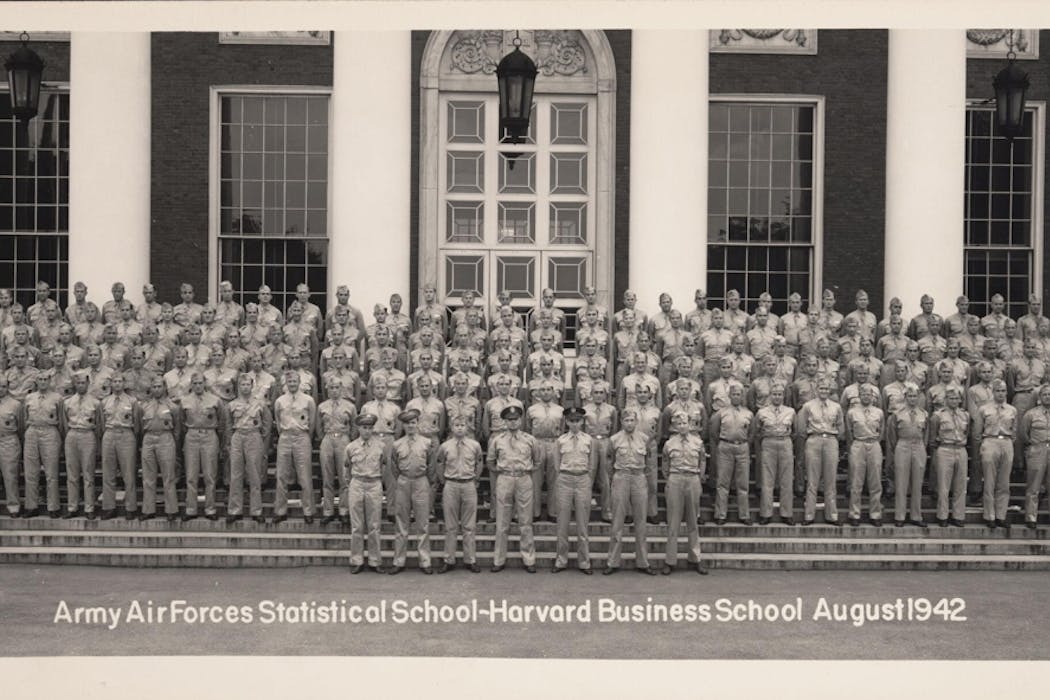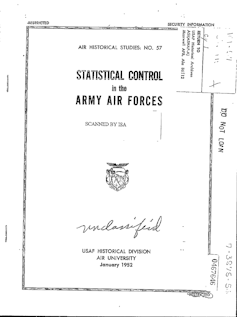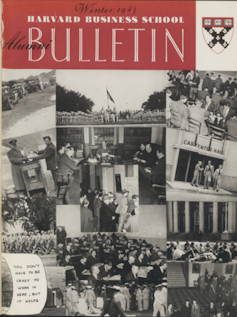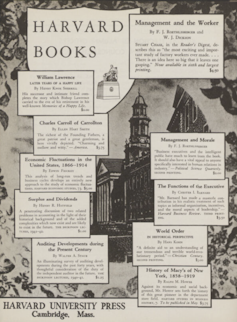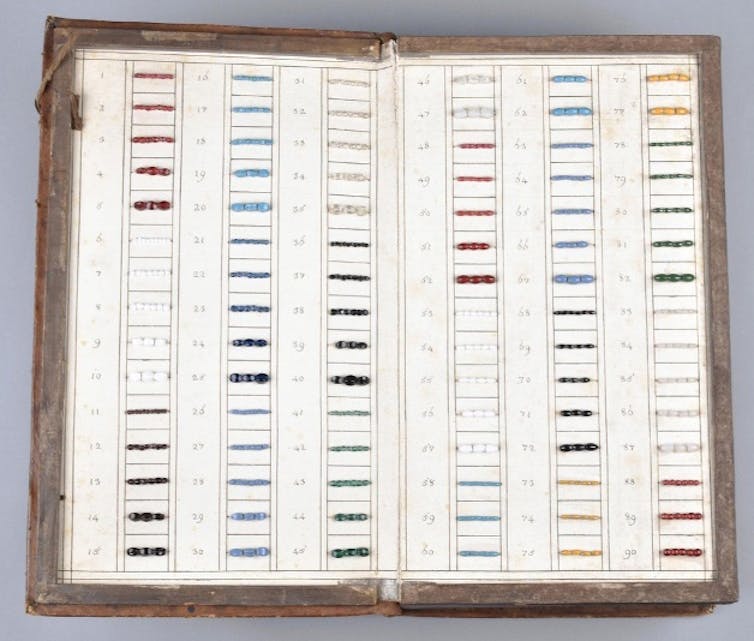Source: The Conversation – France in French (3) – By Andrea Martini, Chercheur post-doc Marie Curie, historien, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
En Europe comme ailleurs, la montée des groupes d’extrême droite s’impose comme un phénomène majeur. Face à cette menace, les démocraties sont appelées à réagir. Parmi les réponses possibles figurent des mesures répressives, telles que l’interdiction de certains partis politiques. Mais ces stratégies sont-elles réellement efficaces ? En adoptant une perspective rétrospective sur l’histoire des démocraties européennes, il est possible d’en évaluer à la fois les forces et les limites.
Début mai 2025, l’Office fédéral allemand pour la protection de la Constitution a établi que le parti d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) devait être considéré comme une organisation extrémiste. Ce statut permet aux magistrats et aux services de renseignement de mener des investigations plus approfondies sur les activités de l’AfD. Désormais, son interdiction ne peut, en termes absolus, être exclue, du moins selon ce qui est prévu par la Constitution du pays, qui considère comme l’un des scénarios envisageables la dissolution de tous les partis – qu’ils soient de droite ou de gauche – représentant une menace pour la démocratie elle-même (art. 21).
En Allemagne, cette décision de l’Office fédéral pour la protection de la Constitution a déclenché un débat intense, interrogeant l’opportunité de mettre en œuvre des mesures répressives pour protéger la démocratie. Une telle démarche ne risque-t-elle pas d’être contre-productive pour la démocratie elle-même ? La question est extrêmement délicate.
Un regard sur le passé ne peut, à lui seul, apporter une réponse définitive à un enjeu aussi complexe. Pourtant, il permet de donner de la profondeur au débat. D’ailleurs, une mesure telle que l’interdiction d’un parti n’est en rien étrangère à l’histoire des démocraties. C’est ce que montre le champ d’études consacré au concept de « démocratie militante » (ou « protégée »), une notion qui remonte aux années 1930, lorsqu’elle fut employée par le politologue allemand Karl Loewenstein afin de désigner les instruments susceptibles de contrer la montée des mouvements antidémocratiques, dans le cas spécifique l’accession au pouvoir du parti national-socialiste.
Se protéger du fascisme
La fin de la Grande Guerre coïncide avec la chute des grands empires et la naissance de nombreuses démocraties. L’exploit, toutefois, de l’idéologie fasciste en Italie et puis en Allemagne rend ce dernier modèle de plus en plus séduisant. Certains pays choisissent alors de se protéger, donnant naissance à ce que l’on peut considérer comme les premières formes de démocratie militante.
En France, le 10 janvier 1936, la IIIe République adopte une loi autorisant la dissolution des « groupes de combat et milices privées ». Cette mesure vise les ligues d’extrême droite, dont la popularité connaît une croissance exponentielle. À peine quelques semaines plus tard, la loi est appliquée pour la première fois : à la suite de l’agression dont Léon Blum, le leader du Parti socialiste, est victime, la Ligue d’Action française est dissoute.

Amanda Slater, CC BY-SA
Durant la même période, le Royaume-Uni décide lui aussi de prendre des mesures face à la montée de l’extrême droite. La menace, ici, porte le nom de British Union of Fascists (BUF), un parti fondé en 1932 par Oswald Mosley. Dès son appellation, la référence au Parti national fasciste de Mussolini est évidente. Les manifestations publiques répétées du BUF font croître le niveau de tension dans le pays, au point que, le 4 octobre 1936, dans l’est de Londres, se déroule la célèbre bataille de Cable Street, qui oppose, d’un côté, les fascistes de Mosley, et de l’autre, les syndicats, des militants de gauche ainsi que des membres de la communauté juive.
En décembre 1936, le gouvernement adopte donc un Public Order Act, qui interdit le port d’uniformes politiques lors des manifestations (donc pas de chemises noires, comme avaient l’habitude d’en porter les partisans de Mosley) et renforce les pouvoirs discrétionnaires de la police pour empêcher certains rassemblements. Ce faisant, le poids réel de Mosley et du BUF diminue drastiquement.
L’immédiat après-guerre
Un deuxième tournant dans l’histoire de la démocratie militante est l’immédiat après-guerre. L’Europe, une fois sortie de la menace nazie et fasciste, considère qu’il est d’une importance capitale d’adopter de mesures destinées à se protéger : se protéger contre la menace fasciste renouvelée et, en même temps, contre la menace communiste, considérée alors comme encore plus sérieuse.
Le Royaume-Uni et la France confirment tout d’abord les lois déjà en vigueur et n’hésitent pas à les appliquer à nouveau. Dans l’immédiat après-guerre, la IVe République française recourt ainsi au dispositif de 1936 pour dissoudre toute une série de petites formations de droite, à commencer par le Mouvement socialiste d’unité française. Le Royaume-Uni fait de même : il s’appuie sur le Public Order Act de 1936 pour empêcher au nouveau parti fondé par Mosley à la fin de 1947, l’Union Movement, d’organiser des meetings publics.
Dans le même temps, les pays qui avaient vécu directement l’expérience du fascisme prennent eux aussi des mesures de précaution. C’est le cas de la République fédérale d’Allemagne (RFA) qui définit dans sa Loi fondamentale comme inconstitutionnels tous les partis qui représentent une menace pour la démocratie, mais aussi de la République démocratique allemande (RDA), où l’idéologie fasciste est naturellement proscrite. C’est également le cas de l’Italie. Là, la Constitution, entrée en vigueur en janvier 1948, interdit dans sa XIIᵉ disposition finale la réorganisation « sous quelque forme que ce soit du parti fasciste dissous ». Ce principe est en outre immédiatement accompagné d’une loi, approuvée en décembre 1947, puis d’une autre en 1952 : la loi Scelba (du nom de son initiateur, Mario Scelba, ministre de l’intérieur démocrate-chrétien), encore en vigueur aujourd’hui.
L’extrême droite malgré la démocratie militante
Il apparaît évident que les démocraties (et les acteurs sociaux qui les animent au quotidien) n’ont pas hésité à intervenir à différents moments de leur histoire pour contenir les risques de l’extrême droite, mais pourquoi alors cette dernière a-t-elle réussi à émerger ?
Nous pourrions répondre en insistant sur le fait que certaines de ces mesures n’ont pas bien fonctionné. C’est, par exemple, le cas de l’Italie, où le choix de se référer, dans les différents dispositifs législatifs uniquement au parti fasciste dissous (celui fondé par Mussolini) rend très difficile l’application de la loi : il est en effet peu probable qu’un parti d’extrême droite tente de reconstituer précisément ce parti.
Cependant, il serait naïf de lier directement la montée des formations d’extrême droite à l’échec des mesures visant à protéger la démocratie. Cela reviendrait à surestimer la portée et l’effet de ces mêmes mesures. Dans le cas de la France, par exemple, il convient de préciser que la législation n’était pas conçue pour faire disparaître n’importe quel parti d’extrême droite, mais uniquement les formations paramilitaires. Même la récente modification du cadre législatif n’a pas modifié substantiellement la situation. L’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI), entré en vigueur en mai 2012 (et modifié le 26 août 2021), a abrogé les dispositions de la loi du 10 janvier 1936, sans toutefois en changer la substance. La mesure est donc efficace, comme le démontre le fait que, par décret du 12 juillet 2013, le président de la République a effectivement dissous plusieurs groupes, parmi lesquels Troisième Voie, à la suite de la mort de l’activiste antifasciste Clément Méric, tué le 6 juin 2013 par des sympathisants de ce mouvement (d’autres exemples pourraient être cités). Toutefois, cela n’empêche aucun parti d’extrême droite de participer à la vie démocratique, s’il ne provoque pas « des manifestations armées ou (…) des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ou s’il ne présente pas « le caractère de groupes de combat ou de milices privées ». Cela explique donc, par exemple, la capacité du Front national à s’insérer dans l’arène politique.
Le cas allemand nous montre sans aucun doute des lois aux effets plus larges. De nombreux partis y ont été dissous ; le premier étant, si l’on considère l’Allemagne fédérale, le Sozialistische Reichspartei en 1952. Mais là encore, il serait erroné de surestimer la portée de ces mesures : le droit allemand préfère généralement adopter une approche progressive – suspendre les financements publics, par exemple, ou placer les dirigeants sous surveillance. Seulement, dans des cas extrêmes, on en arrive à la dissolution sur laquelle seule la Cour constitutionnelle est habilitée à se prononcer.
Une interdiction contre-productive ?
Juger de l’efficacité des démocraties militantes est une tâche vraiment complexe. Dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit que les dispositifs visant à protéger la démocratie sont le produit de contextes historiques spécifiques : ils doivent donc être replacés dans leur époque.
Ces dispositifs ont, dans l’ensemble, généralement fonctionné pour contrer un ennemi à un stade embryonnaire (le BUF au Royaume-Uni et les ligues d’extrême droite en France) et aujourd’hui encore, ils parviennent à exercer un effet dissuasif potentiel, contraignant les partis antidémocratiques – et leurs dirigeants – à se réadapter et à se repositionner. Cette réadaptation formelle pouvant d’ailleurs conduire progressivement à une transformation plus substantielle du parti.
À l’inverse, ces dispositifs semblent à présent perdre de leur efficacité lorsqu’ils deviennent trop « encombrants » – dans le cas de la potentielle interdiction d’un parti populaire comme l’AfD par exemple. Si l’interdiction de petites formations paramilitaires peut rassurer les citoyens, celle de grands partis risquerait d’être perçue comme un acte de force. Un éloignement encore plus grand d’une partie de la population de la culture démocratique serait alors un scénario plus que probable.
![]()
Andrea Martini est membre de l’Institut Français de Géopolitique (IFG) de Paris 8. Il a reçu des financements du programme de recherche et d’innovation Horizon Europe de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n°101150204 (NEXTRIGHT)..
– ref. Devrait-on interdire les partis qui menacent la démocratie ? – https://theconversation.com/devrait-on-interdire-les-partis-qui-menacent-la-democratie-267894