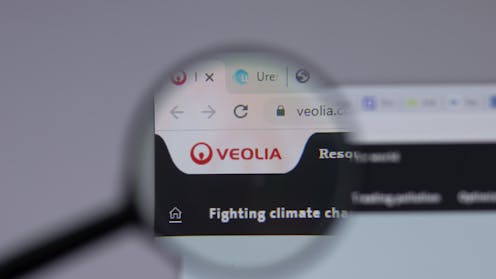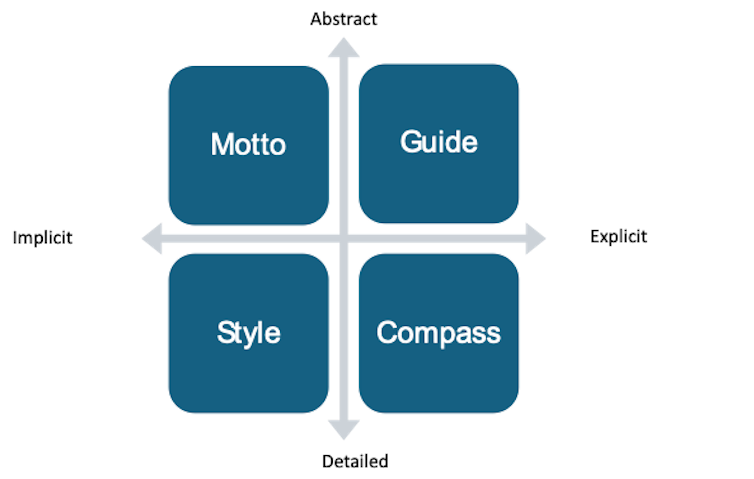Source: The Conversation – in French – By Salah Ben Hammou, Postdoctoral Research Associate, Rice University
Août 2025 marque les cinq ans du coup d’État au Mali. En 2020, des soldats ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce coup a bouleversé la vie politique malienne. Mais il a aussi ouvert la voie à une série de prises de pouvoir militaires dans d’autres pays africains, entre 2020 et 2023
Des soldats ont renversé les gouvernements du Niger, du Burkina Faso (à deux reprises), du Soudan, du Tchad, de la Guinée et du Gabon.
Le retour des coups d’État militaires a choqué de nombreux observateurs.
On pensait que ces pratiques appartenaient au passé, à l’époque de la guerre froide. Elles semblaient avoir disparu. Pourtant, elles font leur retour.
Aucun nouveau coup d’État n’a eu lieu depuis celui du Gabon en 2023. Mais les conséquences sont toujours là. En mai 2025, le général Brice Oligui Nguema, auteur du coup au Gabon, a été officiellement investi président. Ce faisant, il a rompu sa promesse de retirer l’armée du pouvoir.
Au Mali, la junte au pouvoir a dissous tous les partis politiques afin de renforcer son emprise sur le pouvoir.
Dans tous les pays touchés, les dirigeants militaires restent bien implantés. Le Soudan, pour sa part, a sombré dans une guerre civile dévastatrice à la suite du coup d’État de 2021.
Les analystes invoquent souvent la faiblesse des institutions, l’insécurité croissante et le mécontentement populaire à l’égard des gouvernements civils pour expliquer les coups d’État. Si ces facteurs comptent, ils ne suffisent pas pour comprendre ce qui se passe.
J’étudie et écris sur les coups d’État militaires depuis près de dix ans, en particulier sur cette vague de coups d’État.
Mon analyse montre que la communauté internationale doit changer de regard. Ces coups ne sont pas des événements isolés. Ils suivent une logique. Les chefs de junte ne font pas que prendre le pouvoir. Ils s’inspirent les uns des autres. Ils apprennent à s’installer durablement, à contourner les pressions internationales, et à construire un discours qui légitime leur pouvoir.
Pour défendre la démocratie, la communauté internationale doit tirer cinq enseignements des récentes prises de pouvoir militaires.
Principaux enseignements
L’effet domino: À peine un mois après que l’armée guinéenne a renversé le président Alpha Condé, l’armée soudanaise interrompait la transition démocratique dans le pays. Trois mois plus tard, des officiers burkinabés ont renversé le président Roch Marc Christian Kaboré dans un contexte d’insécurité croissante.
Chaque coup d’État a eu des déclencheurs spécifiques, mais le timing suggère plus qu’une simple coïncidence.
Les putschistes potentiels observent ce qui se passe ailleurs. Ils veulent savoir si un coup réussit, mais aussi quels problèmes apparaissent ensuite. Si les auteurs d’un coup sont punis sévèrement, cela peut décourager d’autres tentatives.
La propagation des coups d’État dépend autant des risques perçus que des opportunités. Mais lorsque les coups d’État réussissent, en particulier si les nouveaux dirigeants prennent rapidement le contrôle et évitent une instabilité immédiate, cela envoie un signal encourageant à d’autres militaires tentés par le pouvoir.
Le soutien de la population civile est important : le soutien de la population civile aux coups d’État est une réalité observable.
Depuis le début de la récente vague de coups d’État en Afrique, de nombreux observateurs ont souligné les foules en liesse qui accueillent souvent les soldats, célébrant la chute de régimes impopulaires. Le soutien de la population civile est un aspect souvent sous-estimé.
Pourtant, il donne de la légitimité aux putschistes. Il leur permet aussi de mieux résister aux critiques, aussi bien internes qu’internationales. Par exemple, à la suite du coup d’État de 2023 au Niger, les putschistes ont été confrontés à la condamnation internationale et à la menace d’une intervention militaire. En réponse, des milliers de partisans se sont rassemblés dans la capitale, Niamey, pour soutenir les dirigeants putschistes.
Au Mali, des manifestants ont envahi les rues en 2020 pour saluer le renversement par l’armée du président Ibrahim Boubacar Keïta. En Guinée, des foules se sont rassemblées derrière la junte après la destitution d’Alpha Condé en 2021. Et au Burkina Faso, les deux coups d’État de 2022 ont été accueillis par une approbation généralisée.
Réactions internationales : La réaction de la communauté internationale envoie des signaux tout aussi forts. Lorsque ces réactions sont faibles, tardives ou incohérentes – comme l’absence de sanctions significatives, la suspension symbolique de l’aide ou l’exclusion symbolique des instances régionales –, elles peuvent donner l’impression que la prise illégale du pouvoir ne coûte pas grand chose.
Les réactions internationales aux récents coups d’État ont été mitigées. Certaines, comme celle du Niger, ont déclenché des réactions initiales fortes, notamment des sanctions et des menaces d’intervention militaire .
Mais au Tchad, la prise de pouvoir de Mahamat Déby en 2021 a été légitimée par les principaux acteurs internationaux, qui l’ont présentée comme une mesure nécessaire pour assurer la stabilité après la mort au combat de son père, le président Idriss Déby, aux mains des forces rebelles.
En Guinée et au Gabon, les mesures de suspensions régionales ont été largement symboliques, avec peu de pression pour rétablir le pouvoir civil. Au Mali et au Burkina Faso, les calendriers de transition ont été prolongés à plusieurs reprises sans grande opposition.
Cette incohérence indique aux auteurs des coups d’État que la prise du pouvoir peut provoquer l’indignation, mais rarement des conséquences durables.
Les auteurs de coups d’État apprennent les uns des autres : l’effet domino ne se limite pas au moment de la prise de pouvoir. Les auteurs de coups d’État tirent également des leçons de la manière dont leurs prédécesseurs se sont maintenus au pouvoir. Ils observent quelles tactiques permettent de neutraliser l’opposition et de prolonger leur emprise sur le pouvoir.
En général, dans les pays touchés, le pouvoir militaire s’installe dans la durée. En moyenne, les dirigeants militaires restent au pouvoir pendant près de 1 000 jours depuis le début de la vague actuelle. Avant cette vague, les dirigeants militaires conservaient le pouvoir pendant 22 jours en moyenne depuis l’année 2000.
Au Tchad, Mahamat Déby a consolidé son pouvoir grâce à des élections contestées en 2024. Le Gabonais Nguema lui a emboîté le pas en 2025, remportant près de 90 % des voix après que des modifications constitutionnelles lui ont ouvert la voie.
Dans ces deux cas, les élections ont servi à donner une apparence démocratique à des régimes militaires. Mais sur le fond, le rôle de l’armée reste inchangé.
Relier les pièces du puzzle
Les gouvernements putschistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont tourné le dos à l’Occident pour se rapprocher de la Russie, renforçant ainsi leurs liens militaires et économiques. Les trois pays ont quitté la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et formé l’Alliance des États du Sahel (AES), dénonçant les pressions régionales.
S’aligner sur la Russie offre à ces régimes un soutien extérieur et un vernis de souveraineté, tout en légitimant l’autoritarisme sous couvert d’indépendance.
La dernière leçon est claire : lorsque les coups d’État sont traités comme des événements isolés plutôt que comme des phénomènes interconnectés, il y a de fortes chances que d’autres suivent. Les comploteurs potentiels observent la réaction des citoyens, la réponse du monde et la manière dont les autres leaders putschistes consolident leur pouvoir.
Et si le message qu’ils reçoivent est que les coups sont tolérés, qu’ils peuvent réussir, l’effet dissuasif s’affaiblit.
Poema Sumrow, chercheur au Baker Institute, a contribué à cet article
![]()
Salah Ben Hammou does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
– ref. Afrique de l’Ouest : cinq leçons pour comprendre la vague de coups d’État et préserver la démocratie – https://theconversation.com/afrique-de-louest-cinq-lecons-pour-comprendre-la-vague-de-coups-detat-et-preserver-la-democratie-260641