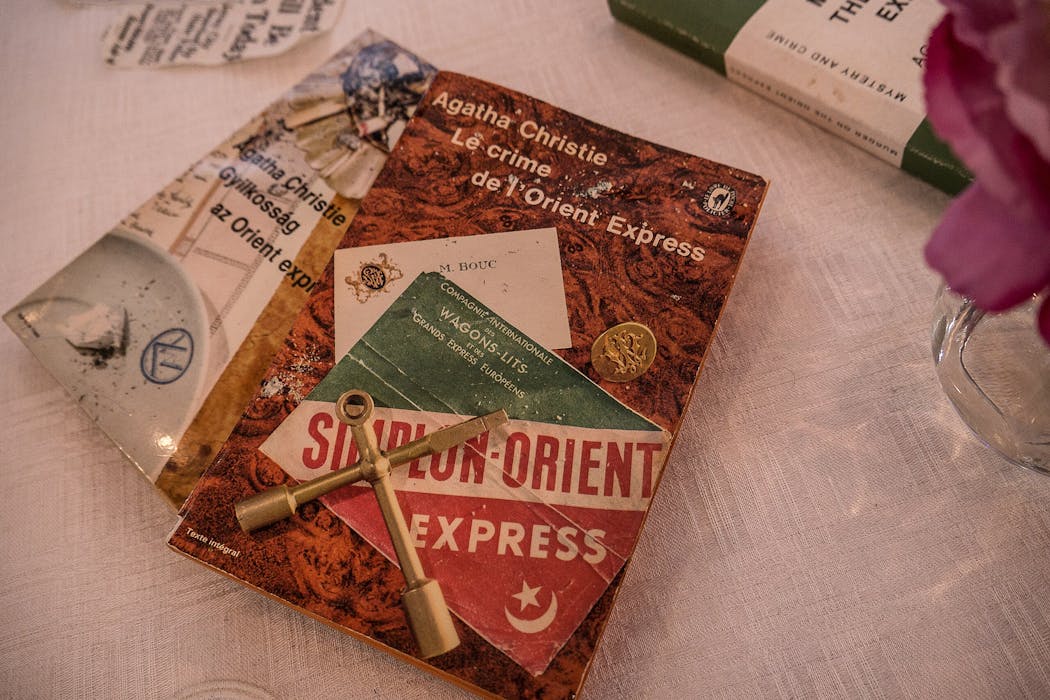Source: The Conversation – in French – By Nitin Deckha, Lecturer in Justice Studies, Early Childhood Studies, Community and Social Services and Electives, University of Guelph-Humber
Les travailleurs de la génération Z font état de niveaux d’épuisement professionnel parmi les plus élevés jamais enregistrés, et de nouvelles recherches suggèrent qu’ils croulent sous un stress sans précédent.
Si les personnes de tous âges affichent des niveaux d’épuisement professionnel, la génération Z et la génération Y signalent un « pic d’épuisement professionnel » à un âge plus précoce. Aux États-Unis, un sondage réalisé auprès de 2 000 adultes a révélé qu’un quart des Américains sont épuisés avant l’âge de 30 ans.
De même, une étude britannique a mesuré l’épuisement professionnel sur une période de 18 mois après la pandémie de Covid-19 et a révélé que les jeunes de la génération Z signalaient des niveaux d’épuisement professionnel de 80 %. Des niveaux plus élevés d’épuisement professionnel parmi la cohorte de la génération Z ont également été signalés par la BBC il y a quelques années.
Une enquête menée dans 11 pays auprès de plus de 13 000 employés et cadres de première ligne a révélé que les travailleurs de la génération Z étaient plus susceptibles de se sentir épuisés (83 %) que les autres employés (75 %).
Une autre étude internationale sur le bien-être a révélé que près d’un quart des 18-24 ans souffraient d’un « stress ingérable », 98 % d’entre eux déclarant présenter un ou plusieurs symptômes d’épuisement professionnel.
Au Canada, un sondage réalisé par Canadian Business a révélé que 51 % des répondants de la génération Z se sentaient épuisés, un pourcentage inférieur à celui des millénariaux (55 %), mais supérieur à celui des baby-boomers (29 %) et de la génération X (32 %).
En tant qu’enseignant universitaire depuis de nombreuses années auprès d’étudiants de la génération Z et père de deux enfants de cette génération, je trouve stupéfiant le niveau d’épuisement professionnel de la génération Z dans le monde du travail actuel. Plutôt que de rejeter les jeunes travailleurs en les qualifiant de distraits ou trop exigeants en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous devrions peut-être considérer qu’ils tirent la sonnette d’alarme sur ce qui ne va pas au travail et sur la manière dont nous pouvons y remédier.
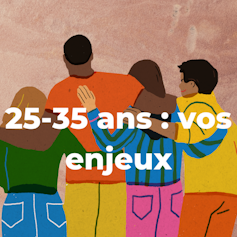
Chacun vit sa vingtaine et sa trentaine à sa façon. Certains économisent pour contracter un prêt hypothécaire quand d’autres se démènent pour payer leur loyer. Certains passent tout leur temps sur les applications de rencontres quand d’autres essaient de comprendre comment élever un enfant. Notre série sur les 25-35 ans aborde vos défis et enjeux de tous les jours.
Qu’est-ce que le l’épuisement professionnel ?
L’épuisement professionnel peut varier d’une personne à l’autre et d’un métier à l’autre, mais les chercheurs s’entendent généralement sur ses caractéristiques fondamentales. Il survient lorsqu’il y a un conflit entre ce qu’un travailleur attend de son emploi et ce que celui-ci exige réellement.
Ce décalage peut prendre plusieurs formes : des tâches professionnelles ambiguës, une surcharge de travail, ou un manque de ressources ou de compétences nécessaires pour répondre aux exigences d’un poste.
En bref, l’épuisement professionnel est plus susceptible de se produire lorsqu’il y a un décalage croissant entre les attentes d’une personne vis-à-vis de son travail et de la réalité. Les jeunes travailleurs, les femmes et les employés ayant moins d’ancienneté sont particulièrement exposés au risque d’épuisement professionnel.
L’épuisement professionnel évolue généralement selon trois dimensions. Si la fatigue en est souvent le premier symptôme perceptible, le deuxième est le cynisme ou la dépersonnalisation, qui conduit à l’aliénation et au détachement du travail. Ce détachement conduit à la troisième dimension de l’épuisement professionnel : une baisse du sentiment d’accomplissement personnel ou d’efficacité personnelle.
À lire aussi :
Comment les Z s’épanouissent au travail dans un marché de l’emploi dominé par la « culture de l’agitation »
Pourquoi la génération Z est-elle particulièrement vulnérable à l’épuisement professionnel ?
La génération Z est vulnérable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, de nombreux membres de la génération Z sont entrés sur le marché du travail pendant et après la pandémie de Covid-19.
C’était une période de profonds bouleversements, d’isolement social et de changement des protocoles et des exigences de travail. Ces conditions ont perturbé l’apprentissage informel qui se fait généralement par le biais d’interactions quotidiennes avec des collègues, difficiles à reproduire dans le cadre d’un travail à distance.
Deuxièmement, les pressions économiques générales se sont intensifiées. Comme l’affirme l’économiste américaine Pavlina Tcherneva, « la mort du contrat social et la précarisation des emplois » – l’espoir qu’une formation universitaire déboucherait sur un emploi bien rémunéré – a laissé de nombreux jeunes dans une situation beaucoup plus précaire.
L’intensification des perturbations économiques, l’aggravation des inégalités, l’augmentation des coûts du logement et de la vie et la montée de l’emploi précaire ont exercé une pression financière accrue sur cette génération.
Un troisième facteur est la restructuration du travail qui s’opère sous l’influence de l’intelligence artificielle. Comme l’a écrit Ann Kowal Smith, spécialiste des stratégies en milieu de travail, dans un article récent publié dans Forbes, la génération Z est la première génération à entrer sur un marché du travail défini par une « nouvelle architecture du travail : des horaires hybrides qui fragmentent les relations, une automatisation qui supprime le contexte et des dirigeants trop occupés pour donner l’exemple en matière de jugement ».
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Que peut-on faire ?
Si vous lisez cet article et que vous vous sentez épuisé, la première chose à savoir est que vous ne réagissez pas de manière excessive et que vous n’êtes pas seul. Heureusement, il existe des moyens de s’en remettre.
L’un des remèdes les plus négligés contre l’épuisement professionnel consiste à lutter contre l’aliénation et l’isolement qu’il engendre. La meilleure façon d’y parvenir est de créer des liens et d’établir des relations avec les autres, en commençant par vos collègues de travail. Cela peut être aussi simple que de demander à un collègue comment il va après une réunion, ou d’organiser un café hebdomadaire avec un collègue.
À lire aussi :
La génération Z n’est pas intéressée par la gestion intermédiaire. Voici pourquoi elle devrait l’être
Par ailleurs, il est important d’abandonner l’idée que travailler trop est synonyme de mieux travailler. Fixez des limites au travail en bloquant du temps dans votre agenda et en indiquant clairement votre disponibilité à vos collègues.
Mais les stratégies d’adaptation individuelles ont leurs limites. Les solutions plus fondamentales doivent venir des lieux de travail eux-mêmes. Les employeurs doivent proposer des conditions de travail plus flexibles, notamment en matière de bien-être et de santé mentale. Les dirigeants et les responsables doivent communiquer clairement leurs attentes professionnelles, et les lieux de travail doivent mettre en place des politiques visant à examiner et à redistribuer de manière proactive les charges de travail excessives.
Kowal Smith a également suggéré de mettre en place une nouvelle « architecture d’apprentissage » sur le lieu de travail, qui inclurait le mentorat, fournirait des boucles de rétroaction et récompenserait la curiosité et l’agilité.
Ces efforts conjugués de transformation du lieu de travail pourraient humaniser celui-ci, réduire l’épuisement professionnel et améliorer l’engagement, même à l’ère de l’intelligence artificielle. Un lieu de travail qui convient mieux à la génération Z est finalement plus efficace pour nous tous.
![]()
Nitin Deckha est membre de l’Institute for Performance and Learning et de la Canadian Community of Corporate Educators.
– ref. La génération Z souffre davantage d’épuisement professionnel que toute autre génération. Voici pourquoi et ce qui peut être fait – https://theconversation.com/la-generation-z-souffre-davantage-depuisement-professionnel-que-toute-autre-generation-voici-pourquoi-et-ce-qui-peut-etre-fait-272142