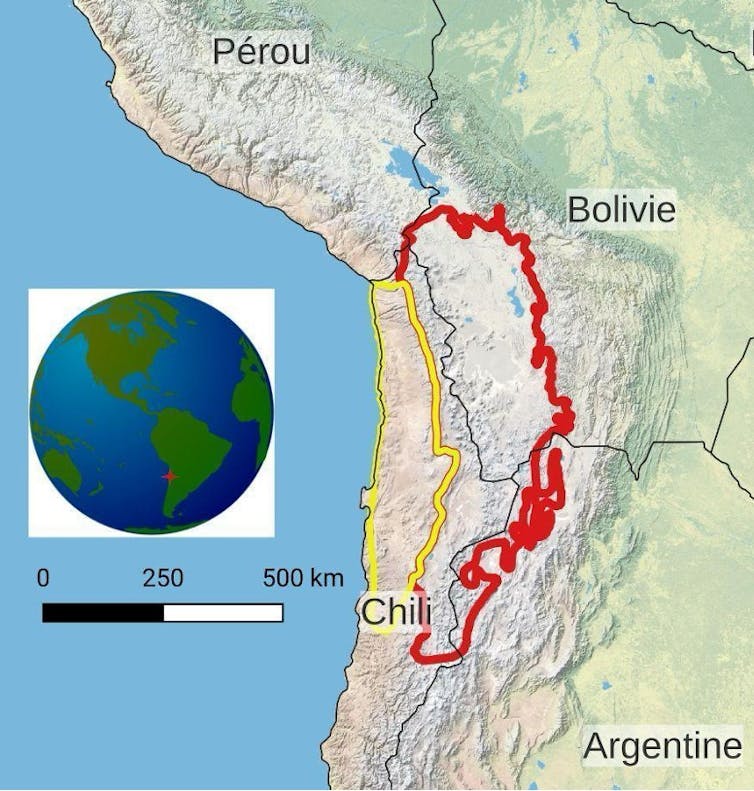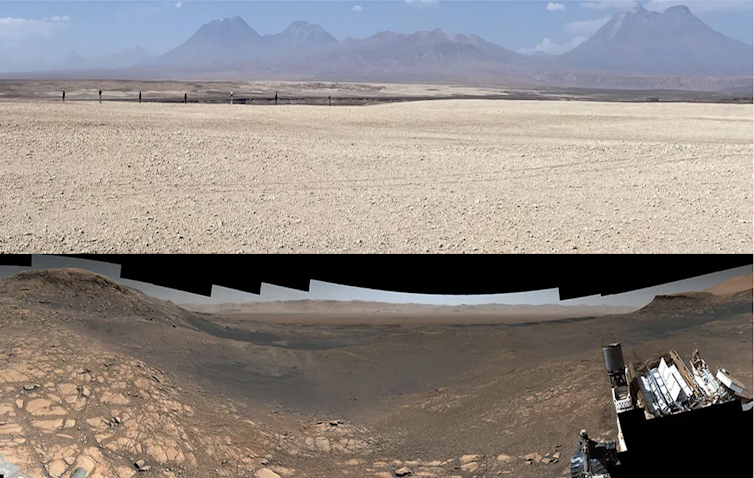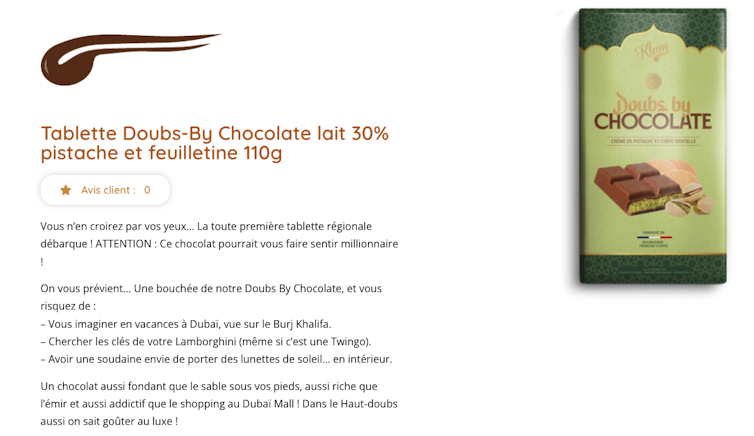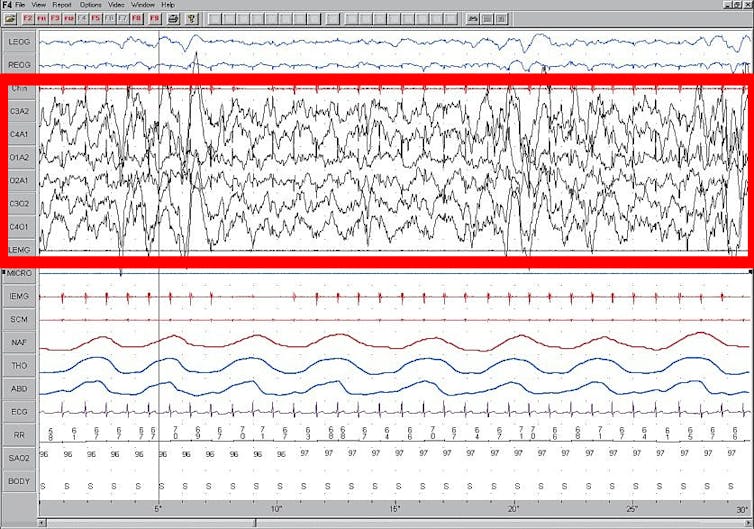Source: The Conversation – in French – By Romuald Blanc, MCU-Psychologue clinicien, Université de Tours
Qu’est-ce que l’intelligence ? Comment la définir, et l’évaluer ? Il n’existe pas de réponse simple à ces questions, qui ont fait l’objet de nombreux travaux de recherche. Voici quelques pistes de réflexion.
L’intelligence est un concept complexe, qui englobe plusieurs sortes de capacités cognitives, comme la résolution de problèmes, la pensée abstraite, l’apprentissage et l’adaptation.
Elle ne se limite pas aux performances scolaires, mais inclut aussi des dimensions émotionnelles (l’ajustement émotionnel aux autres, la capacité à agir sur ses propres émotions ou « autorégulation émotionnelle »), sociales (l’adaptation sociale et prise en compte des règles et des conventions sociales qui régissent les relations humaines) et pratiques (l’adaptation au quotidien).
Pour cette raison, définir l’intelligence et l’évaluer est une tâche ardue. Les experts eux-mêmes peinent encore à s’accorder sur sa nature (unique ou multiple), son origine (innée ou acquise) ou ses mécanismes (concernant les processus cognitifs sous-jacents).
Si de nombreux modèles d’intelligence ont été proposés, jusqu’à présent, aucun consensus scientifique incontesté n’a émergé. Globalement, 3 grandes façons de définir l’intelligence se dessinent : les modèles factoriels, les approches dites « multiples » et les modèles neurocognitifs. Voici ce qu’il faut en retenir.
Les modèles factoriels
Parmi les modèles factoriels, citons le modèle mis au point par Charles Edward Spearman, psychologue britannique. Développé en 1904, il repose sur le calcul d’un facteur général d’intelligence (appelé « facteur g »). Celui-ci serait commun à toutes les tâches cognitives, tandis que pour chaque activité il existerait des facteurs spécifiques : un facteur verbal pour le langage, un facteur spatial, etc. Ces « facteurs mentaux » sont déterminés grâce à une méthode mathématique appelée analyse factorielle.
Le modèle de Spearman implique que toutes les performances intellectuelles sont corrélées. L’intelligence serait donc une capacité unique. Bien que critiqué pour son caractère réducteur, il reste une référence dans la psychométrie et la conception des tests de quotient intellectuel.
Dans les années 1930, Louis Leon Thurstone, un psychologue américain, conteste cette vision. Il affirme que l’intelligence n’est pas une capacité unique, mais un ensemble de compétences mentales primaires indépendantes. En se basant sur des analyses factorielles de tests d’intelligence qu’il a fait passer à des étudiants, il détermine qu’il existerait 7 aptitudes mentales primaires : la compréhension verbale, la fluidité verbale, les aptitudes numériques, la visualisation spatiale, la mémoire, la vitesse perceptive et le raisonnement inductif.
En 1963, dans la lignée de ces travaux, le psychologue anglo-américain Raymond Bernard Cattell défend l’idée que l’intelligence générale se divise en deux catégories principales : l’intelligence fluide, qui correspond à notre capacité à traiter de nouvelles informations, à apprendre et à résoudre des problèmes ; et l’intelligence cristallisée, qui s’apparente à nos connaissances stockées, accumulées au fil des ans.
Ce dernier modèle a influencé de nombreux tests d’intelligence modernes, comme les échelles d’intelligence de Wechsler. Il explique pourquoi certaines personnes âgées peuvent exceller dans des domaines nécessitant des connaissances établies, malgré une baisse de leurs capacités de raisonnement abstrait. Il est utilisé en psychologie cognitive et en neurosciences pour étudier le vieillissement cognitif.
Les approches multiples de l’intelligence
En se positionnant face aux modèles antérieurs, jugés réducteurs, le psychologue états-unien Howard Gardner a développé, au début des années 1980, un autre modèle de l’intelligence, intégrant les composantes sociales et culturelles. Son intérêt pour des populations atypiques telles que les enfants dits « prodiges », les « idiots-savants », ou encore les personnes avec autisme lui ont permis de prendre en considération des différentes facettes de l’activité cognitive, en respectant des différences de chacun selon ses forces, ses faiblesses et ses styles cognitifs.
Il définit ainsi huit grandes facettes de l’intelligence : linguistique, logico-mathématique, spatiale, kinesthésique, musicale, interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste. Gardner propose que chacun peut développer ces intelligences à différents niveaux et qu’il existe de nombreuses façons d’être intelligent dans chacune de ces catégories.
Bien que novateur, ce modèle est critiqué pour son manque de fondement scientifique et la subjectivité de ses catégories. Certains chercheurs y voient plutôt des talents que de véritables formes d’intelligences, et son efficacité pédagogique reste à démontrer. Des critiques suggèrent que la théorie des intelligences multiples manque de fondements scientifiques solides et repose sur des catégories subjectives, souvent perçues davantage comme des talents ou des traits de personnalité que comme des formes distinctes d’intelligence.
En 1985, le psychologue américain Robert Sternberg propose un modèle triarchique de l’intelligence, intégrant des aspects cognitifs, créatifs et pratiques. Il distingue trois formes d’intelligence : analytique (résolution de problèmes logiques), créative (pensée originale et adaptation à la nouveauté) et pratique (adaptation au quotidien, intelligence sociale).
Contrairement à Spearman et Thurstone, qui envisagent l’intelligence comme un ensemble de capacités cognitives mesurables (facteur g ou aptitudes primaires), Sternberg la conçoit comme un processus adaptatif. Être intelligent, c’est savoir s’adapter à de nouvelles situations, choisir des environnements favorables et les modifier si nécessaire.
Réussir à s’intégrer dans un nouvel environnement culturel illustre par exemple cette intelligence pratique et contextuelle. Là où Spearman ou Thurstone y verraient l’expression d’aptitudes générales (raisonnement, compréhension), Sternberg y voit surtout la mise en œuvre de stratégies d’adaptation à un contexte changeant.
La théorie de Sternberg est plus étayée empiriquement que celle de Gardner, car ses composantes (analytique, créative, pratique) peuvent être testées et appliquées en éducation ou en milieu professionnel, pour mieux évaluer les compétences individuelles. La typologie proposée par Gardner, séduisante, est en revanche moins validée scientifiquement.
Si Sternberg reste plus opérationnel et crédible sur le plan scientifique, les deux approches complètent les modèles psychométriques, en mettant l’accent sur l’adaptation et le contexte.
Les modèles neurocognitifs de l’intelligence
Les modèles les plus récents d’intelligence s’appuient sur les connaissances acquises notamment grâce aux progrès effectués en neuro-imagerie (notamment grâce à l’IRM fonctionnelle, qui permet d’observer le fonctionnement cérébral lors de la réalisation d’une tâche donnée).
Ces modèles mettent en avant le rôle des réseaux cérébraux et des fonctions cognitives. Parmi les principaux, on peut citer :
-
la théorie de l’intégration fronto-pariétale : selon cette théorie, l’intelligence serait basée sur l’intégration, c’est-à-dire le traitement coordonné et harmonieux des informations entre différentes régions du cerveau, notamment entre le cortex pariétal (impliqué dans le raisonnement et le traitement spatial) et le cortex préfrontal (impliqué dans le contrôle exécutif, c’est-à-dire la régulation et la coordination des pensées, des actions et des émotions pour atteindre un but) ;
-
le modèle des fonctions exécutives : ce modèle souligne le rôle clé de la mémoire de travail (capacité à maintenir et manipuler temporairement des informations), de la flexibilité cognitive (capacité à changer de stratégie ou de point de vue) et de l’inhibition (capacité à résister à des automatismes ou distractions). Ces fonctions, essentielles pour la planification et l’adaptation, sont fortement associées au cortex préfrontal ;
-
les approches bayésiennes : elles mettent en avant l’idée que le cerveau agit comme un système prédictif, c’est-à-dire qu’il formule en permanence des hypothèses sur le monde à partir de ses expériences passées, puis les ajuste en fonction des nouvelles informations sensorielles (par exemple, lorsque nous marchons dans une rue et que nous entendons un bruit de moteur derrière nous, notre cerveau prévoit qu’une voiture approche. Si le bruit s’éloigne au lieu de se rapprocher, il met à jour son modèle interne pour ajuster sa prédiction) ;
-
le modèle des réseaux en petits mondes : ce modèle repose sur l’idée que l’intelligence dépend de l’efficacité des connexions neuronales et de la plasticité cérébrale. Le cerveau humain est organisé selon une architecture dite en petit monde, c’est-à-dire un réseau dans lequel les neurones (ou régions cérébrales) sont à la fois fortement connectés localement (favorisant la spécialisation) et efficacement reliés à distance (favorisant l’intégration globale de l’information).
Cela signifie qu’il existe des différences interindividuelles : certaines personnes présentent des réseaux cérébraux plus efficaces, caractérisés par un équilibre optimal entre connectivité locale et connectivité globale, ce qui serait associé à de meilleures performances cognitives et à un quotient intellectuel plus élevé. Cependant, cette efficacité n’est pas figée : elle peut être modifiée par l’expérience, l’apprentissage, l’entraînement cognitif ou encore par des changements développementaux (enfance, adolescence) et neurobiologiques (plasticité synaptique, myélinisation). En d’autres termes, le cerveau peut réorganiser ses connexions pour améliorer la circulation de l’information.
Tous ces modèles postulent que l’intelligence est distribuée : elle reposerait sur l’interaction entre différentes régions du cerveau.
La théorie de l’intégration fronto-pariétale et le modèle des fonctions exécutives sont bien étayés empiriquement, grâce à des données de neuro-imagerie et des tâches expérimentales standardisées. Les approches bayésiennes offrent un cadre explicatif puissant, mais plus théorique et difficile à tester directement. Enfin, le modèle des réseaux en petits mondes est empiriquement mesurable, mais surtout corrélationnel.
Ces modèles ne s’opposent pas aux approches développementales classiques, ils les complètent en proposant une explication cérébrale et fonctionnelle des mécanismes qui sous-tendent le développement de l’intelligence
Une absence de consensus
À la fois universelle et plurielle, l’intelligence est un concept complexe, polymorphe et multidimensionnel. L’évaluer n’est pas chose aisée. Sa richesse ne peut être appréhendée à la seule aune de tests standardisés tels que le quotient intellectuel, car celui-ci ne prend pas en compte toutes les formes d’intelligence, ignorant notamment l’intelligence émotionnelle ou créative.
Une compréhension complète de l’intelligence exige de ce fait une approche globale et nuancée. À ce titre, les divers modèles de l’intelligence offrent une vision enrichissante de la complexité de ce concept, en proposant de reconnaître et de valoriser les différentes compétences et talents que chaque individu possède.
En nous incitant à adopter une perspective plus large sur l’intelligence, ils nous aident à mieux comprendre et à soutenir le développement des capacités des individus dans toute leur diversité.
Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.
![]()
Romuald Blanc ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. L’intelligence, un concept aux multiples facettes – https://theconversation.com/lintelligence-un-concept-aux-multiples-facettes-255131