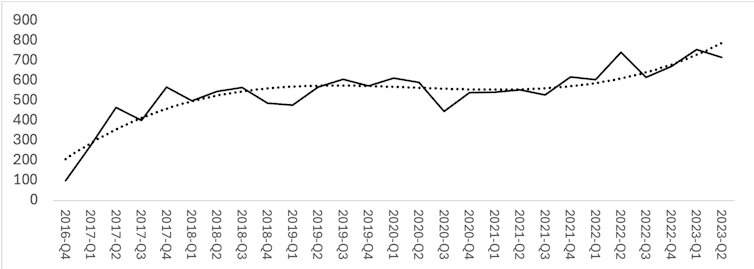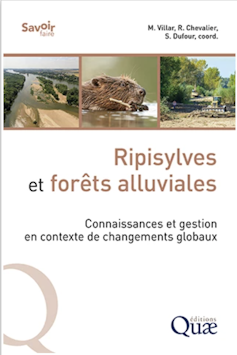Source: The Conversation – France in French (3) – By Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine, Université de Rouen Normandie
Maria Corina Machado est certes une personnalité courageuse et déterminée, qui combat depuis des années le régime autoritaire en place dans son pays, le Venezuela. Mais certaines de ses prises de position semblent peu compatibles avec l’obtention d’un prix Nobel de la paix. La récompense qui lui a été attribuée, le 10 octobre 2025, pourrait apaiser Donald Trump, qui soutient depuis longtemps son action et qui se trouve engagé dans un bras de fer de plus en plus tendu avec le pouvoir vénézuélien dirigé par Nicolás Maduro.
La campagne de Donald Trump pour l’obtention du prix Nobel de la paix a été aussi inédite que pressante. La désignation de Maria Corina Machado a beaucoup surpris.
Certes, elle vient couronner une lutte infatigable contre le gouvernement autoritaire de Nicolás Maduro ; mais le profil de la lauréate est davantage celui d’une militante opposée à la dictature de son pays que d’une pacifiste. Cela reflète la tendance du Comité Nobel norvégien à davantage récompenser, ces dernières années, des promoteurs de la démocratie dans des régimes opposés aux intérêts géopolitiques occidentaux que des personnalités ayant « ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix » comme le souhaitait Alfred Nobel dans son testament.
Ainsi, Maria Corina Machado s’inscrit dans la lignée du journaliste russe Dmitri Mouratov, lauréat en 2021, du militant des droits humains biélorusse Ales Bialiatski et de l’ONG russe Mémorial, célébrés en 2022, ou encore de Narges Mohammadi, militante des droits humains iranienne récompensée en 2023.
Qui est Maria Corina Machado ?
Le rapport à la paix de Maria Corina Machado mérite d’être questionné. En effet, outre son soutien à la tentative de coup d’État d’avril 2002 contre Hugo Chavez, alors président démocratiquement élu (soutien partagé par de larges secteurs de l’opposition vénézuélienne), Machado, âgée aujourd’hui de 58 ans, incarne les fractions les plus radicales des détracteurs d’Hugo Chavez puis de son successeur (depuis 2013) Nicolás Maduro et les plus subordonnées aux stratégies les plus brutales des États-Unis contre le gouvernement vénézuélien.
Ainsi, elle a été reçue par George W. Bush dans le bureau Ovale, le 31 mai 2005, en pleine guerre en Irak. En 2019, au moment de l’auto-proclamation de Juan Guaido comme chef de l’État vénézuélien alternatif, qui sera reconnu par une soixantaine de pays, elle en appelait à une intervention militaire étrangère contre le Venezuela parce que « les démocraties occidentales doivent comprendre qu’un régime criminel ne sera chassé du pouvoir que par la menace crédible, imminente et grave d’un recours à la force ».
Plus récemment encore, début octobre, à l’antenne de Fox News, elle remerciait Donald Trump pour les assassinats ciblés qu’il commet dans la mer des Caraïbes et pour ses menaces militaires contre son propre pays.
Si d’autres lauréats, aux positionnements idéologiques variés, tels Henry Kissinger, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres ou Juan Manuel Santos, avaient pu commettre ou appeler à commettre des actes violents avant leur désignation, ils avaient rompu avec cette orientation au moment de leur prix ou participé au règlement d’un conflit, aussi provisoirement que ce soit. Ce n’est pas le cas de Maria Corina Machado.
Grâce à ce positionnement intransigeant à l’encontre d’un gouvernement jugé responsable du tournant autoritaire et de l’effondrement économique du pays depuis 2013, elle bénéficie d’une aura importante dans la population vénézuélienne. Le Venezuela a vu son PIB baisser de 74 % entre 2014 et 2020, pour moitié du fait de la mauvaise gestion économique d’Hugo Chavez puis de Nicolás Maduro (en particulier une politique monétaire particulièrement négligente) et pour autre moitié à cause des mesures coercitives unilatérales édictées par Donald Trump durant son premier mandat et soutenues par Maria Corina Machado.
Dans ce marasme, Nicolás Maduro se maintient au pouvoir en dépit d’un soutien électoral minoritaire, à travers l’utilisation des institutions électorales, judiciaires et militaires, ce qui lui a permis de déposséder l’Assemblée nationale, où l’opposition était alors majoritaire, de ses prérogatives en 2015 ; de réprimer, au prix de plus d’une centaine de morts, une vague de manifestations en 2017 ; de réaliser une fraude massive pour inverser les résultats du scrutin présidentiel en 2024…
La popularité de Maria Corina Machado est aujourd’hui puissante : elle a remporté les primaires de l’opposition vénézuélienne en octobre 2023 avec 92,3 % des suffrages exprimés (après le retrait de plusieurs candidats qui n’avaient aucune chance). Après avoir été frappée d’inéligibilité par les institutions pro-Maduro, elle a parcouru le pays en faveur d’un illustre inconnu devenu candidat de l’opposition, Edmundo González Urrutia, suscitant un réel enthousiasme à travers le pays, avec une promesse qui a eu un fort impact : la réunification des familles dans un pays meurtri par l’exode de plus de huit millions de ses compatriotes, soit plus d’un quart de la population nationale.
Nicolás Maduro, en menant à l’échec tous les processus de négociations avec une opposition plus modérée, en limitant drastiquement le droit à la candidature des différentes personnalités, a paradoxalement propulsé son antithèse : libérale économiquement (quoique Maduro mène désormais une politique de dollarisation rampante de son économie) et alignée géopolitiquement sur les États-Unis.
Quelles conséquences pour le Venezuela ?
Les conséquences de ce prix Nobel seront sans doute limitées au Venezuela. Maria Corina Machado a déjà reçu, en octobre 2024, le prix des droits de l’homme Václav-Havel de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et, en décembre 2024, le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit du Parlement européen, à l’initiative des groupes parlementaires de droite et d’extrême droite.
Cela n’a pas changé les conditions de clandestinité dans lesquelles elle vit ni empêché sa brève arrestation en janvier 2025 à l’issue d’une apparition dans une manifestation lors de l’investiture de Nicolás Maduro pour ce nouveau mandat frauduleux.
L’octroi du prix Nobel augmente le coût de sa répression, mais ne change pas la configuration politique vénézuélienne. Dans les conditions de répression que connaît le Venezuela, le Nobel se « célèbre en silence » parmi les nombreux mécontents du gouvernement Maduro.
Parmi les conséquences concrètes de ce prix, on note la fermeture de l’ambassade du Venezuela à Oslo dans le cadre d’une « restructuration intégrale » de ses représentations à l’étranger, alors que la Norvège est médiateur des négocations entre le gouvernement Maduro et l’opposition depuis 2019.
La victoire d’une alliée de Donald Trump
L’octroi de ce prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado est aussi une manière de récompenser Donald Trump sans le dire. Dans le contexte actuel, récompenser une institution défendant le droit international, telles la Cour pénale internationale (CPI) ou la Cour internationale de justice (CIJ), aurait été perçu comme un signal d’irrévérence à l’égard du président états-unien. En revanche, choisir une opposante vénézuélienne qui soutient sa politique dans les Caraïbes est une légitimation de son action.
Depuis août 2025, Donald Trump a déployé la quatrième flotte des États-Unis (l’US Navy) dans la mer des Caraïbes sous le prétexte de lutte contre le narcotrafic.
À la date du 16 octobre 2025, cinq navires ont été détruits par les troupes états-uniennes au large des côtes vénézuéliennes, coûtant la vie à 27 personnes au total.
L’administration Trump avait jusqu’alors privilégié une approche de négociations promue par son conseiller pour les missions spéciales Richard Grenell, sur une base d’échange contractuelle « maintien des licences pétrolières » contre « acceptation des déportations de retour de Vénézuéliens ». La licence de la firme multinationale Chevron a été suspendue en mai pour être rétablie sous d’autres modalités en juillet. Le jour même de l’obtention du prix Nobel par Maria Corina Machado, Shell a obtenu de l’administration de Washington l’autorisation d’extraire du gaz dans la zone Dragon à l’intérieur des eaux vénézuéliennes. Cependant, quelques jours auparavant, Donald Trump avait demandé à Richard Grenell de cesser ses communications avec Nicolás Maduro.
Le locataire de la Maison Blanche semble opter pour une stratégie de changement de régime, portée de longue date par le secrétaire d’État Marco Rubio. Pour autant, une guerre ouverte entre les États-Unis et le Venezuela ne semble pas pour l’heure d’actualité. La dernière intervention directe de Washington en Amérique latine date de 1989, au Panama, déjà au nom de la répression de la complicité des autorités du pays avec le narcotrafic – complicité en l’occurrence avérée.
Toutefois, le Panama représentait en termes militaires une cible mineure par rapport à ce que constitue l’État vénézuélien aujourd’hui, même après une décennie de crise économique. Une campagne militaire, telle que l’opération Midnight Hammer à l’encontre de l’Iran en juin 2025, ne saurait être exclue, d’autant que l’administration Trump vient d’autoriser des actions secrètes de la CIA au Venezuela. Même un journal historique de l’opposition libérale, El Nacional, redoute une telle intervention, considérant qu’il s’agirait d’un cataclysme.
En récompensant Maria Corina Machado, au moment où les menaces états-uniennes contre le Venezuela sont maximales, le Comité Nobel légitime la politique de changement de régime de Donald Trump. Si Maria Corina Machado a dédié son prix au président états-unien, c’est que cette récompense est aussi un peu la sienne.
![]()
Thomas Posado ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Maria Corina Machado, Nobel de la paix : et si Trump avait finalement gagné ? – https://theconversation.com/maria-corina-machado-nobel-de-la-paix-et-si-trump-avait-finalement-gagne-267662