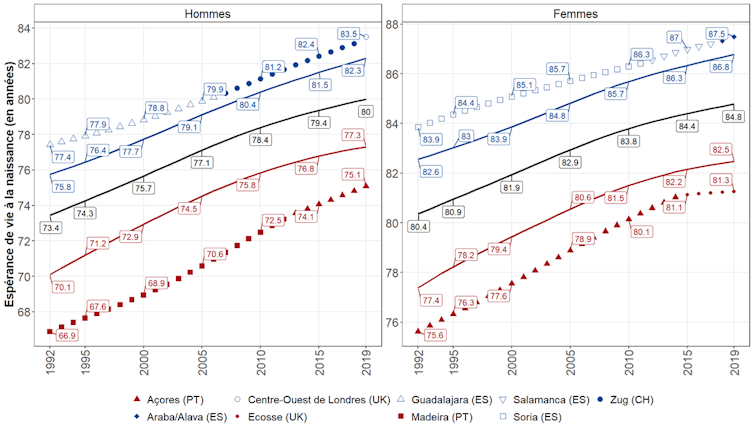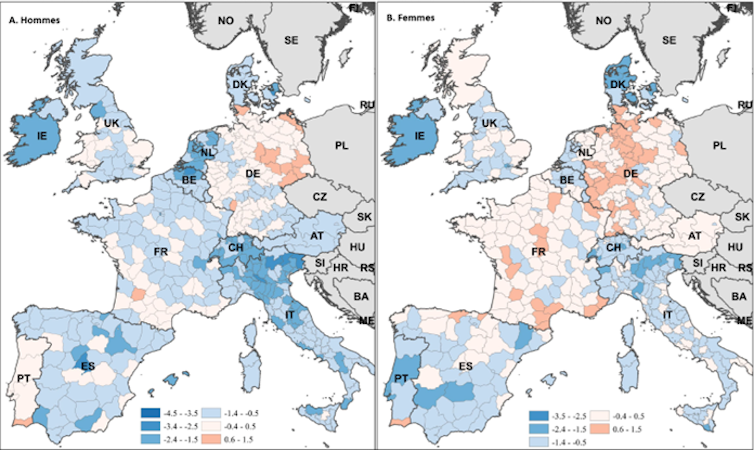Source: The Conversation – (in Spanish) – By María del Mar Ruiz Domínguez, Chair professor, Universidad de Almería

Robó el maíz. Para robarlo,
el Tlacuache lo pintó con los colores
del día y de la noche.
Así confundió a la Señora Lumbre,
y así el tiempo comenzó a tener
medida: las noches seguirían
a los días y los días a las noches.
“Tlacuache, ladrón del fuego” (Tecolote, 2017)
En un país como México, que atesora 68 lenguas originarias y una herencia cultural milenaria, se esperaría que las bibliotecas infantiles estuvieran inundadas de historias sobre el origen del maíz, o de revisiones sobre el comportamiento mítico de jaguares y tlacuaches (zarigüeyas) en las leyendas mayas, náhuatl o zapotecas.
Sin embargo, la realidad es otra: a pesar del auge de las narrativas de los pueblos originarios y de los deseos por preservar las lenguas en riesgo de extinción, los textos de literatura infantil y juvenil que abordan estas temáticas se enfrentan a barreras invisibles, pero firmes. La falta de atención no es casual: es el resultado de décadas de discriminación y políticas que priorizaron el español y su cultura sobre las lenguas de los pueblos originarios, tanto en el ámbito educativo como en otros contextos vitales.
También hay que tener en cuenta el contexto social del mercado editorial mexicano: en 2020 apenas el 6 % de la población habla alguna lengua indígena y no son los jóvenes, sino las personas mayores, las que más las utilizan. Por este motivo, los textos de literatura infantil y juvenil con temáticas de estas comunidades se suelen publicar en español o bien en formato biligüe (español-lengua originaria).
Un mercado bajo el amparo del Estado
Una investigación publicada recientemente y que ha analizado los catálogos de 90 editoriales mexicanas ha mostrado un dato preocupante: apenas el 56 % de los sellos publican textos de literatura para jóvenes que muestran historias, usos, costumbres, leyendas y tradiciones de los pueblos originarios.
Esta presencia resulta frágil, ya que la mayoría de estos títulos no nacen de la iniciativa privada, sino del impulso de programas gubernamentales promovidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) o por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), entre otros.
Bajo el amparo público surgieron colecciones como la Enciclopedia Infantil Colibrí en la que recopiladores, escritores e ilustradores aportaron relatos procedentes de la tradición indígena.
Un importante número de los relatos identificados se están publicando en formato bilingüe español/lengua originaria. Autores como Natalia Toledo o Miguel Cocom apuestan por ediciones bilingües, que permiten que los jóvenes de las comunidades se reconozcan en su propia lengua y costumbres, y que los hispanohablantes descubran la riqueza de su país.
El proyecto Sesenta y ocho voces, sesenta y ocho corazones va un paso más allá, al transformar los relatos originarios en piezas de animación narradas en sus lenguas originales.
Lecturas obligatorias
Es evidente que las iniciativas sufragadas por las instituciones públicas y con respaldo presupuestario han sido esenciales para acercar estas realidades a los jóvenes. Son títulos que además se han incluido en los listados de lecturas obligatorias de las escuelas mexicanas a través de las colecciones de “Libros del Rincón”.
A diferencia de los grandes grupos editoriales, que apenas cuentan con colecciones dedicadas a visibilizar los pueblos originarios, ha surgido un movimiento impulsado por sellos independientes y asociaciones como Gusanos de la memoria o Chuen México, XospaTronic o Taller Leñateros.
La renovación temática en las editoriales independientes iberoamericanas incluye, tal como señalan varios estudios, textos que muestran una realidad más territorial y diversa. Esto permite dar voz a las minorías y colectivos históricamente relegados. Un compromiso que se manifiesta aún de forma incipiente en el mercado mexicano a través de editoriales como Tecolote, Ideazapato o El Naranjo. Pese a todo, el esfuerzo resulta aún insuficiente para equilibrar la balanza.
¿Qué historias se están narrando?
Un análisis de los catálogos editoriales revela que los textos que tratan realidades de los pueblos originarios se agrupan preferentemente en dos tipos de narrativas:
-
Relatos de tradición oral. Son los textos con mayor presencia en las estanterías de las bibliotecas. Se trata de recopilaciones de mitos, leyendas y canciones que intentan preservar la cosmogonía de comunidades como la náhuatl, la maya o la zapoteca.
-
Cuentos literarios. Son relatos de autor que, aunque se inspiran en la tradición, proponen nuevas tramas para los jóvenes lectores de hoy en día.
Sin embargo, resulta llamativo que en los catálogos editoriales apenas figuren álbumes ilustrados que aborden realidades de los pueblos originarios. Mientras que en Europa o Estados Unidos resulta común que los autores “jueguen” con los cuentos clásicos y los reinventen, en México la literatura indígena aún se trata con una reverencia casi sagrada.
Esta carencia es aún más significativa, por cuanto Iberoamérica vive desde hace años un auge del formato álbum en sellos como Fondo de Cultura Económica (FCE), Cayuco, Claraboya ediciones o Ekaré, entre otros. Se trata de un soporte que otorga una gran libertad para recrear ficciones de una misma realidad.
Hacia una narrativa del encuentro y la diversidad
Para que un joven de una ciudad cualquiera no vea como algo extraño una leyenda mixe o un poema en tseltal, hacen falta más que buenas intenciones gubernamentales.
El cierre de esta brecha requiere un mercado editorial que entienda que la diversidad no es un nicho, sino la esencia misma de la identidad mexicana. No basta con publicar cuentos sobre indígenas. Se tiene que permitir que sean los propios autores de los pueblos originarios quienes tomen la palabra, reinterpreten y cuestionen su pasado y reinventen su futuro.
Solo así surgirá en México una literatura infantil y juvenil con voz propia, autóctona, arraigada en su diversidad y diferenciada de la de otros territorios. Publicaciones que valoren su riqueza cultural, que revisiten su pasado, pero con la mirada puesta en el mañana.
![]()
María del Mar Ruiz Domínguez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. El tlacuache no tiene quien le escriba: las editoriales mexicanas relegan la literatura de los pueblos originarios – https://theconversation.com/el-tlacuache-no-tiene-quien-le-escriba-las-editoriales-mexicanas-relegan-la-literatura-de-los-pueblos-originarios-272638