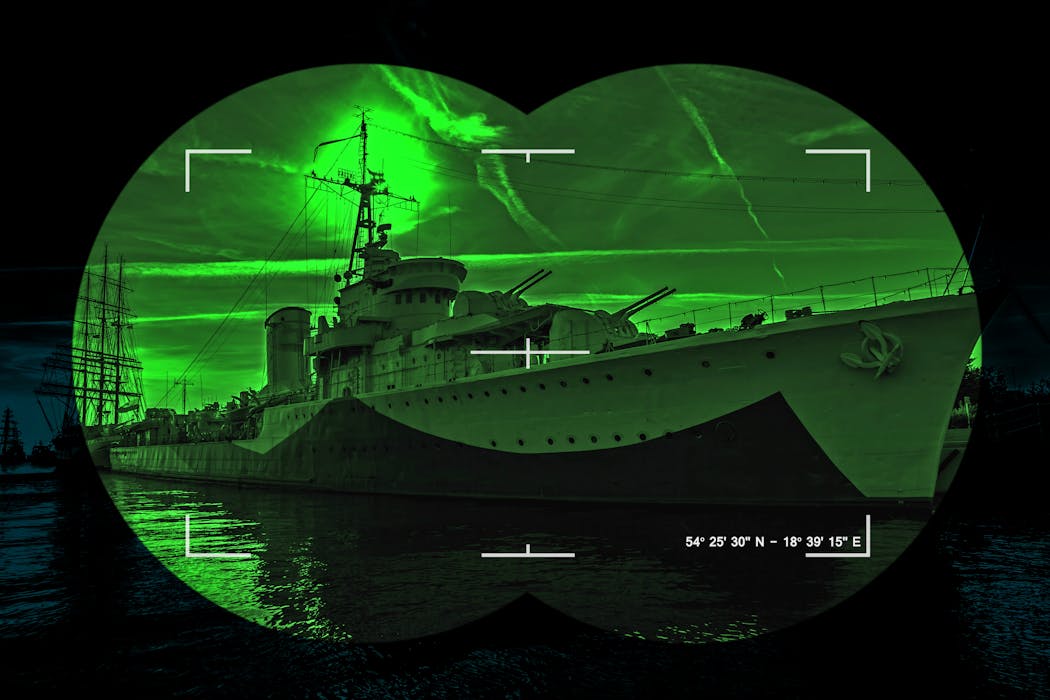Source: The Conversation – in French – By Alain Naef, Assistant Professor, Economics, ESSEC

Une enquête pénale vise Jerome Powell, l’actuel gouverneur de la puissante Réserve fédérale des États-Unis (Fed), dont le mandat arrive à terme en mai 2026. Donald Trump, dont la prérogative est de lui nommer un successeur, souhaite mettre à la tête de la Fed un de ses supporters, Kevin Hassett. Mais alors qui pour être le contre-pouvoir ? Contre-intuitivement, ce pourrait bel et bien être les marchés financiers.
Mervyn King, gouverneur de la Banque d’Angleterre de 2003 à 2013, aimait dire que « l’ambition de la Banque d’Angleterre est d’être ennuyeuse ». Le président de la Banque nationale suisse Thomas Jordan rappelait encore récemment que « la clé du succès est peut-être d’être ennuyeux ». Leur message est clair : la stabilité monétaire repose sur la prévisibilité, pas sur le spectacle.
Avec Donald Trump, cette règle pourrait changer. Le président des États-Unis, lui, n’aime pas être ennuyeux. S’il n’est pas clair que cela lui réussisse en politique intérieure ou extérieure, pour ce qui est de l’économie, c’est différent. La prévisibilité est un moteur de la stabilité des marchés et de la croissance des investissements. Dans ce contexte, les marchés pourraient être l’institution qui lui tient tête.
C’est ce rôle de contre-pouvoir que j’analyse dans cet article. Le conflit à venir se porte sur la nomination du successeur du président de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), la banque centrale des États-Unis, Jerome Powell dont le mandat expire en mai 2026. Dans la loi, le président de la première puissance mondiale a la prérogative de nommer un successeur.
Jerome Powell est actuellement visé par une enquête pénale du département de la justice américain, liée officiellement à la rénovation du siège de la Fed. Le président de la FED, lui, y voit une tentative de pression sur son indépendance, après son refus de baisser les taux d’intérêt. Donald Trump nie toute implication, même s’il dit de Powell qu’il « n’est pas très doué pour construire des bâtiments ». Pour de nombreux observateurs, le timing de l’attaque plaide pour une attaque politique. Les marchés ont réagi avec une montée du prix de l’or.
Car les présidents des banques centrales sont des personnages clés. Avec de simples mots, ils peuvent participer à créer des crises financières. Le président de la Bundesbank eut un rôle dans la crise du système monétaire européen de 1992. Si ce dernier s’était abstenu de faire un commentaire sur l’instabilité de la livre sterling, le Royaume-Uni aurait peut-être rejoint l’euro.
Gouverneurs technocrates
Traditionnellement, le choix du successeur n’est pas uniquement politique. Il se porte sur une figure reconnue, souvent issue du Conseil des gouverneurs. Les sept membres du Conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale sont nommés par le président et confirmés par le Sénat. Il s’agit ordinairement de technocrates.
Les chercheurs Michael Bordo et Klodiana Istrefi montrent que la banque centrale recrute prioritairement des économistes formés dans le monde académique, soulignant la sélection d’experts de la conduite de la politique monétaire. Ils montrent que les clivages entre écoles « saltwater » (Harvard et Berkeley) et « freshwater » (Chicago, Minnesota). Les économistes freshwater étant plus restrictifs (ou hawkish) en termes de baisse de taux, alors que les « saltwater » préfèrent soutenir la croissance.
Ben Bernanke incarne cette tendance. Du 1er février 2006 au 3 février 2014, il est gouverneur de la FED. Après un premier mandat sous la présidente de George W. Bush, Barack Obama le nomme pour un second mandat. Ce professeur d’économie, défenseur de la nouvelle économie keynésienne, gagne le prix Nobel en 2022 pour ses travaux sur les banques et les crises financières. La gouverneure de 2014 à 2018, Janet Yellen, est auparavant professeure d’économie à Berkeley, à Harvard et à la London School of Economics.
Ce processus relativement apolitique est essentiellement technocratique. Ces conventions seront potentiellement bousculées pour la nomination du prochain gouverneur de la banque centrale des États-Unis. Évidemment, certains gouverneurs avaient des préférences politiques ou des liens avec le président.
Kevin Hassett, économiste controversé
Le candidat de Donald Trump pressenti par les médias est Kevin Hassett. Ce dernier s’inscrit dans le sillage de la vision du nouveau président des États-Unis en appelant à des baisses de taux brutales. Il a qualifié Jerome Powell de « mule têtue », ce qui alimente les craintes d’une Fed docile envers la Maison Blanche.
« Kevin Hassett a largement les capacités pour diriger la Fed, la seule question est de savoir lequel se présentera » entre « Kevin Hassett, acteur engagé de l’administration Trump, ou Kevin Hassett, économiste indépendant », explique Claudia Sahm, ancienne économiste de la Fed dans le Financial Times. C’est cette question qui inquiète les marchés. Cela même si l’économiste a presque 10 000 citations pour ses articles scientifiques et a soutenu sa thèse avec Alan Auerbach, un économiste reconnu qui travaille sur les effets des taxes sur l’investissement des entreprises. De façade, Hassett a tout d’un économiste sérieux. Uniquement de façade ?
Les investisseurs s’inquiètent de la politisation de la Fed. Depuis la nomination de Stephen Miran en septembre 2025 au Conseil des gouverneurs, les choses se sont pimentées. Le président du comité des conseillers économiques des États-Unis est un des piliers de la doctrine économique Trump. Il a longtemps travaillé dans le secteur privé, notamment au fonds d’investissement Hudson Bay Capital Management.
Si les votes de la Fed sont anonymes, le Federal Open Market Committee, chargé du contrôle de toutes les opérations d’open market aux États-Unis, publie un graphique soulignant les anticipations de taux d’intérêt des membres. Depuis l’élection de Stephen Miran, un membre vote en permanence pour des baisses drastiques des taux d’intérêt, pour soutenir Donald Trump. Sûrement Miran ?
Si le nouveau président de la Fed faisait la même chose, on pourrait assister à une panique à bord… qui pourrait éroder la confiance dans le dollar. Les investisseurs internationaux ne veulent pas d’une monnaie qui gagne ou perde de la valeur en fonction du cycle électoral américain. Pour que les investisseurs aient confiance dans le dollar, il faut qu’il soit inflexible à la politique.
Les marchés financiers en garde-fou
Le marché, à l’inverse de la Cour suprême des États-Unis ou du Sénat, n’a pas d’incarnation institutionnelle, mais il a tout de même une voix. Il réagit par les prix, mais pas seulement. Si on ne l’écoute pas, le marché pourrait-il hausser le ton, en changeant les prix et les taux d’intérêt ?
Quelles seraient les conséquences de la nomination d’un président de la Fed pro-Trump et favorable à des coupes de taux pour soutenir le mandat de Trump ? Il se peut que les investisseurs institutionnels puissent fuir la dette américaine, du moins à court terme. Cette réaction augmenterait potentiellement les taux d’emprunt du gouvernement, notamment à long terme.
« Personne ne veut revivre un épisode à la Truss », a résumé un investisseur cité par le Financial Times, à la suite de la consultation du Trésor auprès des grands investisseurs. Liz Truss, la première ministre du Royaume-Uni, avait démissionné sous la pression des marchés en septembre 2022. Elle avait essayé dans un « mini-budget » à la fois d’augmenter les dépenses et de réduire les impôts. Quarante-quatre jours plus tard, elle avait dû démissionner à cause de la fuite des investisseurs qui ne voulaient plus de dette anglaise, jugée insoutenable.
Donald Trump ne démissionnera probablement pas quarante-quatre jours après la nomination de Kevin Hassett. Mais, en cas de panique des marchés, Kevin Hassett lui-même pourrait sauter. Et le dollar perdre encore un peu plus de sa splendide.
![]()
Alain Naef a reçu des financements de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
– ref. Le patron de la Fed visé par une enquête pénale : l’indépendance de la banque centrale des États-Unis attaquée – https://theconversation.com/le-patron-de-la-fed-vise-par-une-enquete-penale-lindependance-de-la-banque-centrale-des-etats-unis-attaquee-272522