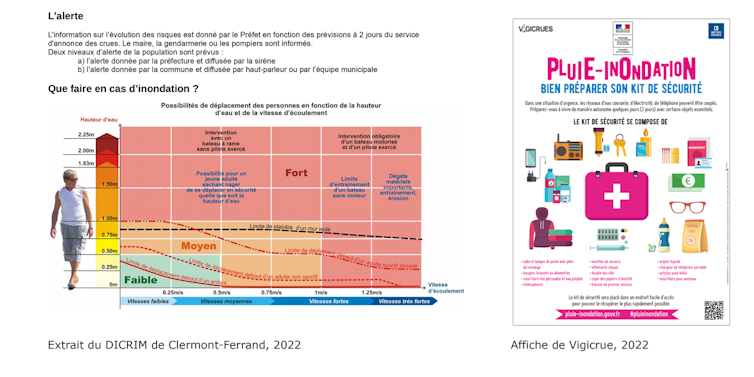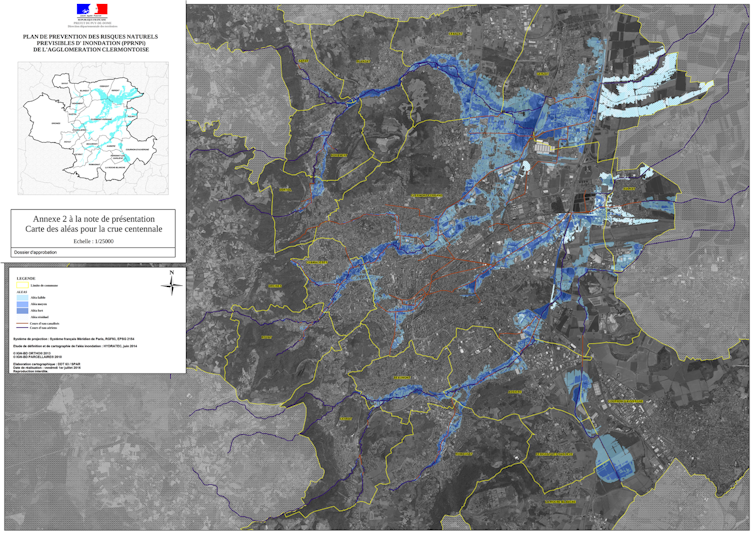Source: The Conversation – in French – By Marwa Lahimer, Chercheuse associée – UMR-I 01 Périnatalité & Risques Toxiques (Peritox), centre universitaire de recherche en santé, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Si on a longtemps considéré que l’infertilité était un problème purement féminin, on sait aujourd’hui qu’il n’en est rien. Selon certaines estimations, 20 % à 30 % des cas sont directement imputables à des problèmes touchant les hommes. En marge des facteurs liés aux modes de vie, un faisceau d’indices semble incriminer notamment certains polluants environnementaux, tels que les pesticides.
À ce jour, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’environ 17,5 % de la population adulte, soit une personne sur six dans le monde est touchée par l’infertilité. Diverses études scientifiques indiquent que cette proportion devrait continuer à progresser jusqu’en 2040.
Ce problème majeur a plusieurs causes, dont certaines sont liées à l’évolution des modes de vie. Sous la pression des contraintes professionnelles ou économiques, l’âge de la parentalité a notamment tendance à reculer dans de nombreux pays.
Toutefois, depuis plusieurs années, les travaux de recherches pointent également le rôle de divers polluants environnementaux, tels que certains pesticides dans l’infertilité. De par leur capacité à perturber le fonctionnement hormonal, ces molécules interfèrent avec le système reproducteur. Nos travaux ont notamment mis en évidence que l’exposition à certaines de ces molécules se traduit, chez les hommes, par une diminution de la qualité du sperme.
Qu’est-ce que l’infertilité ?
L’infertilité est définie comme l’incapacité à obtenir une grossesse après douze mois de rapports sexuels réguliers et non protégés. Lorsqu’elle affecte des couples qui n’ont jamais réussi à concevoir, on parle d’infertilité « primaire ». L’infertilité « secondaire » touche quant à elle les couples qui ont déjà vécu une grossesse, mais qui éprouvent des difficultés à concevoir de nouveau.
Longtemps, l’infertilité a été considérée comme résultant uniquement de problèmes affectant les femmes. En effet, confrontés à une telle situation, les hommes ont tendance à considérer que l’échec de conception remet en question leur virilité, ce qui peut les pousser à refuser les tests médicaux (ou à rejeter la faute sur leur partenaire). Cela a longtemps contribué à passer sous silence une potentielle responsabilité masculine, renforçant l’idée fausse que seules les femmes peuvent être responsables de l’infertilité.
À lire aussi :
Pollution : quand l’environnement menace la fertilité féminine
Si, dans certains pays, les hommes ont encore du mal à reconnaître leur implication dans ce problème majeur, les progrès médicaux ont fait peu à peu prendre conscience que l’infertilité pouvait aussi avoir des origines masculines.
On sait aujourd’hui qu’au moins 20 % des cas sont directement imputables aux hommes, et que ces derniers contribuent à 50 % des cas d’infertilité en général.
À l’origine de l’infertilité, une multitude de facteurs
Les causes de l’infertilité peuvent être multiples. Chez la femme comme chez l’homme, la capacité à engendrer est influencée par l’âge.
Les femmes naissent avec un stock limité d’ovules, qui diminue progressivement avec l’âge, ce qui s’accompagne d’une baisse progressive de la fertilité, jusqu’à la ménopause. Les hommes, quant à eux, sont affectés à partir de la quarantaine par une diminution de la qualité du sperme (notamment le fonctionnement des spermatozoïdes, les gamètes mâles), ce qui a également des conséquences en matière de fertilité.
À lire aussi :
Pollution : quand l’environnement menace la fertilité féminine
Parmi les causes « non naturelles », les scientifiques s’intéressent de plus en plus aux effets de la pollution et des pesticides. Aux États-Unis, les travaux de l’USGS (United States Geological Survey), la principale agence civile de cartographie aux États-Unis, ont révélé qu’environ 50 millions de personnes consomment des eaux souterraines exposées aux pesticides et d’autres produits chimiques utilisés dans l’agriculture.
Preuve des préoccupations des autorités, pour réduire les intoxications causées par les pesticides, en particulier chez les travailleurs agricoles et les manipulateurs de pesticides, des protections professionnelles sont offertes à plus de 2 millions de travailleurs répartis sur plus de 600 000 établissements agricoles via la norme de protection des travailleurs agricoles (WPS) et l’agence de protection de l’environnement (EPA).
Ces précautions ne sont pas étonnantes : ces dernières années, les scientifiques ont rassemblé de nombreux indices indiquant que l’exposition aux pesticides représente un danger pour la santé publique, et peut notamment se traduire par des problèmes d’infertilité.
L’analyse du taux de prévalence de l’infertilité chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, dans 204 pays et territoires, entre 1990 et 2021 a récemment révélé que les régions les plus touchées par l’infertilité sont principalement situées en Asie de l’Est, en Asie du Sud et en Europe de l’Est.
Cette problématique concerne aussi la France, pays considéré comme l’un des plus grands consommateurs de pesticides dans le monde. Il est important de mettre en lumière cette situation, car la plupart des personnes qui souffrent d’infertilité ne la connaissent pas.
Des molécules qui perturbent les mécanismes hormonaux
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a classé diverses substances dans la catégorie des perturbateurs endocriniens : le bisphénol A (BPA), les phtalates et leurs métabolites, ou certains pesticides, tels que les biphényles polychlorés (PCB), le glyphosate, le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et le méthoxychlore.
Pour mémoire, les perturbateurs endocriniens sont des substances imitant ou interférant avec l’activité des hormones, donc capables de perturber le fonctionnement hormonal, et ce, même à très faible dose.
En ce qui concerne les pesticides, les systèmes de surveillance environnementale et sanitaire se sont longtemps focalisés sur les substances actives, négligeant en grande partie les composés issus de leur dégradation, appelés « métabolites ».
Pourtant, on sait aujourd’hui que, dans certains cas, les métabolites peuvent exercer un effet biologique plus important que la substance mère elle-même. Dans le cas des pesticides, ces composés secondaires sont souvent persistants et peuvent jouer un rôle significatif dans les effets toxiques à long terme. C’est en particulier le cas en ce qui concerne la fertilité humaine.
Cette omission dans les stratégies de suivi a retardé la reconnaissance de la contribution potentielle des métabolites de pesticides à la baisse de la fertilité observée dans certaines populations exposées.
Perturbateurs endocriniens et fertilité masculine
Les preuves scientifiques suggèrent en effet qu’une exposition prolongée à des perturbateurs endocriniens peut nuire à la fertilité masculine, en affectant divers aspects de la fonction hormonale, avec notamment des conséquences sur la spermatogenèse (autrement dit la production et de la qualité du sperme).
En 2023, nous avons mené une étude rétrospective portant sur une population de 671 hommes vivant en Picardie. Les résultats ont montré que, chez le groupe exposé, que les spermatozoïdes étaient moins actifs et se déplaçaient moins bien. De plus, nous avons observé que l’ADN des spermatozoïdes était plus souvent fragmenté, et que leur structure était moins stable.
Au-delà des conséquences liées à l’exposition à un perturbateur endocrinien donné, la question de l’exposition à des mélanges de substances capables de perturber le système hormonal se pose avec une acuité grandissante.
Outre les pesticides et leurs métabolites, nous sommes en effet quotidiennement en contact avec de nombreuses molécules présentant des propriétés de perturbation endocrinienne. On peut par exemple citer les bisphénols utilisés pour remplacer le bisphénol A, composés perfluorés (PFAS, les alkylphénols (utilisés dans les détergents), ou encore les phtalates, dont on sait qu’ils peuvent altérer la production hormonale, perturber la maturation des cellules reproductrices et affecter la qualité du sperme (en plus d’affecter négativement la fertilité féminine).
Or, parfois, le fait d’être présentes dans un mélange modifie l’activité de certaines molécules, ce qui peut accroître leur toxicité. Certains facteurs environnementaux, tels que la pollution de l’air, peuvent également exacerber ces effets.
Pourquoi les perturbateurs endocriniens perturbent-ils la fertilité masculine ?
Dans notre corps, la production des hormones, et notamment de celles qui contrôlent la fertilité, est sous l’influence de l’axe hypothalamo-hypophysaire. Ce dernier est en quelque sorte la « tour de contrôle » qui régule le trafic hormonal. Comme son nom l’indique, il est constitué par l’hypothalamus, une région du cerveau impliquée dans de nombreux processus essentiels (métabolisme, croissance, faim et soif, rythme circadien, thermorégulation, stress et reproduction) et par l’hypophyse, une glande de la taille d’un petit pois qui se trouve à la base du cerveau.
L’hypothalamus libère une hormone appelée GnRH (GnRH, pour gonadotropin-releasing hormone), qui stimule l’hypophyse. En réponse, l’hypophyse libère à son tour deux hormones clés : la FSH (hormone folliculo-stimulante) et la LH (hormone lutéinisante). Ces hormones stimulent la production de testostérone par les testicules.
Les perturbateurs endocriniens ont la capacité de se fixer sur les récepteurs hormonaux. Ce faisant, ils perturbent la production des hormones sexuelles masculines, telles que la testostérone et l’œstradiol, qui sont cruciales pour le développement et le maintien des fonctions reproductives.
Les perturbateurs endocriniens agissent à plusieurs niveaux
On l’a vu, les perturbateurs endocriniens interfèrent avec le système hormonal en imitant ou en bloquant les hormones naturelles. Certains d’entre eux donnent également de faux signaux à l’hypothalamus ou à l’hypophyse, ce qui dérègle la production de FSH et de LH, empêchant ainsi le bon fonctionnement des testicules.
Grâce à des études expérimentales menées dans notre laboratoire sur des rats de Wistar, nous avons démontré que l’exposition à certains produits chimiques et la consommation d’une alimentation riche en graisses pouvaient avoir un impact négatif sur la reproduction. Nos principaux résultats indiquent une diminution significative du poids des petits rats exposés à l’insecticide chlorpyrifos à partir du 30e jour. Ce phénomène est encore plus marqué au 60e jour après la naissance.
L’analyse des tissus a révélé chez les femelles une augmentation du nombre de follicules détériorés. Chez les mâles, nous avons constaté que la structure des testicules était anormale, ce qui engendre une perte de cellules germinales (les cellules intervenant dans la production des spermatozoïdes).
De plus, chez des rats exposés au chlorpyrifos et à un régime riche en graisses, nos travaux ont mis en évidence une baisse significative de certaines protéines essentielles à la régulation hormonale. C’est par exemple le cas de deux hormones sécrétées par les neurones de l’hypothalamus : la GnRHR (hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires, responsable notamment de la synthèse et de la sécrétion de LH) et la kisspeptine (qui joue un rôle majeur dans la mise en place de la puberté et dans la régulation de la reproduction).
Que peut-on faire ?
Pour limiter les risques, il est important d’adapter ses comportements afin de réduire au maximum son exposition aux perturbateurs endocriniens. L’adoption de certains gestes simples peut y participer :
-
privilégier une alimentation bio, afin de limiter l’exposition aux pesticides (en ce qui concerne l’eau, diverses questions se posent, en particulier celle de la qualité de l’eau du robinet dans les régions fortement agricoles ; ces zones peuvent en effet être contaminées par des résidus de pesticides, des nitrates ou d’autres produits chimiques provenant des pratiques agricoles) ;
-
laver soigneusement les fruits et légumes avant de les consommer et de les éplucher si possible ;
-
porter des équipements de protection en cas d’utilisation de pesticides, en particulier en milieu professionnel. Rappelons que les agriculteurs sont les premières victimes directes de ces substances ;
-
sensibiliser les populations et promouvoir des pratiques agricoles responsables.
![]()
Sophian Tricotteaux-Zarqaoui a reçu des financements pour son doctorat de la Région Haut-de-France (50%), de la Mutualité Sociale Agricole of Picardie (25%) et de ATL Laboratories (25%).
Hafida Khorsi, Marwa Lahimer et Moncef Benkhalifa ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
– ref. Infertilité masculine et pesticides : un danger invisible ? – https://theconversation.com/infertilite-masculine-et-pesticides-un-danger-invisible-247711