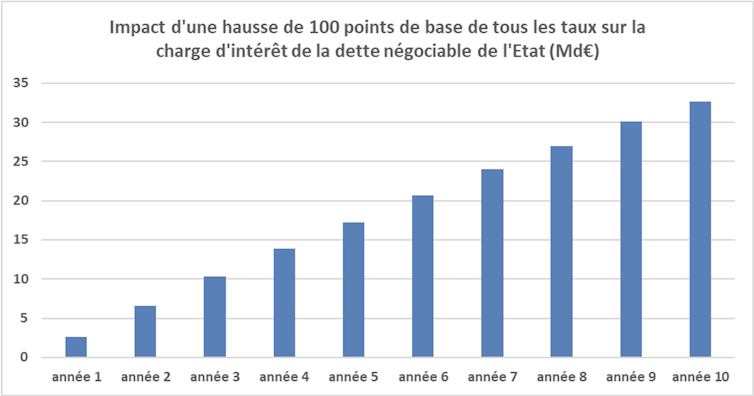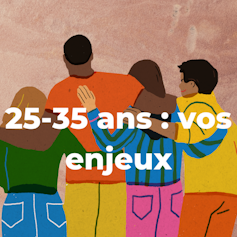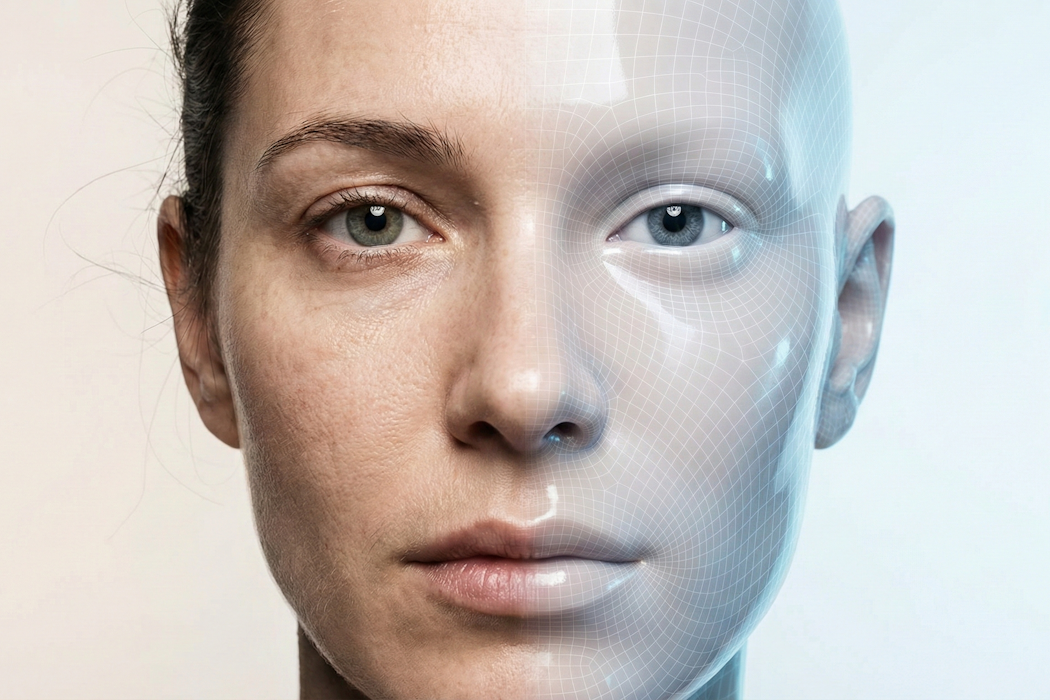Source: The Conversation – France in French (3) – By James Trapani, Associate Lecturer of History and International Relations, Western Sydney University

Hugo Chavez et Nicolas Maduro ont longtemps résisté aux tentatives des États-Unis d’exercer le contrôle des réserves pétrolières du Venezuela. Car ce pays d’Amérique du Sud, ayant joué un rôle clé dans la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), possède plus de 300 milliards de barils de pétrole.
Après que les forces spéciales des États-Unis ont fait irruption à Caracas pour exfiltrer le président vénézuélien Nicolas Maduro et renverser son gouvernement, Donald Trump déclare que les États-Unis vont désormais « diriger le Venezuela » , y compris ses abondantes ressources pétrolières.
Les entreprises états-uniennes sont prêtes à investir des milliards pour moderniser les infrastructures pétrolières vénézuéliennes en ruine, a-t-il dit, et « commencer à faire de l’argent pour le pays ». Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole mondiales – devançant l’Arabie saoudite – avec 303 milliards de barils, soit environ 20 % des réserves mondiales.
Si cela se réalise – et c’est un très grand « si » –, cela marquerait la fin d’une relation conflictuelle qui a commencé il y a près de trente ans.
Oui, l’action militaire de l’administration Trump au Venezuela a été à bien des égards sans précédent. Mais cela n’est pas surprenant, compte tenu de l’immense richesse pétrolière du pays et des relations historiques entre les États-Unis et le Venezuela, sous les mandats de l’ancien président Hugo Chavez et ceux de Nicolas Maduro.
Une longue histoire d’investissement états-unien
Le Venezuela est une république d’environ 30 millions d’habitants située sur la côte nord de l’Amérique du Sud, soit environ deux fois la taille de la Californie. Pendant une grande partie du début du XXᵉ siècle, il était considéré comme le pays le plus riche d’Amérique du Sud en raison de ses réserves pétrolières.
Les entreprises étrangères, y compris les états-uniennes, ont beaucoup investi dans la croissance du pétrole vénézuélien et joué un rôle important dans sa politique. Face à l’opposition de l’Oncle Sam, les dirigeants vénézuéliens ont commencé à exercer un contrôle accru sur leur principale ressource d’exportation. Le Venezuela a joué un rôle clé dans la création de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) en 1960, et a nationalisé une grande partie de son industrie pétrolière en 1976 (sous la présidence de Carlos Andrés Pérez, ndlr).
Cela a eu un impact négatif sur des entreprises comme ExxonMobil et a alimenté les récentes affirmations de l’administration Trump selon lesquelles le Venezuela aurait « volé » le pétrole américain.
Mais la plupart des Vénézuéliens ne profitent pas de cette prospérité économique. La mauvaise gestion de l’industrie pétrolière conduit à une crise de la dette et à l’intervention du Fonds monétaire international (FMI) en 1988. Des manifestations éclatent à Caracas en février 1989 et le gouvernement (du président Pérez qui vient d’être réélu, ndlr) envoie l’armée pour écraser le soulèvement. On estime que 300 personnes sont tuées, mais le nombre de morts pourrait être dix fois plus élevé.
Par la suite, la société vénézuélienne se divise davantage entre les riches, qui veulent travailler avec les États-Unis, et la classe ouvrière, qui cherche à obtenir l’autonomie vis-à-vis des États-Unis. Cette division définit la politique vénézuélienne depuis lors.
L’ascension de Chavez au pouvoir
Hugo Chavez débute sa carrière comme officier militaire. Au début des années 1980, il fonde le Mouvement révolutionnaire bolivarien-200 au sein de l’armée et donne des conférences passionnées contre le gouvernement.
Puis, après les émeutes de 1989, Chavez planifie le renversement du gouvernement vénézuélien. En février 1992, il organise un coup d’État, raté, contre le président pro-américain Carlos Andrés Pérez. Pendant son emprisonnement, son parti organise une autre tentative de coup d’État qui échoue également. Chavez est condamné à deux ans de prison, mais devient le principal candidat à la présidence en 1998, réunissant les courants socialistes révolutionnaires.
Hugo Chavez devient un géant de la politique vénézuélienne et latino-américaine. Sa révolution évoque la mémoire de Simon Bolívar (1783-1830), le grand libérateur de l’Amérique du Sud face au colonialisme espagnol. Non seulement Chavez est populaire au Venezuela pour son utilisation des revenus pétroliers, subventionnant les programmes gouvernementaux en matière d’alimentation, de santé et d’éducation, mais il est respecté, grâce à sa générosité, par des régimes partageant les mêmes idées dans la région.
Plus particulièrement, Hugo Chavez fournit à Cuba des milliards de dollars de pétrole en échange de dizaines de milliers de médecins cubains travaillant dans des cliniques de santé vénézuéliennes. Il établit un précédent en s’opposant aux États-Unis et au FMI lors des forums mondiaux, appelant le président états-unien de l’époque George W. Bush « le diable » à l’Assemblée générale de l’ONU en 2006.
Les États-Unis accusés d’avoir fomenté un coup d’État
Sans surprise, les États-Unis n’étaient pas fans d’Hugo Chavez.
Après que des centaines de milliers de manifestants de l’opposition descendent dans la rue en avril 2002, Chavez est brièvement renversé lors d’un coup d’État par des officiers militaires dissidents et des figures de l’opposition. Ces derniers installent un nouveau président, l’homme d’affaires Pedro Carmona. Chavez est arrêté, l’administration Bush reconnaît Carmona comme président, et le New York Times célébre la chute d’un « dictateur en devenir ».
Chavez revient au pouvoir seulement deux jours plus tard, grâce à des légions de partisans qui remplissent les rues. L’administration Bush doit se justifier pour son possible rôle dans le coup d’État avorté.
Bien que les États-Unis nient toute implication, les allégations persistent pendant des années sur le fait que Washington ait eu connaissance au préalable du coup d’État et ait tacitement soutenu sa destitution. En 2004, des documents nouvellement classifiés montrent que la CIA était au courant du complot, et il n’est pas clair dans quelle mesure les responsables des États-Unis ont prévenu Chavez.
La pression américaine continue sur Maduro
Nicolas Maduro, syndicaliste, est élu à l’Assemblée nationale en 2000 et rejoint le cercle rapproché de Hugo Chavez. Il accède au poste de vice-président en 2012 et, après la mort de Chavez l’année suivante, remporte sa première élection avec une courte avance.
Maduro n’est pas Chavez. Il ne bénéficie pas du même niveau de soutien parmi la classe ouvrière, l’armée ou dans son pays. La situation économique du Venezuela se détériore et l’inflation explose.

StringerAL/Shutterstock
Les administrations états-uniennes successives continuent d’exercer des pressions sur Nicolas Maduro. Le Venezuela subit des sanctions à la fois sous la présidence de Barack Obama et lors de la première présidence Trump. Les États-Unis et leurs alliés refusent de reconnaître la victoire de Maduro lors des élections de 2018 et de nouveau en 2024.
Isolé d’une grande partie du monde, le gouvernement de Nicolas Maduro devient dépendant de la vente de pétrole à la Chine.
Maduro affirme avoir déjoué plusieurs tentatives de coups d’État et d’assassinats impliquant les États-Unis et l’opposition intérieure, notamment en avril 2019 et en mai 2020 durant le premier mandat de Trump.
Les responsables états-uniens nient toute implication dans tous les complots potentiels ; les rapports n’ont également trouvé aucune preuve de l’implication américaine dans le coup d’État raté de 2020.
Aujourd’hui, Donald Trump a réussi à évincer Nicolas Maduro dans une opération bien plus audacieuse, sans aucune tentative de déni. Il reste à voir comment les Vénézuéliens et les autres nations latino-américaines réagiront aux actions états-uniennes, mais une chose est certaine : l’implication américaine dans la politique vénézuélienne continuera tant qu’elle aura des intérêts financiers dans le pays.
![]()
James Trapani ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Les États-Unis ont passé des décennies à faire pression pour mettre la main sur le pétrole vénézuélien – https://theconversation.com/les-etats-unis-ont-passe-des-decennies-a-faire-pression-pour-mettre-la-main-sur-le-petrole-venezuelien-273521