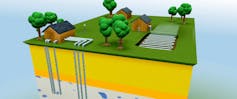Source: The Conversation – in French – By Ibrahima Dabo, Docteur en science politique (relations internationales, Russie), Université Paris-Panthéon-Assas
Depuis plusieurs années, la Russie accentue sans cesse sa présence en Afrique, mêlant coopération économique, influence culturelle, stratégie informationnelle et réseaux paramilitaires, dans un contexte de concurrence accrue avec les puissances occidentales.
Les deux sommets russo-africains tenus à Sotchi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023 ont permis à la Russie de matérialiser son retour sur le continent africain dans un contexte marqué par une guerre d’influence sans précédent.
Ces rencontres ont donné à Moscou l’occasion de développer sa coopération militaire et économique avec les États africains. Les différents votes des pays africains à l’ONU au sujet de la guerre en Ukraine montrent d’ailleurs l’influence grandissante du Kremlin en Afrique.
Le soft power, au cœur de la stratégie russe en Afrique
La diplomatie d’influence russe en Afrique est portée par plusieurs acteurs, ayant des missions très précises. Les versions africaines des médias Sputnik et RT contribuent au renforcement de la diffusion sur le continent de la vision russe de la politique internationale. Parallèlement, l’Agence fédérale Rossotroudnitchestvo (« Coopération russe ») et la Fondation Russkiy Mir (« Monde russe »), deux outils relativement méconnus, jouent un rôle non négligeable dans le rayonnement culturel russe dans le monde et particulièrement en Afrique.
Depuis le début des années 2000, Moscou marque progressivement son retour sur la scène internationale. La restauration et la réaffirmation du statut de grande puissance mondiale sont des éléments centraux de la politique du régime poutinien. Cette politique vise à redonner à la Russie un rang comparable à celui qui était détenu par l’URSS durant la guerre froide. En effet, l’effondrement de l’Union soviétique et la fin de la guerre froide avaient considérablement réduit le poids russe dans le monde et notamment en Afrique, où l’URSS exerçait une influence notable jusqu’au début des années 1990.
Le terme soft power – « miagkaia sila », emprunté au politologue américain Joseph Nye – a été repris à leur compte par les autorités russes dans le but de mettre en place des structures visant à rétablir l’image de Moscou à l’international. Dans ses différents concepts de politique étrangère, l’État russe accorde une importance particulière au soft power. C’est précisément dans cette optique qu’ont été créées Russkiy Mir et Rossotroudnitchestvo. Il s’agit d’accroître l’attractivité de la Russie dans le monde, à commencer par les pays où le Kremlin a des intérêts stratégiques.
« Rossotroudnitchestvo » ou la coopération à la russe
L’Agence fédérale Rossotroudnitchestvo – de son nom complet Agence fédérale pour la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale –, créée en 2008 par le président Dmitri Medvedev (2008-2012), est aujourd’hui l’instrument principal de la politique d’influence culturelle et humanitaire du Kremlin.
L’Agence, qui dépend du ministère russe des affaires étrangères, prend la suite du Centre russe pour la coopération scientifique et culturelle internationale, connu sous le nom de « Roszaroubjtsentr » créé sous ce nom en 1994, mais dont l’histoire remonte à 1925, année de la fondation de la Société de l’union pour les relations culturelles avec les pays étrangers (VOKS). Olga Kameneva, sœur de Trotski et épouse de Kamenev, en a été la première présidente. En 1958, l’Union des sociétés soviétiques pour l’amitié et les relations culturelles avec les pays étrangers (SSOD) remplace le VOKS. Le but de ces institutions soviétiques était, comme l’indiquaient leurs dénominations, de développer la coopération culturelle entre l’URSS et les pays étrangers.
Les missions de Rossotroudnitchestvo sont les mêmes. L’Agence contribue notamment à l’augmentation constante observée depuis plusieurs années du nombre d’étudiants africains dans les universités russes (près de 5000 bourses attribuées à des étudiants africains durant l’année académique 2024-2025, soit une augmentation considérable comparée aux années précédentes, malgré l’imposition des sanctions occidentales). C’est elle qui sélectionne les candidats qui auront droit à des bourses d’études en Russie, et qui seront orientés vers les universités publiques russes, à commencer par l’Université de l’Amitié des Peuples Patrice Lumumba (Moscou).
Les Maisons russes
Rossotroudnitchestvo réalise ses missions par le truchement des Maisons russes de la science et de la culture à l’étranger. À l’instar des modèles comme l’Alliance française, le British Council et surtout des Instituts Confucius, la Russie mise sur l’implantation de centres culturels. Ceux-ci étaient déjà présents dans de nombreux pays africains avant l’invasion de l’Ukraine : au Maroc, en Tunisie, en Tanzanie, en Zambie, en République du Congo et en Éthiopie.
Durant l’année 2022, après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, l’ouverture de nouvelles Maisons russes a été annoncée en Algérie, en Égypte, au Soudan, au Mali, au Burkina Faso, en Sierra Leone, en Angola et bien sûr en République centrafricaine, devenue l’une des vitrines de l’influence russe en Afrique.
L’une des principales missions des Maisons russes en Afrique consiste à promouvoir la langue et la culture russes. Ces centres culturels organisent régulièrement des évènements éducatifs et culturels mettant en valeur des moments marquants de l’histoire et de la culture russes, tels que l’anniversaire du célèbre poète Alexandre Pouchkine ou la commémoration de la fête de la Victoire du 9 mai. Des cours de langue russe y sont aussi dispensés.
Rossotroudnitchestvo soutient ces initiatives en fournissant des manuels et des ressources pédagogiques, facilitant ainsi l’enseignement du russe. En ce sens, les Maisons russes constituent des instruments essentiels de la diplomatie culturelle et éducative de la Russie en Afrique.
Tout comme l’Agence fédérale, la Fondation Russkiy Mir collabore avec les Maisons russes et contribue à la promotion de la langue et de la culture russes en Afrique, notamment en organisant des formations pour les enseignants de russe afin de renforcer l’enseignement de la langue sur le continent. Dans le cadre de cette mission, la Fondation travaille en partenariat avec Rossotroudnitchestvo et l’Institut d’État de la langue russe (Institut Pouchkine).
Au-delà du domaine éducatif et culturel, Rossotroudnitchestvo a aussi un volet humanitaire. L’un des domaines les plus importants de la coopération humanitaire concerne le domaine scientifique et technique. Par exemple, le 1er novembre 2023, Rossotroudnitchestvo a lancé sur le continent africain une faculté préparatoire pour les futurs étudiants des universités russes venant d’Éthiopie, de Tanzanie et de Zambie. En République du Congo, Rossotroudnitchestvo organise des formations continues pour le personnel médical congolais.
En outre, l’Agence fédérale soutient le projet international « SputnikPro », dédié aux journalistes et aux étudiants. Son objectif officiel est de promouvoir l’échange d’expériences avec des journalistes étrangers, le développement de la communication internationale dans les médias et les liens interculturels entre les journalistes.
Objectifs géopolitiques
La dégradation spectaculaire des relations russo-occidentales depuis le déclenchement de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine a poussé la Russie à se tourner davantage vers l’Afrique. Au-delà de ses instruments de soft power, le Kremlin compte également sur ses médias internationaux et sur les réseaux liés au groupe Wagner pour renforcer son influence sur le continent africain.
Les opérations d’influence informationnelles occupent une place centrale dans la stratégie russe de reconquête du continent. Depuis quelques années, Moscou mène des opérations d’influence informationnelles en Afrique dans le but d’affaiblir la présence occidentale. Ces différentes opérations d’influence sont portées par les organes russes d’information RT et Sputnik ainsi que par les réseaux liés au groupe Wagner. Ces opérations ont contribué à l’amenuisement de l’influence française sur le continent, particulièrement au Sahel.
Depuis la mort du patron de Wagner, Evguéni Prigojine, une nouvelle structure paramilitaire, Africa Corps, a pris le relais. Les actions des structures russes en Afrique sont souvent très imbriquées. En République centrafricaine, c’est un proche de Prigojine, Dmitri Sytyi, qui est le chef de la Maison russe. Ce dernier occupe aussi un poste clé dans la société Lobaye Invest, affiliée au groupe de Prigojine.
Une présence qui sert l’agenda stratégique russe
Les différentes entités russes présentes en Afrique déroulent l’agenda du Kremlin. La présence des médias internationaux russes RT et Sputnik est caractérisée par le dénigrement de la politique africaine des Occidentaux. Les thèmes touchant l’avenir du franc CFA, les bases françaises, la colonisation et le néocolonialisme sont abordés de façon récurrente dans le but de susciter un sentiment d’hostilité à l’égard de la France. Le discours et le narratif du Kremlin sont repris par les militants pro-russes sur les réseaux sociaux.
C’est la raison pour laquelle il n’est pas surprenant de voir lors des manifestations le drapeau russe brandi à Bangui, à Bamako à Ouagadougou et à Niamey.
Dans un monde de plus en plus marqué par la guerre d’influence et les rivalités géopolitiques, la Russie est consciente de l’importance majeure qu’ont prise les instruments de diplomatie publique et de soft power. En Afrique, elle semble, pour l’instant, progresser en de nombreux points du continent…
![]()
Ibrahima Dabo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Anatomie des principaux instruments du soft power de la Russie en Afrique – https://theconversation.com/anatomie-des-principaux-instruments-du-soft-power-de-la-russie-en-afrique-222805