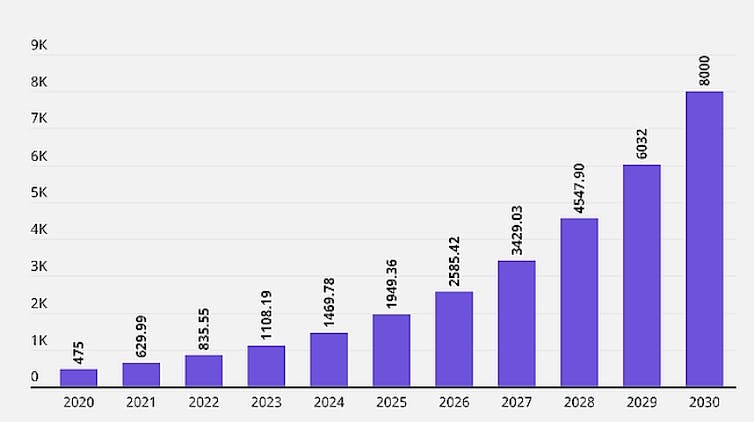Source: The Conversation – in French – By Marianne Lumeau, Maître de conférences en économie numérique, de la culture et des médias

Qui capte vraiment l’attention des Français quand il s’agit d’information ? En combinant télévision, presse, radio, réseaux sociaux ou agrégateurs, une nouvelle mesure permet d’évaluer avec finesse la place réelle des médias dans notre quotidien. À la clé&, une carte inédite du paysage médiatique, marqué par une forte concentration autour de quelques grands groupes – et une place centrale, souvent oubliée, du service public.
Pour répondre à ces questions, nous avons déployé une nouvelle mesure de consommation des médias : la part d’attention, (initialement introduite par l’économiste Andrea Prat). Contrairement aux mesures traditionnelles d’audience, cet indicateur permet de tenir compte de la multiplicité des sources et des plateformes par lesquelles l’actualité est consommée (TV, radio, presse, médias sociaux, etc.), tout en considérant que certains vont partager leur attention entre plusieurs sources alors que d’autres n’en consultent qu’une seule. Par exemple, une chaîne de télévision qui est la seule source d’information d’une population concentre 100 % de l’attention de cette population. Elle a davantage de pouvoir attentionnel qu’une chaîne qui est consommée en même temps que d’autres sources (une station de radio, un titre de presse et un média social, par exemple). Dans ce cas, si chaque source est consommée à la même fréquence, la part d’attention de la chaîne de télévision sera de 25 %, tout comme celle de la station de radio, celle du titre de presse et celle du média social.
Télé, radio, réseaux sociaux : qui capte vraiment l’attention des Français ?
À partir des données d’une enquête, menée en 2022, obtenues auprès d’un échantillon représentatif de 6 000 Français, les résultats indiquent de faibles écarts entre les sources médiatiques, même si l’attention des Français se concentre principalement sur les chaînes de télévision et les médias sociaux.
TF1 arrive en tête en cumulant 5,9 % de l’attention des Français, suivi par Facebook (4,8 %), France 2 (4,5 %), M6 (4,4 %) et BFMTV (4,1 %). Le premier agrégateur de contenus, Google actualités, arrive en onzième position (2,3 %), la première station de radio (RTL) en vingt-deuxième (1,33 %) et le premier titre de presse (20 minutes) en vingt-troisième (1,31 %).
Un marché des médias dominé par quelques groupes
En revanche, le regroupement des sources par groupe médiatique (par exemple, Facebook, Instagram et WhatsApp appartiennent à Meta) révèle une importante concentration. Les quatre premiers groupes concentrent 47 % de l’attention des Français. Si l’on prend les huit premiers groupes, on arrive à 70 % de l’attention des Français captée.
En moyenne, le groupe public composé principalement de France Télévisions et Radio France est, de loin, celui qui concentre le plus l’attention des consommateurs de médias (19,8 %), suivi par le Groupe Meta (10,1 %) et le Groupe TF1 (9,9 %).
La place centrale de médias publics
Le service public d’information, contrairement à une idée reçue, n’est donc pas réservé à une élite, mais occupe une place centrale dans le menu de consommation médiatique des Français.
Ce résultat peut s’expliquer par la confiance accordée aux médias du service public dans la production d’information (voir l’enquête du Parlement européen) et légitime l’octroi d’un budget suffisant pour y répondre. Cela met également en lumière l’importance de son indépendance vis-à-vis de l’État.
La place croissante des médias sociaux
Notons que le Groupe Meta dispose du pouvoir attentionnel le plus fort auprès des 18-34 ans, avec une part d’attention de l’ordre de 14 %, devant les groupes de médias du service public (11 %) et Alphabet-Google News (8 %).
Même si Meta ne produit pas directement d’information, il met en avant et ordonne les différentes informations auprès de ses usagers. Sans être soumis aux mêmes règles que les médias traditionnels, les médias sociaux disposent donc d’un rôle clé sur la vie démocratique.
Pourquoi cette mesure doit peser dans les décisions sur les fusions médiatiques ?
L’analyse par groupe s’avère particulièrement importante dans un contexte où les groupes de médias contrôlent une part de plus en plus importante de titres de presse, de chaînes de télévision, de stations de radios ou de plateformes d’informations au travers d’opérations de fusions ou d’acquisitions (par exemple, l’OPA de Vivendi sur Lagardère).
De récents rapports sur le secteur des médias recommandent, d’ailleurs, le recours à la part d’attention comme un nouvel outil d’évaluation des opérations de concentration sur le marché des médias d’information par les autorités de la concurrence (Autorité de la concurrence, Commission européenne, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique [ARCOM]). Cet outil est particulièrement adapté pour juger si la nouvelle entité formée à l’issue de la fusion de deux groupes ou de l’acquisition de nouvelles sources par un groupe n’aurait pas un trop grand pouvoir attentionel et si le marché des médias serait trop concentré autour de quelques acteurs dans un contexte où les médias sont au cœur du processus démocratique. La littérature académique reconnaît, en effet, qu’ils peuvent influencer les positions idéologiques des citoyens, les votes et la démocratie et peuvent être idéologiquement biaisés.
Pour approfondir : S. Dejean, M. Lumeau, S. Peltier, « Une analyse de la concentration de l’attention par les groupes médiatiques en France », Revue économique, 76(2), pp. 133 à 177.
![]()
Marianne Lumeau a reçu des financements de l’ANR (Projet de recherche Pluralisme de l’Information en Ligne – PIL).
Stéphanie Peltier et Sylvain Dejean ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
– ref. Télé, radio, presse, réseaux sociaux : quels médias captent vraiment l’attention des Français ? – https://theconversation.com/tele-radio-presse-reseaux-sociaux-quels-medias-captent-vraiment-lattention-des-francais-262261