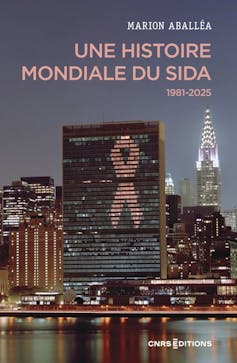Source: The Conversation – in French – By Julien Le Maux, Professeur titulaire, département de sciences comptables, HEC Montréal
Trente ans après l’assassinat d’Iqbal Masih, enfant esclave du Pakistan devenu symbole mondial, l’esclavage n’a pas disparu. Il se cache aujourd’hui dans les chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises, qui doivent désormais rendre des comptes.
Le 16 avril 1995, Iqbal Masih, un enfant pakistanais de 12 ans, était abattu près de son village. Réduit en esclavage dès l’âge de 4 ans dans une fabrique de tapis, il s’était enfui à 10 ans avant de devenir un symbole international de la lutte contre le travail forcé. Si la version officielle a parlé d’un différend local, de nombreuses ONG estiment qu’il a été tué pour avoir dénoncé les fabricants de tapis.
Son courage avait bouleversé le monde. En 1994, il a reçu le Prix Reebok des Droits de la personne, puis en 2000, le Prix des Enfants du Monde pour les Droits de l’Enfant, à titre posthume. Son nom est devenu un symbole de la lutte contre l’exploitation infantile. Mais trente ans plus tard, son combat reste d’actualité.
Professeur titulaire en sciences comptables à HEC Montréal et directeur académique des certifications en ESG et en gouvernance d’entreprise, je mène des recherches sur la qualité de la gouvernance dans les organisations publiques et privées, ainsi que sur l’intégration des facteurs ESG dans leurs décisions stratégiques.
L’esclavage moderne : une réalité cachée
L’esclavage moderne désigne les situations où une personne ne peut pas quitter son travail, retenue par la peur, la violence, la tromperie ou la dette. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), il inclut notamment le travail forcé, la traite des êtres humains, le travail des enfants, et certaines formes de mariage forcé. Derrière des contrats légaux ou des intermédiaires, la réalité reste la même : une vie sans liberté.
Loin d’appartenir au passé, il s’inscrit au cœur de l’économie globale. Dans le monde du travail contemporain, l’esclavage moderne prend souvent la forme d’un emploi imposé par des dettes, de la confiscation de papiers d’identité, de journées interminables dans des conditions dangereuses, ou encore d’une dépendance totale à l’égard d’un employeur.
Pour les entreprises, la définition est claire : toute activité économique qui repose, directement ou par le biais de fournisseurs, sur une privation de liberté au travail, relève de cette catégorie. C’est ce que précisent les normes de l’OIT, notamment la Convention n° 29 sur le travail forcé, et la Convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, que la plupart des États ont ratifiées.
Une loi qui manque de dents
Entrée en vigueur en janvier 2024, la Loi S-211 canadienne constitue un premier pas vers la responsabilisation des entreprises. Elle oblige les grandes entreprises – et certains ministères fédéraux – à publier un rapport annuel sur les mesures prises pour prévenir le travail forcé et le travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement.
Inspirée du modèle britannique (Modern Slavery Act), la loi s’appuie essentiellement sur le principe de transparence volontaire, sans imposer de mécanismes de contrôle ni de sanctions substantielles en cas de manquements.
À lire aussi :
Le comité d’audit : un fourre-tout devenu ingérable ?
En d’autres termes, la loi oblige à « dire », mais pas nécessairement à « agir ». Dans les faits, le Conseil d’administration, pourtant au cœur de la stratégie d’entreprise, n’est pas explicitement visé dans la loi, alors même que ses décisions structurent les risques pris en matière de sous-traitance, de pression sur les coûts ou de politiques d’achat.
Le Canada : un pays vulnérable par ses importations
Selon le rapport le Global slavery index 2023, le Canada se situe dans le top 10 des pays les plus engagés en matière de réponses gouvernementales, mais reste en retard lorsqu’il s’agit de sa propre chaîne d’approvisionnement.
Malgré sa législation, le Canada est fortement exposé via ses importations à des produits issus du travail forcé. Le rapport identifie les principaux produits importés par le Canada associés à un risque d’esclavage moderne : poisson (produits de la mer d’Asie du Sud-Est), vêtements (Bangladesh, Chine, Inde), électronique (semi-conducteurs, batteries), textiles, chocolat, sucre.
Autrement dit, le risque n’est pas théorique : il est déjà présent dans nos assiettes, nos garde-robes et nos téléphones.
La responsabilité des conseils d’administration
En matière de gouvernance, les conseils d’administration ont une responsabilité directe dans la sélection des fournisseurs, la politique d’achat et la gestion du risque éthique.
Selon le rapport de la fondation Walk Free, qui publie le Global Slavery Index, ces recommandations devraient être mises en application par toutes les entreprises :
-
Mettre en place un système de traçabilité complet
-
Inclure l’esclavage moderne dans les rapports de durabilité
-
Former les conseils d’administration et les gestionnaires à identifier les zones à risque
-
Rendre obligatoire l’audit des fournisseurs critiques
-
Fixer des objectifs de réduction du risque par le comité de gouvernance ou de durabilité
Selon une étude internationale, les pressions sur les coûts, les délais et la flexibilité, imposées par les donneurs d’ordre, sont des facteurs structurels qui rendent l’esclavage moderne « fonctionnel ». Tant que les conseils d’administration n’intégreront pas l’esclavage moderne comme un risque stratégique issu de leur propre modèle économique, rien ne changera.
Les auteurs de l’étude montrent également que les dispositifs tels que les « codes de conduite », « audits sociaux » ou « clauses contractuelles » ont montré leurs limites. Leur conclusion : il faut aller au-delà de la case « conformité ». Ils demandent des mécanismes de suivi plus solides, notamment par l’intégration du respect des droits humains dans les comités de gouvernance, la mise en place d’objectifs contraignants pour la haute direction et l’organisation d’un suivi indépendant, co-construit avec la société civile.
Les normes internationales oublient l’essentiel
Alors que les entreprises sont incitées à adopter des cadres normalisés pour rendre compte de leur performance en matière de durabilité, il est frappant de constater que les normes de l’International Sustainability Standards Board (ISSB) – censées définir le socle mondial de l’information sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – font l’impasse sur les droits humains.
Les deux premières normes publiées en 2023 portent seulement sur les risques climatiques et la gouvernance liée au climat. Elles laissent totalement de côté les enjeux sociaux, pourtant au cœur de l’Agenda 2030 des Nations unies.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
En d’autres termes, la qualité de vie des travailleurs, le travail forcé, la traite ou l’esclavage moderne ne figurent tout simplement pas dans les priorités actuelles de l’ISSB. Ce silence en dit long : peut-on vraiment parler de durabilité si la dignité humaine n’en fait pas partie ?
La réalité des entreprises face à ses exigences
Certaines entreprises ont été rattrapées par la réalité qu’elles prétendaient ignorer. En 2020, l’entreprise britannique Boohoo a vu sa valeur en bourse chuter de près de 40 % après la révélation de conditions proches de l’esclavage dans des ateliers de sous-traitance à Leicester. Les salariés étaient payés 3,50 £ de l’heure, dans des locaux insalubres, sans contrat formel.
Même au Canada, certaines entreprises de transformation alimentaire ou de logistique ont vu leurs chaînes d’approvisionnement entachées par des pratiques de sous-traitants douteux. Ces cas montrent que l’absence de vigilance active au niveau du conseil d’administration entraîne des risques réputationnels, juridiques et financiers majeurs.
L’esclavage moderne n’est pas un accident, mais le résultat de choix économiques. Trente ans après Iqbal Masih, il est temps de briser ces chaînes invisibles.
![]()
Julien Le Maux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. L’esclavage moderne, un risque stratégique ignoré par les conseils d’administration – https://theconversation.com/lesclavage-moderne-un-risque-strategique-ignore-par-les-conseils-dadministration-262087