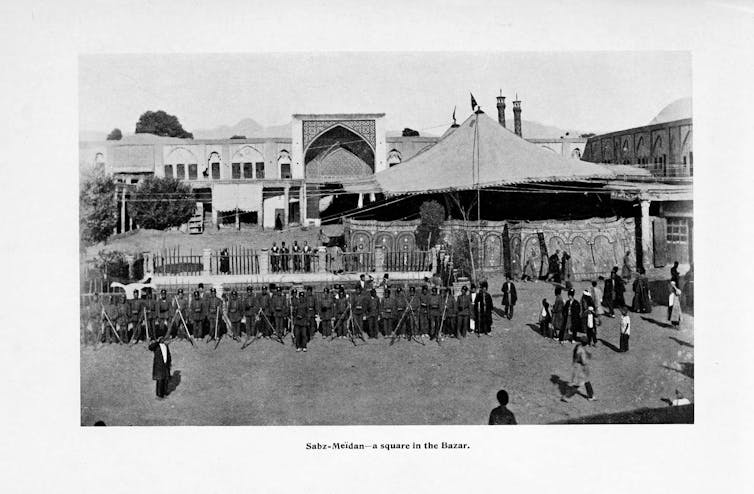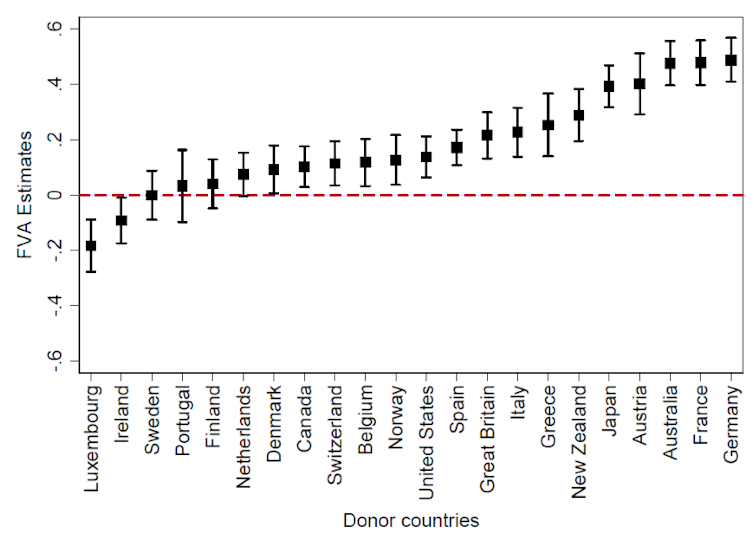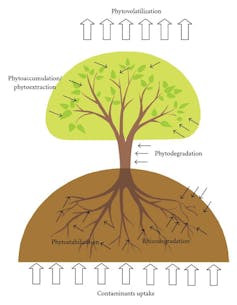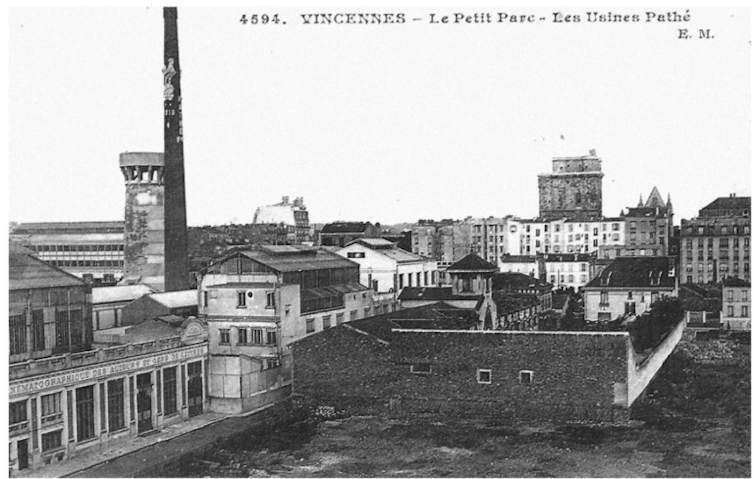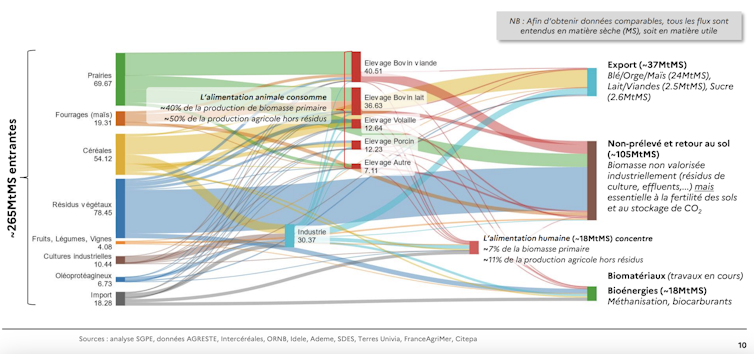Source: The Conversation – in French – By Aurélie Maurice, Maîtresse de conférences en Sciences de l’Éducation et de la Formation, Université Sorbonne Paris Nord
Se nourrir est un acte complexe, croisant psychologie, culture et physiologie. Dès lors, comment s’y prendre, en tant que parent ou éducateur, pour aider les enfants à former leur goût et élargir leur répertoire alimentaire ? La recherche donne quelques pistes pour mieux tenir compte de la place des émotions dans le rapport à la nourriture.
L’éducation à l’alimentation des jeunes est au cœur des politiques publiques : elle est l’un des objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS) et l’un des axes du Programme national pour l’alimentation (PNA). De plus, un Vademecum sur l’éducation à l’alimentation et au goût a récemment émané de l’éducation nationale. Plusieurs membres de l’Assemblée nationale organisent aussi depuis quelques années des « états généraux » sur le sujet.
Les derniers états généraux d’octobre 2025 ont conduit à une proposition de loi d’expérimentation pour l’instauration d’un enseignement d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école.
À lire aussi :
Comment peut-on repenser l’éducation à l’alimentation ?
Alors que l’éducation à l’alimentation s’est longtemps heurtée à des limites, notamment face aux inégalités sociales de santé, de nouvelles approches apparaissent : citons l’approche tridimensionnelle qui intègre les dimensions « nutritionnelle », « psycho-sensorielle et comportementale » et « socio-environnementale ». L’approche hédonique, elle, privilégie le plaisir alimentaire avec trois leviers d’actions : l’exposition sensorielle répétée aux aliments, les interactions sociales lors des prises alimentaires et les croyances sur les aliments.
Si ces démarches mettent en avant l’importance des émotions, comment, concrètement, les prendre en compte au quotidien, lors de repas ou de séances de découverte, que l’on soit parent, acteur ou actrice de l’éducation ?
Veiller au contexte des repas
S’alimenter est un acte complexe, car multidimensionnel : physiologie, sociabilité, identité culturelle et psychologie s’entremêlent. S’alimenter, c’est aussi ressentir toute une palette d’émotions : la joie, le dégoût, la peur… Celles-ci sont pour l’instant peu prises en compte globalement dans les séances d’éducation à l’alimentation. C’est le cas néanmoins dans l’éducation au goût, qui cherche à reconnecter les jeunes avec leurs sens.
Marie Jaunet, Sylvie Delaroche-Houot et moi-même avons mené une revue de la littérature scientifique afin d’explorer comment les émotions peuvent être mobilisées dans le champ de l’éducation à l’alimentation et quels en sont les bénéfices. Cette revue a été effectuée sur 30 articles publiés entre 2005 et 2022, dont 90 % en anglais, provenant principalement d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale.
Cette revue montre que les émotions des jeunes sont bel et bien à prendre en compte, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il apparaît que la composition nutritionnelle des aliments a un impact sur ces émotions. Un repas suffisamment varié et correspondant bien aux besoins nutritionnels des enfants diminuerait les émotions négatives, comme la tristesse ou l’anxiété.
Ensuite, l’importance d’être attentif à ses cinq sens quand on se nourrit est soulignée, notamment, par des études sur l’alimentation consciente chez les enfants. Créer un environnement positif pendant les repas, c’est-à-dire faire du moment du repas un moment joyeux, ludique et apaisant, favorise une prise alimentaire diversifiée et en quantité suffisante de la part des enfants. Cette attention portée à la qualité de l’ambiance des repas est d’autant plus bénéfique qu’elle est travaillée tant à la maison qu’à l’école.
En obligeant les enfants à finir leurs assiettes, ou en se servant de l’alimentation comme d’une récompense ou d’un élément de chantage, certains parents peuvent favoriser le développement d’une « alimentation émotionnelle » chez leurs enfants. Cela peut conduire à un surpoids à moyen et long terme.
Favoriser l’empathie
Un groupe d’experts est arrivé à une classification des styles éducatifs parentaux sur l’alimentation qui en distingue trois types : coercitif (fondé sur la pression, les menaces et les récompenses), structuré (donnant des règles qui encadrent les prises alimentaires) et favorisant l’autonomie (donnant les clés à l’enfant pour qu’il fasse ses propres choix, dans un climat d’amour inconditionnel).
Ces trois grandes catégories conduisent à des états émotionnels très différents, allant de la peur à la joie, et à des pratiques alimentaires enfantines très contrastées (se cacher pour manger des aliments interdits, se restreindre de manière autonome).
Le repas familial peut être un moment propice au partage et à l’écoute des émotions de l’enfant. Aux États-Unis apparaît depuis plusieurs décennies un terme, « parent responsiveness », qui pourrait être traduit par « réactivité parentale », à savoir une attitude empathique des parents, apportant une réponse adaptée aux émotions exprimées par leurs enfants et aux besoins sous-jacents.
Plusieurs chercheurs ont proposé d’adapter ce concept à l’alimentation, et parlent de « responsive feeding » ou « réactivité alimentaire ». Il s’agit de soigner le temps du repas, d’en faire un moment pendant lequel l’enfant se sent à l’aise et en confiance. Le parent cherche à être attentif aux sensations de faim et de satiété de son enfant, à lui répondre rapidement, de façon appropriée, en fonction de l’émotion qu’il exprime et de son stade de développement.
Enfin, les articles étudiés dans la revue de littérature font état de plusieurs outils conçus pour aider les enfants à s’exprimer autour de l’alimentation et à nommer leurs émotions.
Cette revue montre qu’il faut prendre en compte les différentes dimensions de l’acte alimentaire, tel que l’environnement dans lequel l’aliment est consommé. Un climat bienveillant et joyeux apparaît plus propice aux nouvelles expériences gustatives, alors que, si l’enfant se sent contraint, voire angoissé, les conditions ne sont pas réunies pour qu’il découvre de nouveaux aliments ou accepte de manger des légumes, par exemple.
La politique publique des mille premiers jours de l’enfant recommande des activités conjointes parents/enfant, sources d’émotions positives dans lesquelles l’alimentation a toute sa place. Il apparaît donc que la formation tant des parents que des enseignants, des personnels du périscolaire et des autres professionnels éducateurs est essentielle pour développer la capacité d’autorégulation et d’ouverture des jeunes dans leur alimentation.
![]()
Aurélie Maurice a reçu des financements de l’ANR pour le projet ERMES qu’elle coordonne.
– ref. Apprendre à varier son alimentation : écouter les émotions des enfants, un enjeu central – https://theconversation.com/apprendre-a-varier-son-alimentation-ecouter-les-emotions-des-enfants-un-enjeu-central-272502