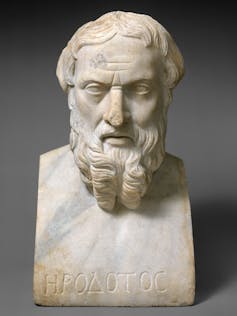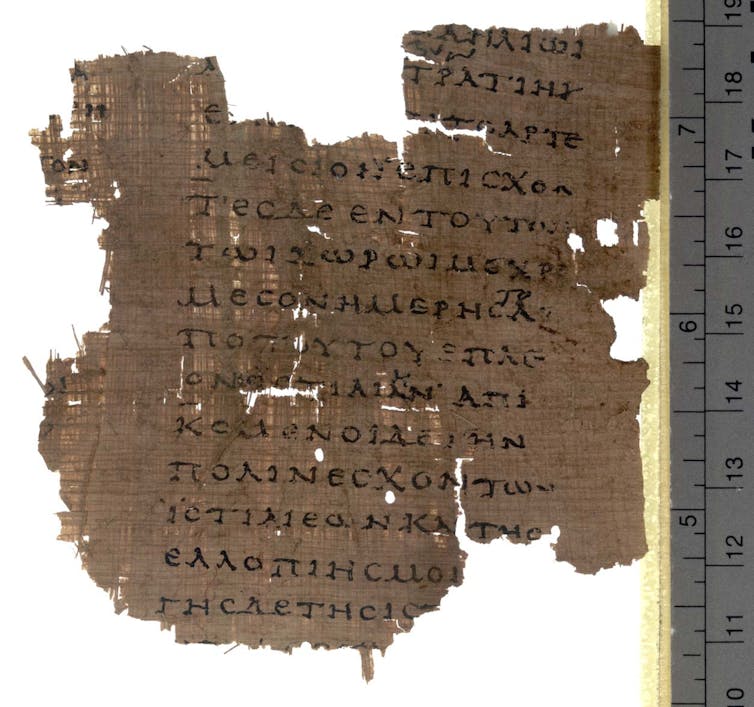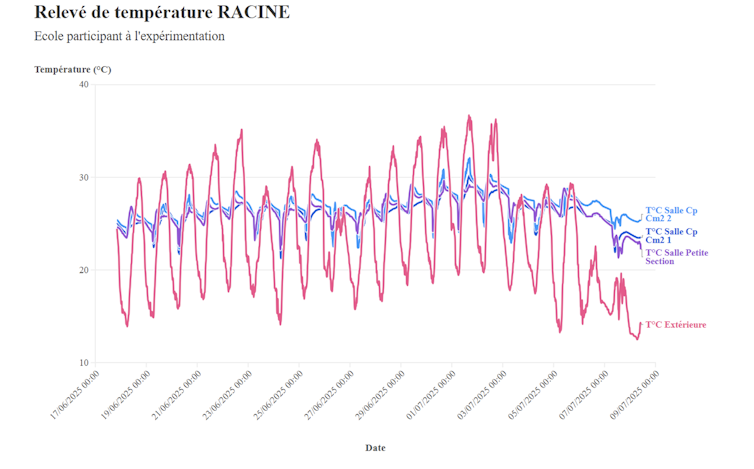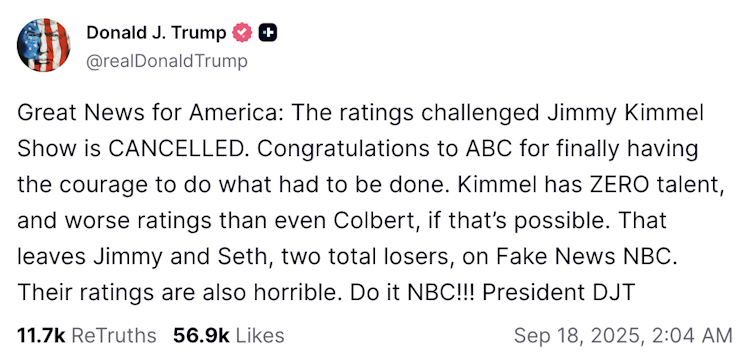Source: The Conversation – in French – By Geneviève Sicotte, Professeure, Études françaises, Concordia University
En quelques décennies, la poutine a acquis le statut de nouveau plat identitaire québécois.
On connaît sa composition : frites, fromage en grains et sauce, le tout parfois surmonté de diverses garnitures. C’est un mets qu’on peut trouver simpliste, un fast-food qui assemble sans grande imagination des aliments ultra-transformés et pas très sains.
Pourquoi s’impose-t-il aujourd’hui avec tant de force ?
Dans La poutine. Culture et identité d’un pays incertain publié cette semaine aux PUM, j’explore cette question. J’essaie de comprendre ce qui fait qu’un aliment devient un repère et même un emblème pour une collectivité. Mon hypothèse est que la poutine doit sa popularité au fait qu’elle mobilise de manière dynamique des enjeux sensibles de l’identité québécoise actuelle.
Pour analyser l’imaginaire qui s’élabore autour du plat, j’approfondis ici quelques pistes : ses liens avec la tradition culinaire québécoise et la convivialité particulière qui la caractérise.
À lire aussi :
Mangerez-vous de la tourtine à Noël ?
Un plat pour repenser le passé
La poutine est relativement récente : elle apparaît dans les années cinquante et ne devient populaire que dans les dernières décennies du XXe siècle. Mais en fait, malgré cette modernité, elle touche à des enjeux liés au passé et permet de les repenser. C’est un premier facteur qui explique son nouveau statut de plat emblématique.
La cuisine traditionnelle du Québec était d’abord associée à la subsistance. Fondée surtout sur les ressources agricoles, modeste, simple et parfois rudimentaire, elle devait emplir l’estomac. Pour cette raison, elle a longtemps été dénigrée, comme en témoignent les connotations négatives attachées à la soupe aux pois ou aux fèves au lard.
Des valorisations sont bien survenues au fil du XXe siècle. Mais même si on trouve aujourd’hui des mets traditionnels dans certains restaurants ou qu’on les consomme ponctuellement lors de fêtes, on ne saurait parler de revitalisation. Peu cuisinés, ces mets sont surtout les témoins d’une histoire, d’une identité et de formes sociales dans lesquelles une bonne partie de la population ne se reconnaît pas.
Or dans l’imaginaire social, la poutine semble apte à repositiver cette tradition. D’emblée, elle permet que des traits culinaires longtemps critiqués — simplicité, économie, rusticité et abondance — soient transformés en qualités. Elle procède ainsi à un retournement du stigmate : le caractère populaire de la cuisine, qui a pu susciter une forme de honte, est revendiqué et célébré.
Par ailleurs, la poutine se compose d’ingrédients qui agissent comme les marqueurs discrets des influences britanniques, américaines ou plus récemment du monde entier qui constituent la cuisine québécoise. Mais l’identité qu’évoquent ces ingrédients semble peu caractérisée et fortement modulée par le statut de fast-food déterritorialisé du plat. Le plébiscite de la poutine s’arrime ainsi à une situation politique contemporaine où le patriotisme québécois n’est plus un objet de ralliement dans l’espace public. Le plat devient un repère identitaire faible et, dès lors, consensuel.
Un plat convivial
Les manières de manger révèlent toujours des préférences culturelles, mais c’est d’autant plus le cas quand la nourriture consommée est ressentie comme emblématique. C’est pourquoi il faut également traiter de l’expérience concrète de la consommation de poutine et de la convivialité qu’elle suppose, qui portent elles aussi des dimensions expliquant son essor.
Le casseau abondant de frites bien saucées révèle une prédilection pour un certain type de climat et de liens sociaux. Il est posé sans façon au centre de la table et souvent partagé entre les convives qui y puisent directement. Les relations entre les corps et avec l’espace qui se dévoilent par ces usages, ce qu’on appelle la proxémie, prennent ici une dimension personnelle et même intime.
La convivialité associée à la poutine rejette ainsi les codes sociaux contraignants et valorise un registre libre et familier, où la communauté emprunte ses formes au modèle familial restreint plutôt qu’au social élargi.
Une nourriture de réconfort
Une fois consommé, le mets emplit l’estomac et rend somnolent. Ce ressenti physiologique fait peut-être écho à l’ancienne cuisine domestique qui visait la satiété. Toutefois, il trouve aussi des résonances contemporaines.
La poutine appartient en effet à la catégorie très prisée des nourritures de réconfort, ce phénomène typique d’une époque hédoniste. Mais la poutine n’est pas seulement un petit plaisir du samedi soir. Elle devient le signe de préférences culturelles collectives : les corps se rassemblent dans une sociabilité de proximité qui vise le plaisir et qui permet de mettre à distance des enjeux sociaux et politiques potentiellement conflictuels.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
En outre, le plat fait l’objet de consommations festives qui accentuent sa portée identitaire. Dans ces occasions, la convivialité devient codifiée et parfois ritualisée. La poutine des vacances marque la fin des obligations, le moment où s’ouvre un été de liberté ; la première poutine des immigrants signe leur intégration à la société québécoise ; la poutine nocturne permet d’éponger les excès avant de réintégrer le monde des obligations ; les festivals de la poutine constituent des moments de rassemblement joyeux de la collectivité.
Ces fêtes sont de véritables performances de l’identité, des moments où s’inventent des modalités renouvelées du vivre-ensemble qui valorisent le plaisir, l’humour, la modestie et les liens de proximité. Elles offrent une image qui, malgré qu’elle puisse être idéalisée, joue un rôle actif dans la représentation que la collectivité se fait d’elle-même. Et cela se manifeste même dans le domaine politique, notamment lors des campagnes électorales !
La poutine, passage obligé des campagnes électorales
Un plat emblématique pour célébrer une identité complexe
Loin d’être un signe fixe, un plat identitaire est dynamique et polyphonique. Quand nous le mangeons, nous mobilisons tout un imaginaire pour penser ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous voulons être.
La poutine illustre clairement cela. Elle réfère au passé, mais le reformule et l’inscrit dans le présent. Elle valorise une certaine forme de collectivité, mais il s’agit d’une collectivité plutôt dépolitisée et non conflictuelle, rassemblée autour de valeurs familiales et familières.
Privilégiant l’humour et la fête, elle évite le patriotisme sérieux et affirme son existence avec modestie. La poutine devient ainsi un support permettant de manifester l’identité québécoise actuelle dans toute sa complexité. C’est ce qui explique qu’elle s’impose comme nouveau plat emblématique.
![]()
Geneviève Sicotte a reçu des financements de l’Université Concordia, du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et du Fonds de recherche du Québec, Société et culture (FRQSC).
– ref. Voici pourquoi la poutine est devenue le nouveau plat identitaire québécois – https://theconversation.com/voici-pourquoi-la-poutine-est-devenue-le-nouveau-plat-identitaire-quebecois-263977