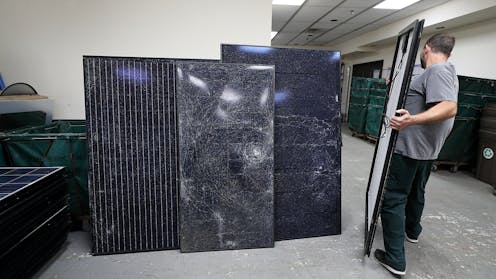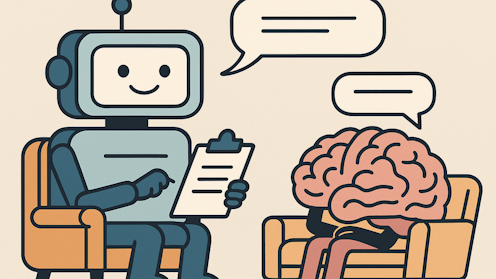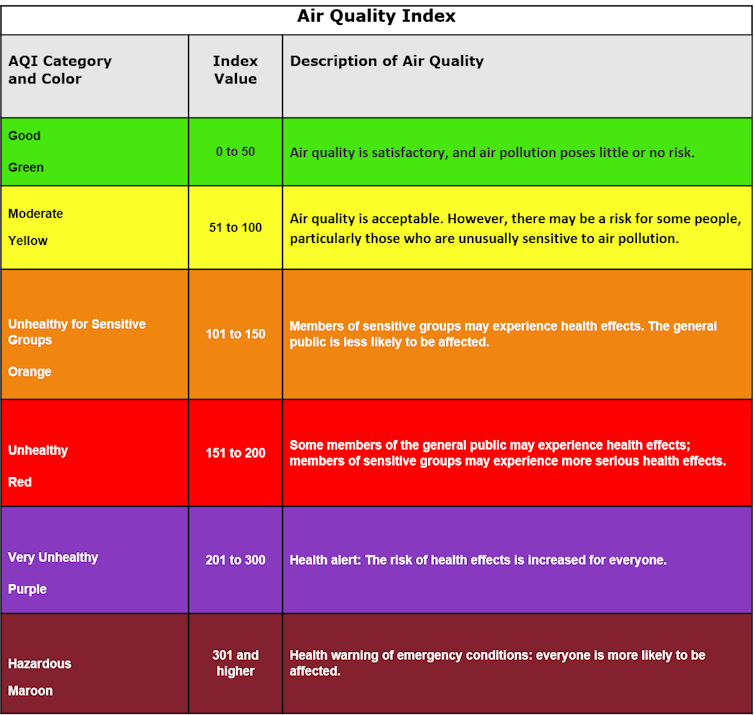Source: The Conversation – France (in French) – By Renaud Bécot, Maitre de conférences en histoire contemporaine, Sciences Po Grenoble

L’environnement n’intéresse-t-il que les classes supérieures ? Les travailleurs ont en réalité très vite identifié l’impact de l’industrialisation sur les écosystèmes dont ils dépendent. Mais cette conscience environnementale s’exprime de façon différente en fonction des classes sociales, comme l’explique Renaud Bécot, chercheur en histoire contemporaine et environnementale, dans un chapitre intitulé « Fin du monde, fin du mois, et au-delà ? L’environnementalisme des classes populaires » publié au sein de l’ouvrage collectif La Terre perdue. Une histoire de l’Occident et de la nature XVIIIᵉ-XXIᵉ siècle.
Au milieu des années 1950, Agnès Varda filme une scène ordinaire dans un quartier populaire du littoral méditerranéen. Quelques chats observent le réveil des familles dont les revenus d’existence reposent sur l’extraction des ressources de la mer. Les pêcheurs s’apprêtent à reprendre leur labeur, alors même que les fumées d’une industrie lourde souillent le rivage proche. Ils préparent leurs barques avec discrétion, car les autorités publiques surveillent la capture des poissons potentiellement pollués. Pourtant, « on ne veut pas travailler comme des empoisonneurs ! », s’exclament ces pêcheurs sétois.
Si cette représentation s’inscrit dans une œuvre de fiction (La Pointe courte, 1955), la scène illustre la position singulièrement inconfortable dans laquelle se trouvent les classes populaires contemporaines dans leurs rapports aux environnements. En effet, ces pêcheurs sont bien conscients que leurs revenus, et plus largement leurs conditions de subsistance, dépendent de l’extraction de ressources naturelles (ici halieutiques) – et, par extension, de la nécessité d’assurer la soutenabilité de celles-ci. Leur conscience est d’autant plus nette que l’industrialisation conforte une menace sur ces ressources et sur leur qualité.
Pourtant, malgré cette préoccupation, ces pêcheurs (tout comme les paysans au cours de cette période) sont pris dans l’état de la transition urbaine-industrielle que connaissent les sociétés européennes et américaines depuis le XIXe siècle.
[…]
L’acte d’accusation à l’encontre des classes populaires, supposément indifférentes aux enjeux écologiques, procède du déni des contraintes dans lesquelles se structurent les vies ordinaires au sein des groupes subalternes dans les sociétés occidentales. Face à l’ampleur des transformations urbaines et industrielles depuis le XIXe siècle, les préoccupations populaires pour l’environnement ont pourtant été récurrentes, et bien souvent ancrées dans des enjeux liés à l’organisation de la subsistance et à la protection de la santé.
De l’environnementalisme des pauvres à l’environnementalisme ouvrier
L’économiste catalan Joan Martinez-Alier distinguait trois principaux courants au sein des mouvements écologistes au début du XXIe siècle. Le premier, parfois qualifié de protectionniste, se caractérise par un culte de la nature sauvage. Son histoire se confond souvent avec les actions menées par des membres de classes aisées en faveur de la mise en réserve d’espaces présentés comme emblématiques, à l’instar d’intellectuels tels que John Muir (1838-1914), fondateur du Sierra Club, qui fut longtemps la principale association environnementale étasunienne.
Le deuxième courant renvoie aux promoteurs de l’écoefficacité ou de la modernisation écologique ; les membres de ce courant témoignent d’une conception technicienne et instrumentale du rapport des sociétés à l’environnement. Il vise à organiser les flux d’énergie et de matière de manière plus efficace et il est souvent associé à des figures scientifiques, à commencer par l’ingénieur forestier Gifford Pinchot (1865-1946).
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Enfin, le troisième courant correspond à l’environnementalisme des pauvres, dont Joan Martinez-Alier analyse que « le ressort principal n’est pas le respect sacré de la nature, mais l’intérêt matériel que représente l’environnement, source et condition de la subsistance ».
Cette catégorie d’environnementalisme des pauvres était d’abord pensée pour étudier les conflits dans les pays non occidentaux. Alier constatait que les motifs de protestation soulevaient des enjeux d’accès aux espaces naturels, de partage des ressources, ou de protection des milieux dont l’équilibre était essentiel pour la survie humaine. Plus qu’un culte de la nature ou une volonté de maximiser le rendement des écosystèmes, Alier observait ce qu’il désigne comme des conflits écologico-distributifs. Dans cette approche, il s’agit de penser une « nature ordinaire » correspondant à la protection d’une biodiversité sans valeur économique ou patrimoniale particulière, mais dont le maintien rend possible la protection de la santé humaine et du vivant. Cette nature ordinaire s’oppose aux initiatives de protection exclusive de sites naturels admirables, ou d’espèces animales emblématiques.
[…]
Luttes environnementales, conditions de travail et santé des ouvriers
Au crépuscule du XIXe siècle, dans les manufactures insalubres ou les mines de charbon, des voix s’élèvent pour dénoncer les maux de l’industrialisation. En 1893 puis 1895, ce sont les ouvrières d’usines d’allumettes de Trélazé (Maine-et-Loire), de Pantin et d’Aubervilliers (Seine) qui dénoncent notamment les dégâts sanitaires de leur exposition au phosphore blanc qui provoquent des nécroses maxillaires. Tout comme à Hull (Québec) en 1919, ces grèves d’allumettes rendent visibles les dégâts sanitaires d’une industrialisation à marche forcée. Autour de 1900 encore, l’historienne Judith Rainhorn souligne une convergence entre de rares syndicalistes et des médecins réformateurs, afin de défendre l’interdiction de l’usage de la céruse (ou blanc de plomb) dans la peinture utilisée sur les bâtiments – en France, cette revendication aboutira à l’adoption d’une loi d’interdiction en 1915.
La dénonciation des dommages ouvriers sanitaires et environnementaux de l’industrie se trouve partiellement désamorcée par l’adoption de réglementations encadrant les activités productives dans la plupart des pays industrialisés au début du XXe siècle. En matière de maladies professionnelles, ces lois consacrent le principe de la « réparation forfaitaire des risques du travail ». Ces maux sont présentés comme le revers empoisonné mais inéluctable du progrès. Si les syndicalistes contestèrent initialement cette monétarisation de la santé, la majorité d’entre eux se rallia par défaut à ce qui devint l’un des rares leviers de reconnaissance des maux endurés par les travailleurs.
Pourtant, au cours des années 1960, dans les territoires italiens de la pétrochimie tout comme dans les zones industrielles japonaises, certains groupes ouvriers alimentent une critique de pratiques qu’ils dénoncent comme une manière de « perdre leur vie à la gagner ». Dans une période marquée par une centralité ouvrière (symbolique, politique et sociologique) dans les sociétés occidentales, ces mobilisations réactivent un environnementalisme ouvrier, lequel conjugue un refus de la monétarisation des risques de santé, une volonté de protéger le cadre de vie des classes populaires, tout en énonçant des prescriptions pour une politique du travail plus respectueuse des corps et des environnements.
La justice environnementale, lutte dans un monde abîmé
Dans la typologie proposée par Joan Martinez-Alier, l’environnementalisme des pauvres recouvre également le mouvement se réclamant de la justice environnementale. Celui-ci s’enracine dans l’histoire spécifique des luttes socioécologistes étasuniennes, avant de connaître les résonances dans d’autres aires industrialisées.
Aux États-Unis, deux filiations militantes doivent être soulignées. D’une part, d’anciens militants des droits civiques alimentent une critique des grandes associations environnementales (à commencer par le Sierra Club), accusées de défendre prioritairement une nature « sauvage ». Cette préservation de la wilderness est dénoncée comme un mythe généré par des militants issus de la classe moyenne ou supérieure blanche. D’autre part, une seconde filiation s’inscrit dans la lignée des mobilisations ancrées dans les mondes du travail. Dans les années 1960, de grandes fédérations syndicales étasuniennes exigeaient une réglementation de certaines pollutions industrielles, et parfois une transformation des activités productives, à l’instar du syndicat des travailleurs de l’automobile (l’United Auto Workers). Ce double héritage militant fut à l’origine de grèves intenses, dont celle des éboueurs de Memphis, à laquelle Martin Luther King apporta son soutien lorsqu’il fut assassiné en 1968.
Néanmoins, le mouvement pour la justice environnementale ne s’est désigné comme tel qu’à l’orée des années 1980. Son récit fondateur voudrait qu’il débute lors de la mobilisation des habitants du quartier de Warren County (Caroline du Nord), confrontés au projet d’ouverture d’une décharge de produits toxiques. Ils dénoncent l’inégalité d’exposition aux toxiques dont sont victimes les populations racistes et paupérisées. Leur action se prolonge par l’invention d’un répertoire dans lequel la production de savoirs de santé occupe une fonction toujours plus considérable, comme en témoigne l’enquête d’épidémiologie populaire menée par les habitants de Woburn (en périphérie de Boston), avec le souhait d’éclairer le lien de causalité entre un cluster de leucémies infantiles et leur exposition à des forts taux de plomb, d’arsenic et de chrome. La multiplication des initiatives locales se prolonge dans des coordinations nationales et dans la publication d’études.
En 1987, le chimiste et militant Benjamin Chavis publie un rapport invitant à réfléchir aux processus sociaux de relégation de certaines populations dans des milieux pathogènes comme une forme de « racisme environnemental ». La justice environnementale est peu à peu devenue une grille d’analyse universitaire, consacrée notamment par les travaux du sociologue Robert Bullard au début des années 1990.
Mouvement social, autant que grille d’analyse du social, l’approche par la justice environnementale demeure largement ancrée dans son berceau nord-américain. Des historiens comme Geneviève Massard-Guilbaud et Richard Rodger ont montré la difficulté à transposer en Europe des catégories si liées à l’histoire étasunienne. Pourtant, la plus forte exposition des classes populaires aux toxiques est à l’origine d’une expérience commune de « violence lente » de part et d’autre de l’Atlantique. Proposée par le chercheur Rob Nixon, cette notion vise à désigner le phénomène d’atteintes différées à la santé qui marque les populations vivantes dans les territoires abîmés, ainsi que la difficulté à se mobiliser face aux pollutions dont les effets deviennent perceptibles après plusieurs décennies.
C’est pourtant face à ces violences pernicieuses qui se sont élevées habitants et salariés de nombre d’aires pétrochimiques dans l’Europe, au cours des années 1970. Ces initiatives se prolongent parfois jusqu’à nos jours, comme en témoignent les collectifs militants de Pierre-Bénite, dans le couloir de la chimie (Rhône). Après des conflits particulièrement vifs contre la fabrique d’acroléine entre 1976 et 1978, ce sont aujourd’hui les pollutions rémanentes des perfluorés (ou PFAS) qui sont au cœur des protestations adressées aux industriels de la chimie.
En France, au début du XXIe siècle, un ménage appartenant au décile le plus aisé de la population émet chaque année l’équivalent de 30 à 40 tonnes de dioxyde de carbone, soit au moins deux fois plus qu’un ménage appartenant au décile le plus pauvre (environ 15 tonnes). Pourtant, ce constat n’empêche pas l’éternelle réitération de la stigmatisation des classes populaires.

Éditions Tallandier
Contrairement aux parangons de la modernisation écologique, l’ethos des actrices et acteurs d’un environnementalisme populaire se caractérise souvent par une relative modestie dans le récit de leur rapport à une nature ordinaire. Cette attitude est aux antipodes de la mise en spectacle du syndrome du sauveur de la planète. De plus, l’étau de contraintes qui verrouillait le champ des possibles pour les pêcheurs sétois de l’après-guerre dans leur rapport à l’environnement ne s’est pas desserré pour les classes populaires du XXIe siècle. Il n’en reste pas moins que certaines fractions de celles-ci restent porteuses d’un rapport singulier à l’environnement.
![]()
Renaud Bécot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. L’écologie, un problème de riche ? L’histoire environnementale nous dit plutôt le contraire – https://theconversation.com/lecologie-un-probleme-de-riche-lhistoire-environnementale-nous-dit-plutot-le-contraire-258764