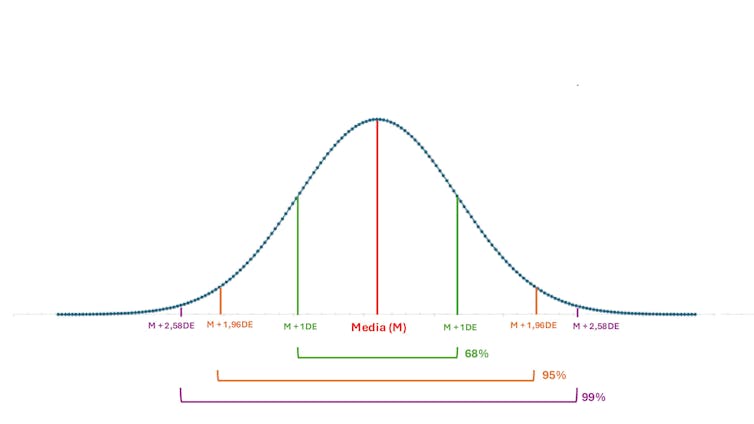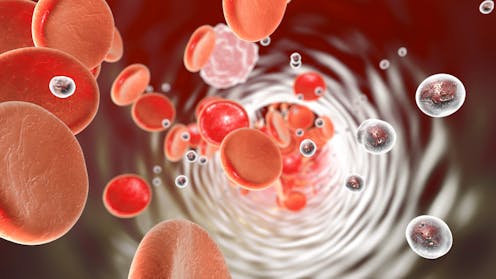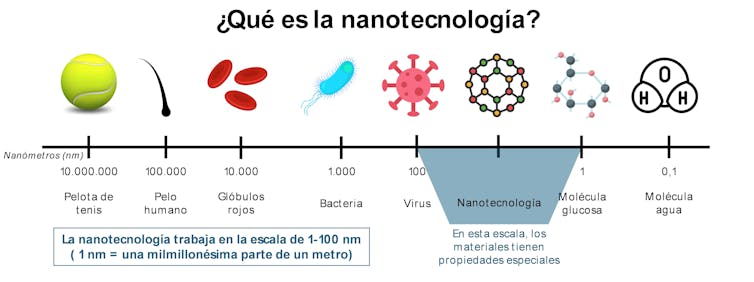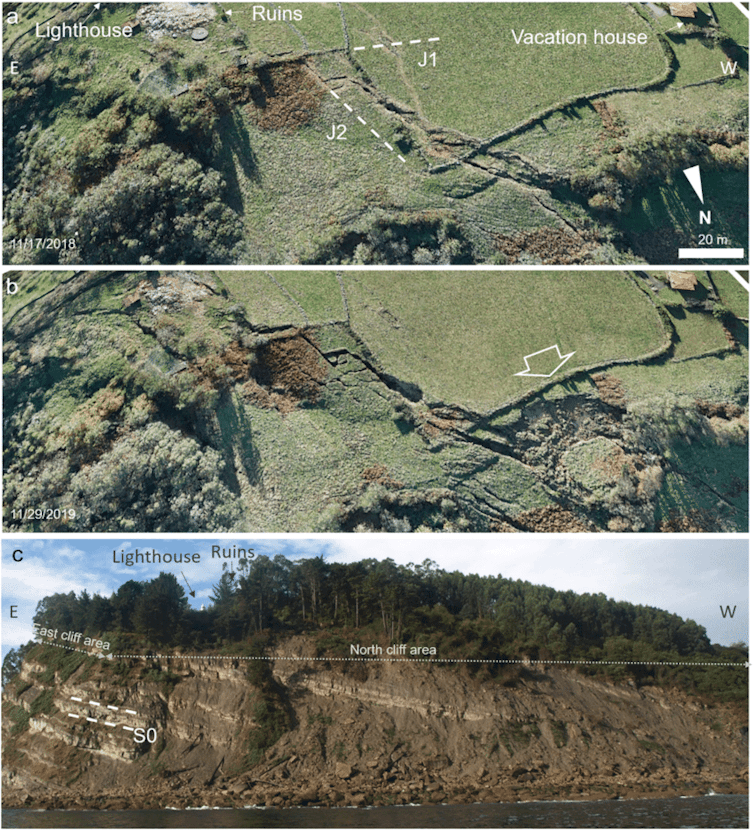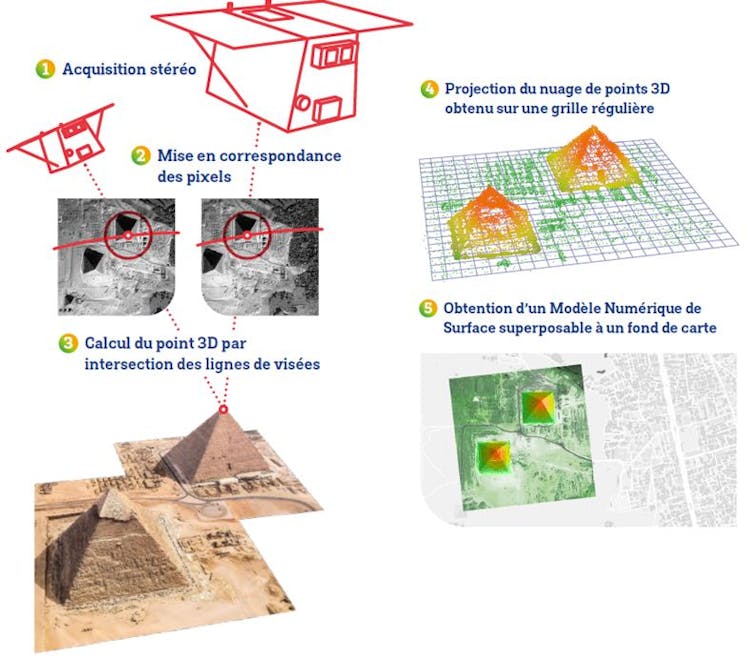Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alicia Nila Martínez Díaz, Profesor Acreditado Contratado Doctor Filología Hispánica, Universidad Villanueva

En 1962, Mario Vargas Llosa ganó el Premio Biblioteca Breve con La ciudad y los perros. Carmen Martín Gaite, con su novela Ritmo lento, quedó finalista.
En 2025, cuando conmemoramos el centenario de la escritora salmantina y tenemos reciente la muerte del Premio Nobel, nos detenemos en este instante clave de la historia de la literatura hispánica en el siglo XX para intentar entender cómo se construyó el canon de la novela española contemporánea.
Un nuevo galardón
Carlos Barral creaba en 1958 el Premio Biblioteca Breve. El poeta y editor decidió instaurar este galardón para potenciar el enfoque innovador, experimental y transgresor del catálogo de la editorial.
Como él mismo explicó, el premio se otorgaría a una novela que “debía contarse entre las que delatan una auténtica vocación renovadora o entre las que se presumen adscritas a la problemática literaria y humana estrictamente de nuestro tiempo”.
Esta apuesta modernizadora implicaba no pocos riesgos que Barral supo afrontar con el coraje y el pragmatismo necesarios para conseguir posicionar al galardón como uno de los más relevantes de la literatura en lengua española.
Sin saberlo, estaba contribuyendo al desarrollo del denominado boom latinoamericano.
La novela rompedora

Universitätsarchiv St.Gallen / Regina Kühne, CC BY-SA
Cuatro años más tarde, un joven y desconocido escritor peruano se hizo con el premio. Se llamaba Mario Vargas Llosa. Aunque no tenía a sus espaldas más que unos cuantos ensayos y algún que otro ejercicio de crítica literaria, su novela, breve y corrosiva con la tradición, no podía maridar más y mejor con los presupuestos del premio Biblioteca Breve. La ciudad y los perros era un artefacto literario ambicioso y agresivo, estructurado sobre el desafío del fragmento y marcado a fuego por la denuncia de la violencia institucional.
Premiando este relato, Barral perseguía la publicación de una nueva narrativa hispánica, emisaria de los vientos renovadores que soplaban desde América Latina y que entraba sin miedos ni complejos en dialéctica con las vanguardias europea y norteamericana. Laurear a Vargas Llosa significaba apostar por ese boom que ya alboreaba.
La cuestión es ¿por qué se otorgó el segundo puesto a Ritmo Lento? ¿Qué lugar quedaba para una novela diametralmente opuesta al relato ganador?
Dos formas de sacudir la literatura
La ciudad y los perros y Ritmo lento no pueden ser novelas más distintas. La primera está ambientada en un colegio militar de Lima y, gracias a una estructura narrativa fragmentaria, el relato despliega ante el lector una constelación de voces que articulan una feroz crítica a las instituciones autoritarias. Por la profundidad psicológica de sus personajes, por su violencia real y simbólica y por su voluntad de ruptura formal, heredada de su maestro William Faulkner, Vargas Llosa llegaba para plantearnos una historia dura y valiente contada de una forma distinta.
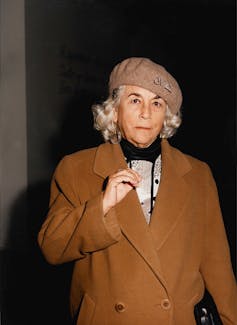
Casa de América/Flickr, CC BY-NC-ND
Por el contrario, Carmen Martín Gaite se adentraba con Ritmo lento en la conciencia de un anciano que, desde la reclusión de un psiquiátrico, hacía balance de su existencia. La novela utiliza la introspección como motor narrativo para proponer al lector una narración focalizada en el tiempo interno del personaje, en la estela de Virginia Woolf en La señora Dalloway –de la que Martín Gaite sería, por cierto, traductora al español– o Italo Svevo en La conciencia de Zeno.
Focalizada en la subjetividad, el monólogo interior y la atención por el detalle, la novela de Martín Gaite no parecía encajar, a priori, en los estándares marcados por Barral. Sin embargo, era una provocación para el establishment literario de la época y, quizás por ello –debió pensar Barral– merecía quedar finalista.
Porque el de Martín Gaite era también un texto escrito para subvertir, desafiar y turbar. De hecho, ella y su amigo Luis Martín Santos fueron los primeros escritores españoles en disputarle la supremacía al realismo imperante de la narrativa española de posguerra. Tiempo de silencio y Ritmo Lento constituyen “dos intentos aislados por volver a centrar el relato en el análisis psicológico de un personaje”, como la escritora escribió en su “nota” a la tercera edición de la novela. Leída desde hoy, Ritmo Lento representa una apuesta igual de bizarra que la de Vargas Llosa, pero menos sobresaliente.
El jurado premió la potencia narrativa de la obra del peruano. Pero otorgando a Martín Gaite ese segundo lugar lo que estaba poniendo sobre el tapete de la historia literaria no era solamente una elección estética, sino dos formas de estar y de pensar en la literatura.
¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.
Rescatar el instante
Volver la vista al palmarés del Biblioteca Breve de 1962 no es un ejercicio de arqueología literaria. Es también la interpretación de un momento literario que marcaría los destinos de la literatura hispánica contemporánea.
Para Vargas Llosa constituyó el pistoletazo de salida para una carrera que le conduciría al Nobel. Para Martín Gaite, en cambio, fue el espaldarazo necesario para continuar escribiendo desde los márgenes y con una fidelidad inquebrantable hacia lo narrado en voz baja.
Ahora podemos interpretar ese momento como una intersección en las trayectorias de dos grandes de la narrativa hispánica. O, lo que es lo mismo, dos modos simbólicos de entender la literatura.
![]()
Alicia Nila Martínez Díaz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Mario Vargas Llosa y Carmen Martín Gaite: el premio literario que revolucionó la literatura en español – https://theconversation.com/mario-vargas-llosa-y-carmen-martin-gaite-el-premio-literario-que-revoluciono-la-literatura-en-espanol-260871