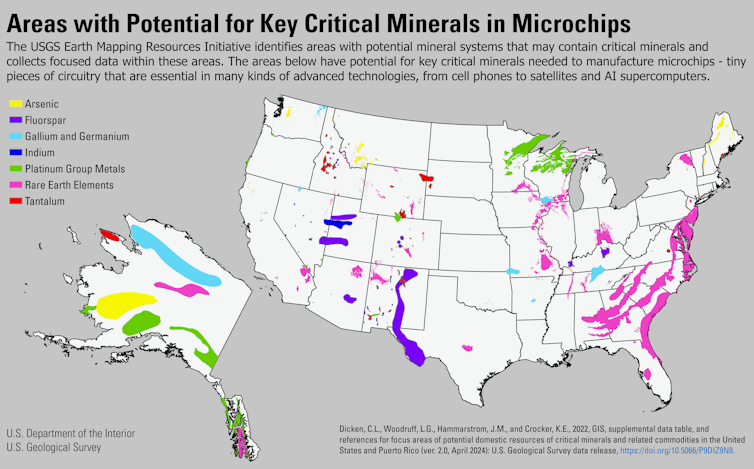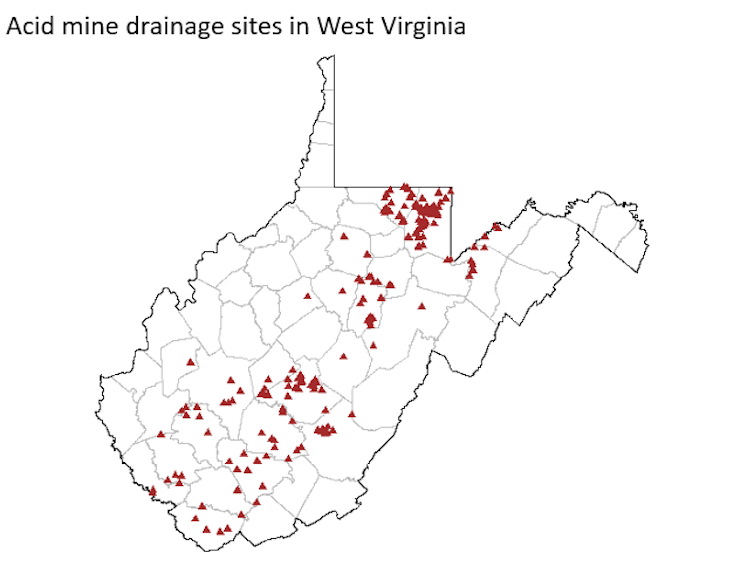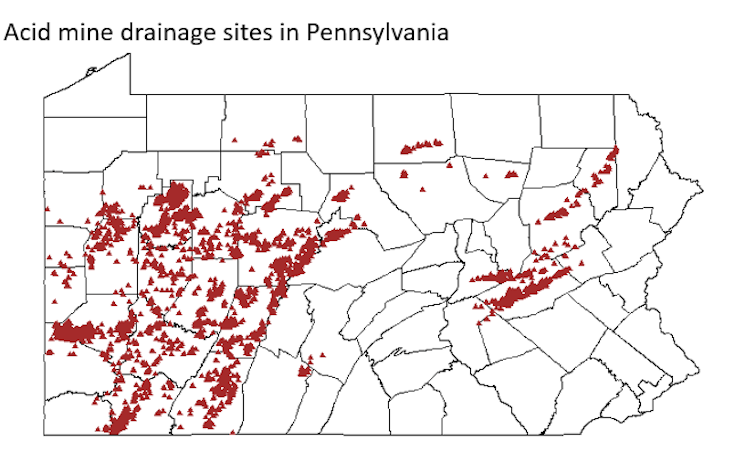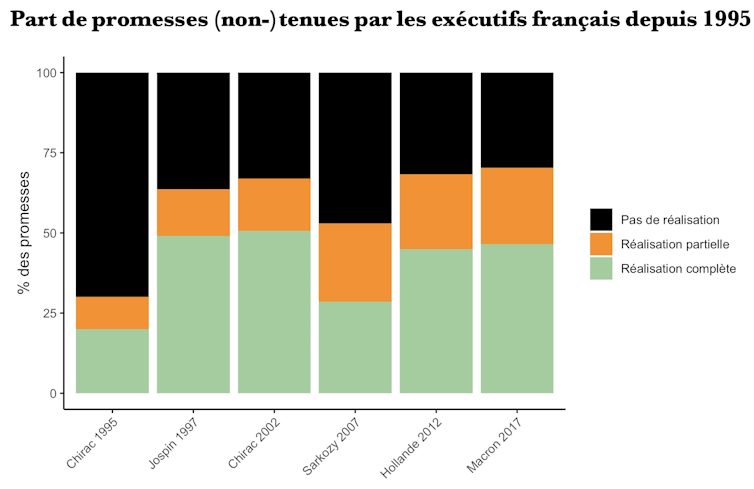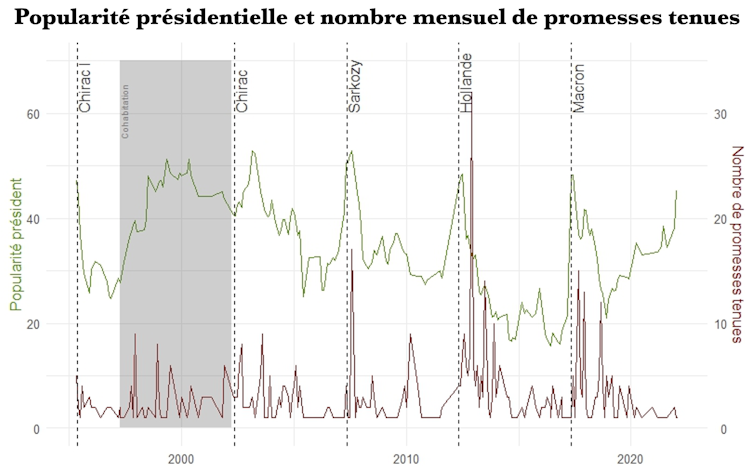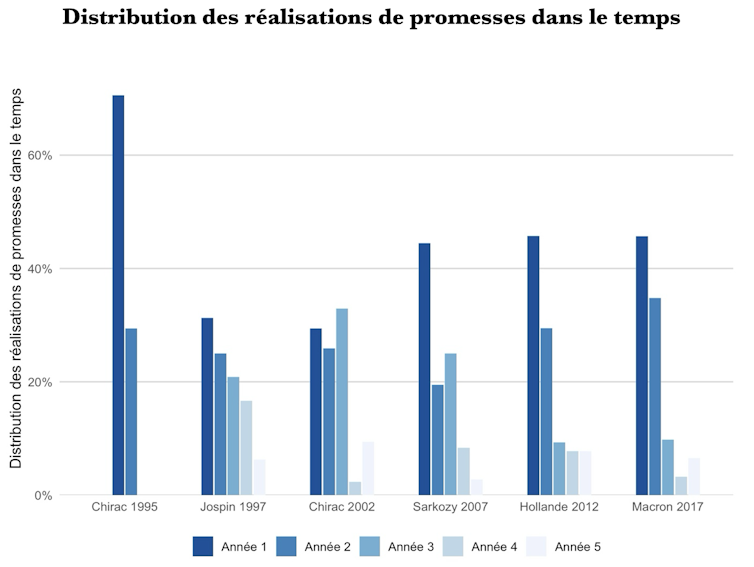Source: The Conversation – in French – By Édouard Delruelle, Professeur de Philosophie politique, Université de Liège
Dans le cadre de notre émission consacrée à la défense de la liberté académique, diffusée vendredi 23 janvier, nous publions cet article initialement paru dans le Quinzième jour, le quadrimestriel de l’Université de Liège. Édouard Delruelle y développe un plaidoyer en faveur de l’inscription de la liberté académique dans la Constitution belge comme une étape pour ouvrir un débat démocratique sur le sujet.
En septembre dernier, l’Université de Berkeley, temple historique de la liberté de pensée, a accepté de livrer à l’administration Trump une liste d’étudiants et de professeurs suspectés d’« antisémitisme » en raison de leur engagement en faveur de la cause palestinienne.
Dans cette liste figure la philosophe Judith Butler, docteure honoris causa de l’université de Liège. Qui aurait imaginé, il y a un an à peine, que les universités les plus performantes et les plus prestigieuses au monde seraient l’objet d’attaques aussi violentes de la part du pouvoir politique, et qu’elles céderaient si prestement à ses intimidations et injonctions ? Que des programmes de recherche essentiels pour l’avenir de l’humanité dans les domaines de la santé ou du climat seraient démantelés ? Que les chercheurs en sciences humaines et sociales devraient bannir de leur vocabulaire des termes tels que diversité, égalité, inclusion ?
En Belgique, des coupes et des inquiétudes
Pourtant, nous avions tort de penser que ces atteintes brutales à la liberté académique ne pouvaient avoir cours que dans les régimes autoritaires. Cela fait plusieurs années que l’Academic Freedom Index enregistre une dégradation de la liberté académique en Europe. Intrusion du management dans la gouvernance universitaire, culture de la « post-vérité » sur les réseaux sociaux, ciblage d’intellectuels critiques par l’extrême droite, stigmatisation d’un prétendu « wokisme » que propageraient les études de genre, décoloniales ou LGBTQIA+ : ces offensives ne sont pas neuves, et elles touchent aussi la Belgique.
Mais un coup d’accélérateur a indéniablement été donné en 2025, avec les coupes budgétaires dans la recherche décidées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une réforme drastique des retraites des Académiques, avant d’autres mesures annoncées sur le précompte chercheur ou le statut de fonctionnaire. Les mouvements Stand Up for Science au niveau mondial, ou « Université en Colère » chez nous, témoignent de l’inquiétude de la communauté universitaire face aux menaces qui pèsent sur la liberté académique.
De nombreuses menaces
Ces menaces sont multiples. On peut schématiquement en identifier quatre :
-
les menaces politiques provenant de gouvernements et de mouvements politiques déterminés à contrôler idéologiquement la production et la diffusion des connaissances ;
-
celles que font peser sur la science la logique économique de marché
– rentabilité, compétitivité, privatisation de la recherche, avec comme conséquences, entre autres, la précarisation grandissante des chercheurs et le découplage de l’excellence scientifique et de la liberté académique ;
-
l’emprise des technologies du numérique et leur l’impact sur la propriété intellectuelle, l’autonomie pédagogique, l’esprit critique ou la créativité (fake news, IA mobilisée à des fins de propagande, intrusion des réseaux sociaux dans les débats académiques, etc.) ;
-
la propagation d’un « sciento-populisme » au sein d’une opinion publique de plus en plus polarisée et critique à l’égard des élites (intellectuelles, judiciaires, journalistiques, etc.).
Ces menaces se conjuguent le plus souvent : la censure politique d’un Trump s’exerce par la pression économique, la Tech numérique délégitime la science auprès des internautes, les impératifs financiers justifient la mise au ban des savoirs critiques. Aucun domaine de recherche n’est épargné : les sciences humaines et sociales sont attaquées en raison de leur prétendue dangerosité idéologique ou de leur inutilité économique présumée mais les STEM (sciences, technologie, ingénierie, mathématiques) sont aussi menacées d’être instrumentalisées comme simples vecteurs de puissance géopolitique, comme c’est déjà le cas en Russie ou en Chine.
La recherche en plein « warscape »
La recherche scientifique évolue dorénavant dans un « warscape », c’est-à-dire un espace traversé par la violence politique, sociale et économique, et où les rapports de pouvoir et de savoir sont complètement reconfigurés. Trois modalités de ces rapports se dégagent :
-
la guerre contre la science menée par ceux qui veulent la destruction de l’autonomie des universités et de la libre recherche (en même temps que celle de la démocratie) ;
-
la guerre dans la science, du fait des fractures au sein de la communauté universitaire elle-même autour de questions controversées telles que le colonialisme, le conflit israélo-palestinien, le transgenrisme, etc. ;
-
la science face à la guerre, qui soulève la question des collaborations « à risques », notamment avec l’industrie de l’armement ou avec des partenaires internationaux potentiellement impliqués dans des violations du droit humanitaire – question très polarisante, comme l’a montré à l’ULiège la polémique autour de la chaire Thalès.
Une culture citoyenne
C’est dans cette perspective que la liberté académique, j’en suis convaincu, doit être défendue et protégée, non par corporatisme, mais parce qu’elle est la condition de tout développement scientifique comme de tout État de droit et de toute démocratie.
Telle est aussi la conclusion du remarquable rapport publié récemment par Sophie Balme pour France Universités, qui propose une “stratégie globale” de renforcement de la liberté académique en 65 propositions. Comment créer une véritable culture professionnelle, politique et surtout citoyenne autour de la liberté de recherche et d’enseignement ? Une culture citoyenne surtout, car l’une des raisons pour lesquelles Trump peut attaquer si brutalement les universités est l’hostilité d’une grande partie de l’opinion publique américaine à l’égard d’un monde universitaire jugé arrogant, coupé des réalités et entretenant un système de reproduction sociale financièrement inaccessible au plus grand nombre. Nous devons éviter de nous retrouver dans cette situation.
La première des 65 propositions de Sophie Balme est d’inscrire la liberté académique dans la Constitution française. Pourquoi pas aussi en Belgique, qui suivrait ainsi l’exemple de l’Italie ou de l’Allemagne (dont on sait quelles tragédies historiques ont été à l’origine de leurs constitutions d’après-guerre) ? Ouvrons le débat.
Ouvrir un débat démocratique
Certains constitutionnalistes objecteront que si la liberté académique ne figure pas formellement dans le texte constitutionnel, elle est néanmoins explicitement reconnue par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’Homme, et qu’elle est en outre consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un texte qui est au sommet de la pyramide normative et d’application directe dans notre droit national. D’un point de vue juridique, ma proposition serait comme un coup d’épée dans l’eau. On répondra toutefois que presque toutes les libertés fondamentales sont dupliquées aux deux niveaux normatifs, européen et national, ce qui renforce leur effectivité juridique et leur portée symbolique.
Mais surtout, le processus politique de révision de la Constitution qu’il faudra parcourir serait l’occasion d’une large mobilisation du monde académique et, espérons-le, de la société civile, et d’un débat démocratique autour de la liberté de recherche et d’enseignement. Ce débat obligerait les partis politiques à se positionner et à en tirer les conséquences sur les plans programmatique et législatif. Et il représenterait une belle opportunité de solidarité et d’échange entre acteurs et actrices de la recherche au nord et au sud du pays.
Une liberté spécifique et complexe
Ce débat serait surtout l’occasion de s’interroger sur la spécificité et la complexité de la liberté académique. Spécificité par rapport à la liberté d’expression, dont jouit tout citoyen et qui l’autorise à dire ce qu’il veut (hors des atteintes à la loi), y compris des choses idiotes et insignifiantes – ce dont un grand nombre ne se prive pas. Tandis que la liberté académique est un outil au service d’une finalité qui dépasse son bénéficiaire : la recherche de la vérité sans contraintes (une belle définition du philosophe Paul Ricœur sa « Préface » à Conceptions de l’université de J. Drèze et J. Debelle. Une finalité qui nous impose des devoirs (à commencer par celui de nous soumettre au jugement de nos pairs).
Complexité ensuite de la liberté académique, qui est multidimensionnelle, comme en témoignent les cinq critères utilisés par l’Academic Freedom Index : la liberté de recherche et d’enseignement, la liberté de collaborer, d’échanger et de diffuser les données et les connaissances, l’autonomie institutionnelle des universités, l’intégrité du campus à l’égard des forces de l’ordre mais aussi des groupes militants violents et enfin la liberté d’expression académique et culturelle, y compris sur des questions politiques ou sociétales.
De vrais enjeux se posent quant aux limites de chacune de ces libertés, et aux tensions qui peuvent exister entre elles, en particulier entre la liberté académique individuelle et l’autonomie des universités. Car pour garantir celle-là, celles-ci ne doivent-elles pas s’astreindre à une certaine « réserve institutionnelle » (un terme plus approprié que « neutralité ») sur les questions politiques ? Je le crois ; mais cette « réserve » est-elle encore de mise face à des violations caractérisées du droit international et du droit humanitaire ? C’est toute la complexité du débat autour des collaborations avec les universités israéliennes…
Résistance, nuance, responsabilité
Comment faire de nos universités des espaces à la fois ouverts sur le monde et préservés de la violence qu’il engendre ? Des espaces de résistance à l’obscurantisme abyssal qui gangrène nos sociétés, de nuance contre les simplismes idéologiques, de responsabilité à l’égard des immenses défis environnementaux, sociaux, géopolitiques dont dépend l’avenir de l’humanité ? Ce qui arrive aujourd’hui au monde de la recherche doit faire réfléchir chacun d’entre nous sur son ethos académique, sur le mode de subjectivation qu’implique un exercice sans réserve mais responsable de la liberté académique. Mais cette réflexion doit aussi être collective, autour d’un objectif mobilisateur. C’est ce que je propose.
La liberté académique dans la Constitution, ce n’est donc pas figer dans le marbre une vérité révélée, mais au contraire ouvrir le débat sur une liberté essentielle mais menacée, qui regarde tant les acteurs de la recherche que les citoyens qui en sont les destinataires finaux. Ce n’est pas non plus cantonner le débat au niveau belge, mais créer l’opportunité d’un mouvement à l’échelon européen, afin que la recherche y préserve son autonomie à l’heure où, en Chine et aux États-Unis (et ailleurs), elle est désormais sous contrôle politique. Sophie Balme propose ici aussi des pistes d’action pour l’Union européenne, en termes d’investissements mais aussi d’outils concrets de mesure et de promotion de la liberté académique. Et bien sûr, nous devons continuer à manifester notre solidarité envers les chercheurs inquiétés ou opprimés partout dans le monde.
Pour atteindre ces objectifs, je suggère une double stratégie, par « en haut » et par « en bas ». D’un côté, un engagement des rectrices et des recteurs du nord et du sud (via le CREF – Conseil des rectrices et recteurs francophones – et le VLIR – Vlaamse interuniversitaire raad), en nouant aussi des alliances par-delà les frontières. L’ULiège pourrait être le moteur d’un tel engagement, par la voix de la rectrice Anne-Sophie Nyssen. De l’autre côté, une mobilisation de nous tous, acteurs et actrices de la recherche, envers le monde politique et la société civile – une mobilisation qui prendrait la forme de pétitions, de colloques, de forums, mais aussi de production de savoirs qui manquent cruellement dans le domaine francophone (Notons malgré tout l’Observatoire des atteintes à la liberté académique).
En tous cas, il est grand temps d’agir si nous ne voulons pas plier demain, à notre tour, devant les apprentis Trump qui pullulent autour de nous.

Édouard Delruelle a reçu des financements du FNRS (Belgique) et de l’Université de Liège
– ref. Face aux attaques contre la science, l’importance d’inscrire la liberté académique dans la Constitution belge – https://theconversation.com/face-aux-attaques-contre-la-science-limportance-dinscrire-la-liberte-academique-dans-la-constitution-belge-273947



![]()