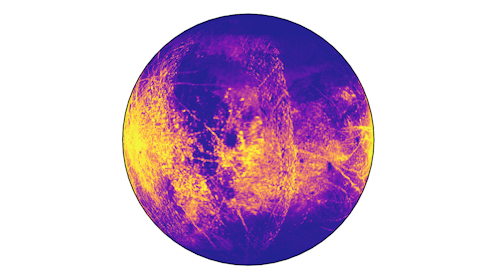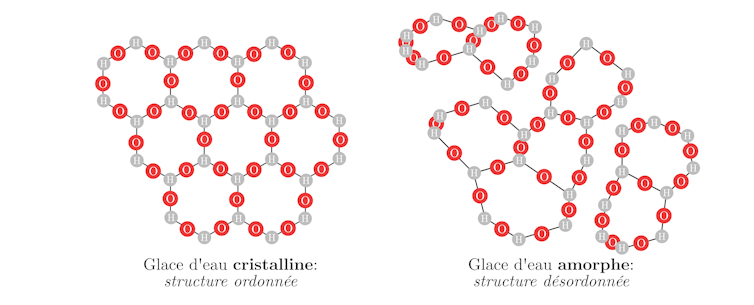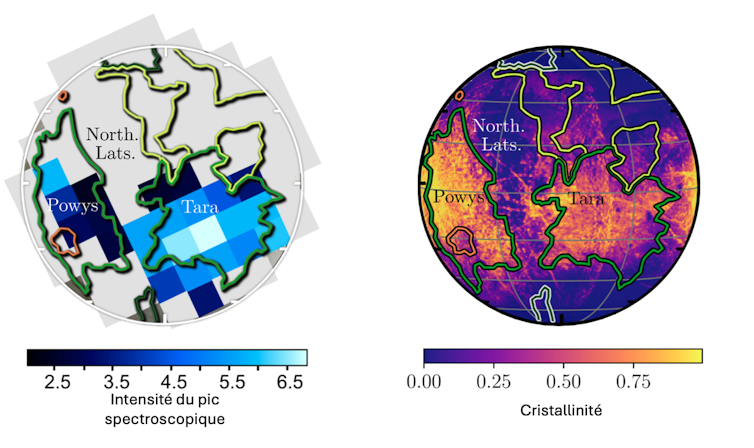Source: The Conversation – (in Spanish) – By Francisco José Esteban Ruiz, Profesor Titular de Biología Celular, Universidad de Jaén
Tener convicciones profundas –ya sean creencias religiosas, espirituales, filosóficas o existenciales– es una experiencia universal y profundamente humana. Estas formas de interpretación del mundo pueden funcionar como refugio, como marco para dar sentido a la vida o como sostén frente al dolor.
Aunque algunas de estas certezas suelen quedar fuera del ámbito científico, sí que podemos estudiar el impacto subjetivo y emocional que, desde el punto de vista neurobiológico, generan las prácticas contemplativas asociadas a ellas.
Cabe decir que si bien hay prácticas, como la oración o la meditación, que presentan una intención espiritual e implican la adhesión a creencias (ya sea en lo divino, en valores profundos o en uno mismo), otras, como la meditación secular o de atención plena (mindfulness), no se basan en creencias religiosas.
Y más allá de su contexto cultural o simbólico, estas actividades están profundamente arraigadas en nuestra neurobiología, pues activan circuitos cerebrales que promueven el bienestar emocional y físico, tal y como demuestran diferentes estudios científicos recientes.
No obstante, los mismos mecanismos cerebrales que refuerzan creencias beneficiosas pueden, en ciertos casos, alimentar el fanatismo y bloquear la apertura al diálogo. En este sentido, hay estudios que apuntan a que las creencias radicales se asocian a fallos metacognitivos, es decir, a una menor capacidad para cuestionar las propias ideas.
El cerebro premia la creencia
En un artículo publicado en The Conversation, José R. Alonso, catedrático de Biología Celular y Neurobiólogo, escribía: “La mayoría de los neurocientíficos y psicólogos que han trabajado en el tema coinciden: las creencias en lo sobrenatural están enraizadas en los procesos cognitivos normales”.
Alonso citaba un trabajo en el que se detectó que durante el rezo se producía un aumento significativo de la activación del núcleo caudado, una zona del cerebro relacionada con el sistema de recompensa. Esto apoya la hipótesis de que la oración estimula el sistema dopaminérgico y el circuito de recompensa cerebral.
Nuevas evidencias lo respaldan. En un estudio de revisión reciente se indica que las experiencias religiosas o espirituales intensas dependen de la interacción entre el núcleo accumbens, una estructura cerebral con un papel fundamental en los sistemas de recompensa, motivación y placer, y dos redes cerebrales que configuran un patrón cerebral similar al que se observa en momentos de disfrute estético, conexión interpersonal o motivación profunda.
La primera de ellas es la red por defecto, cuya función resulta esencial para la vida mental interna, la construcción del sentido del yo y la preparación del cerebro para responder de manera flexible a las demandas del entorno.
Y la otra sería la red de saliencia. Imprescindible para la adaptación al entorno, permite que el cerebro se enfoque en lo verdaderamente importante, regulando el cambio entre diferentes modos de pensamiento y conectando emociones, cuerpo y cognición para una respuesta flexible y efectiva.
Efectos similares al amor, el sexo o la música
En esta misma línea, investigadores de la Universidad de Utah mostraron que las experiencias religiosas y espirituales encienden el núcleo accumbens de manera similar a estímulos como el amor, el sexo o la música. Además, observaron activación en la corteza prefrontal medial, implicada en la valoración y la toma de decisiones morales.
Leer más:
‘Decidido’, de Robert Sapolsky: la ilusión del libre albedrío
En otro análisis de imágenes de resonancias funcionales cerebrales se detectó que cuando las personas devotas sienten lo que denominan “el espíritu”, al rezar o leer textos sagrados, también se activan la corteza orbitofrontal medial y el córtex cingulado anterior, zonas clave en la evaluación emocional y el control de la atención. Cabe decir que el córtex cingulado anterior resuelve el conflicto emocional suprimiendo la actividad de la amígdala, estructura clave en las emociones.
Lo más sorprendente es que esa actividad cerebral parece preceder subjetivamente al momento en que la persona reconoce su conexión espiritual. Esto sugiere que el cerebro no solo acompaña dichas experiencias, sino que puede anticiparlas, activándose antes incluso de que seamos conscientes de ellas.
Creencias que dan sentido, conexión… y salud
Una de las funciones más potentes de las creencias profundas es que otorgan sentido a nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles. Esta función no es meramente narrativa, sino que tiene efectos biológicos reales.
Por ejemplo, en un metaanálisis con más de 136 000 participantes se demostró que las personas con mayor propósito en la vida (el cual que puede surgir de una convicción religiosa, filosófica, espiritual o existencial) tenían un riesgo un 17 % menor de mortalidad por cualquier causa y también menor incidencia de eventos cardiovasculares, incluso tras ajustar por edad, sexo y salud física.
Asimismo, un estudio publicado en 2025 con más de 85 000 adultos mostró que un propósito elevado se asocia a mejores valores de función pulmonar y a un 9 % de menor riesgo de deterioro respiratorio con el tiempo.
Por otro lado, estudios recientes muestran que la diversidad de fuentes de significado (familia, trabajo, espiritualidad, comunidad) se asocia a mayor resiliencia, satisfacción vital y menor riesgo de depresión. Las personas con múltiples fuentes de sentido afrontan mejor el estrés y los cambios vitales.
Estos resultados sugieren que percibir que nuestra vida tiene dirección y propósito contribuye no solo al bienestar psicológico, sino también a una mejor salud física y mayor longevidad.
Una interpretación relevante desde otra cultura es el concepto japonés de ikigai, que podríamos traducir como aquello que da sentido a la existencia; es decir, lo que nos motiva a levantarnos cada mañana. Una revisión de 86 trabajos científicos concluyó que el ikigai se asocia con una reducción de los síntomas depresivos, mayor satisfacción con la vida, menos riesgo de mortalidad y menos discapacidad funcional, además de mejoras en la conexión social y en la participación en actividades.
¿Y si no soy creyente?
Lo interesante es que estos efectos no son exclusivos de quienes tienen fe religiosa. Como hemos apuntado, muchas personas no creyentes experimentan bienestar mediante formas de espiritualidad laica como la meditación, la contemplación de la naturaleza, la práctica de la gratitud o el compromiso ético con una causa.
Así, se ha demostrado que tanto las creencias religiosas como las no religiosas activan la corteza prefrontal ventromedial, relacionada con la recompensa, la autorrepresentación y la motivación. Las convicciones religiosas, en particular, muestran mayor activación en regiones asociadas a la gestión emocional y la autopercepción.
Lo importante no es tanto el contenido de la creencia como su función psicológica y biológica, pues ofrece estructura y la posibilidad de conectar con algo que da sentido a la experiencia vital. Creer es un fenómeno con raíces profundas en el cerebro, en las emociones y en nuestra necesidad de sentido.
En definitiva, existen evidencias científicas que confirman que las experiencias religiosas y espirituales activan consistentemente las redes cerebrales de recompensa, saliencia y atención, reforzando la idea de que el bienestar derivado de las creencias tiene una base neurobiológica robusta.
Entender estos procesos puede ayudar al desarrollo de terapias (meditación, mindfulness) que permitan potenciar las experiencias de bienestar y reducir la depresión o la ansiedad.
![]()
Francisco José Esteban Ruiz recibe fondos para investigación de la Universidad de Jaén (PAIUJA-EI_CTS02_2023), de la Junta de Andalucía (BIO-302), y está parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) bajo el proyecto PID2021-122991NB-C21.
Sergio Iglesias Parro recibe fondos de la Universidad de Jaén (PAIUJA-EI_CTS02_2023), y de la Junta de Andalucía (BIO-302).
– ref. ¿Por qué las creencias, religiosas o no, generan bienestar? – https://theconversation.com/por-que-las-creencias-religiosas-o-no-generan-bienestar-260511