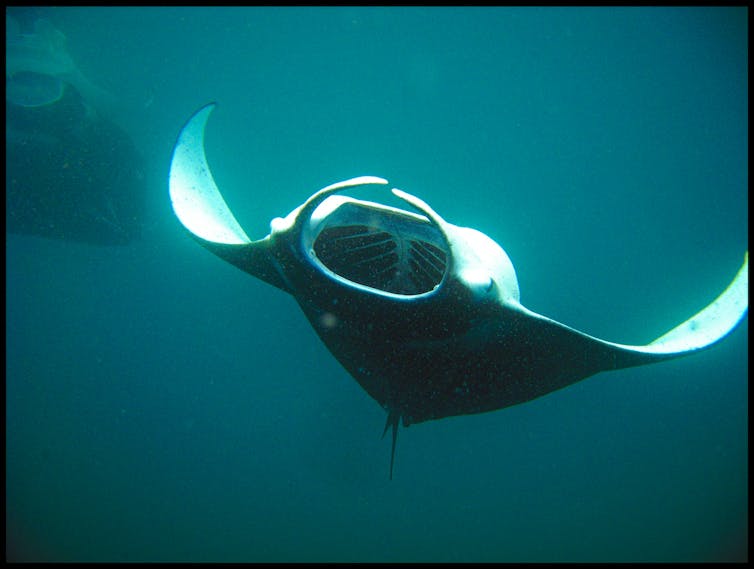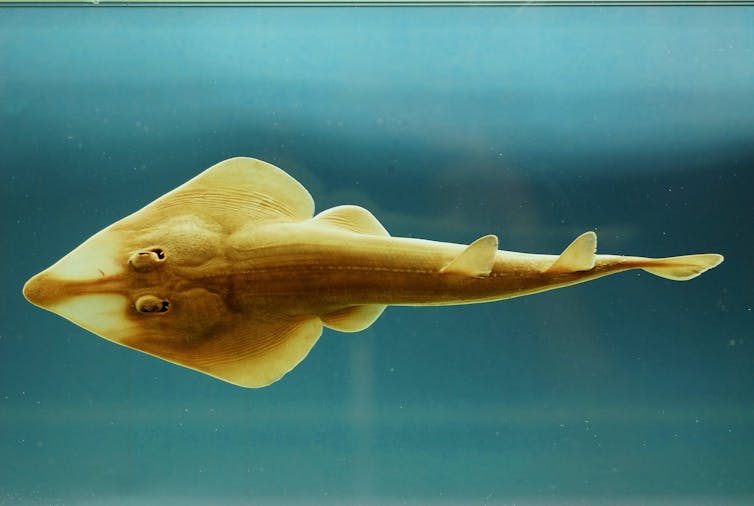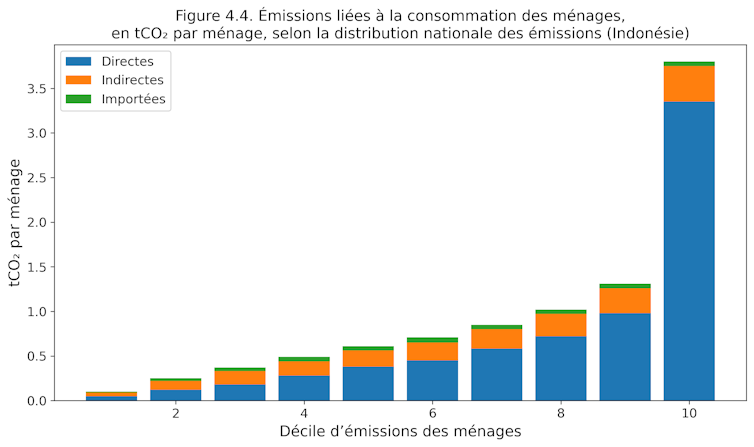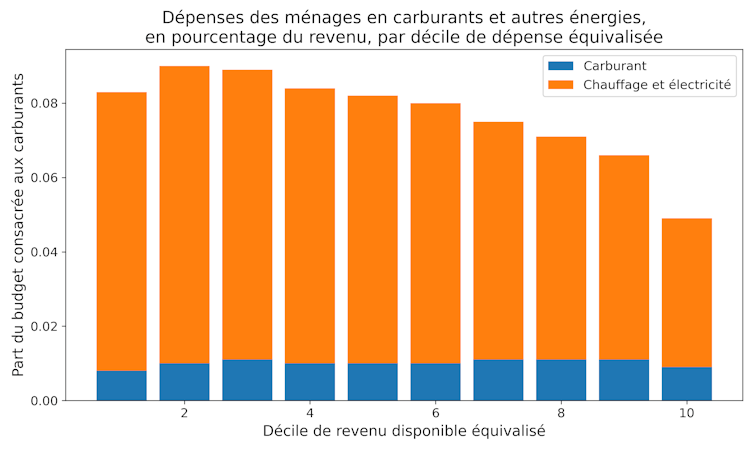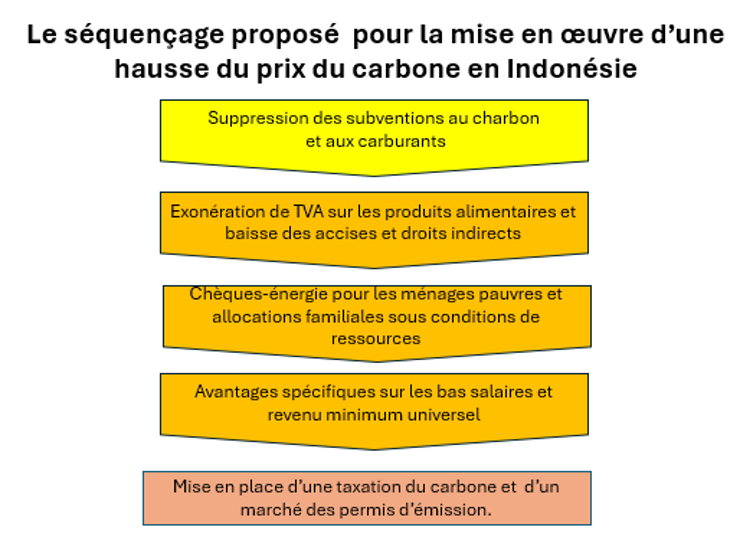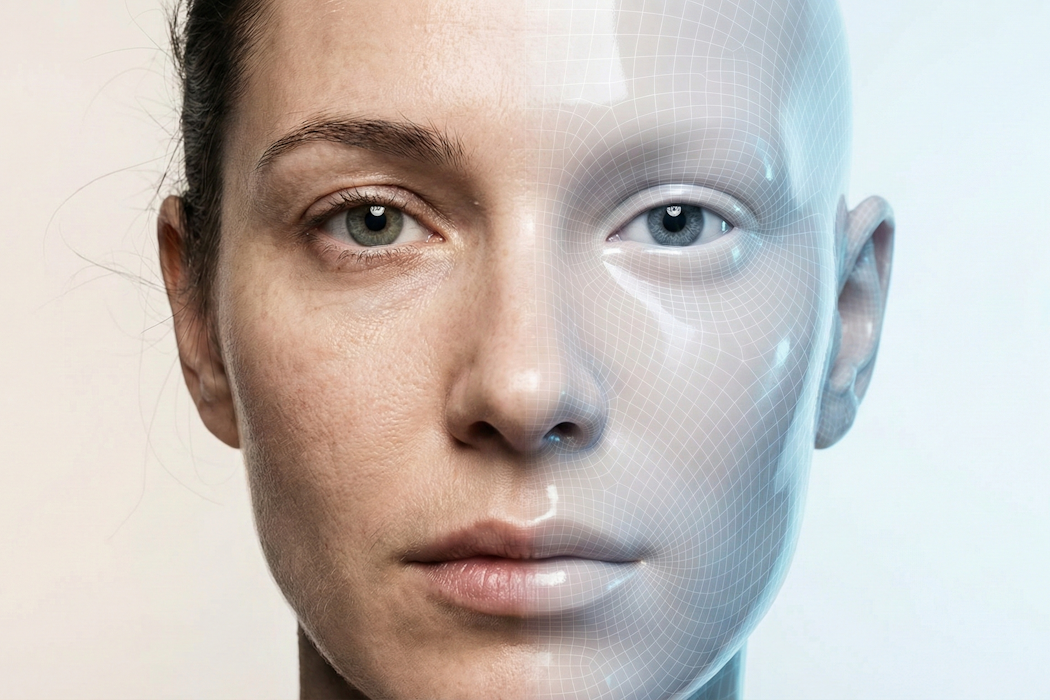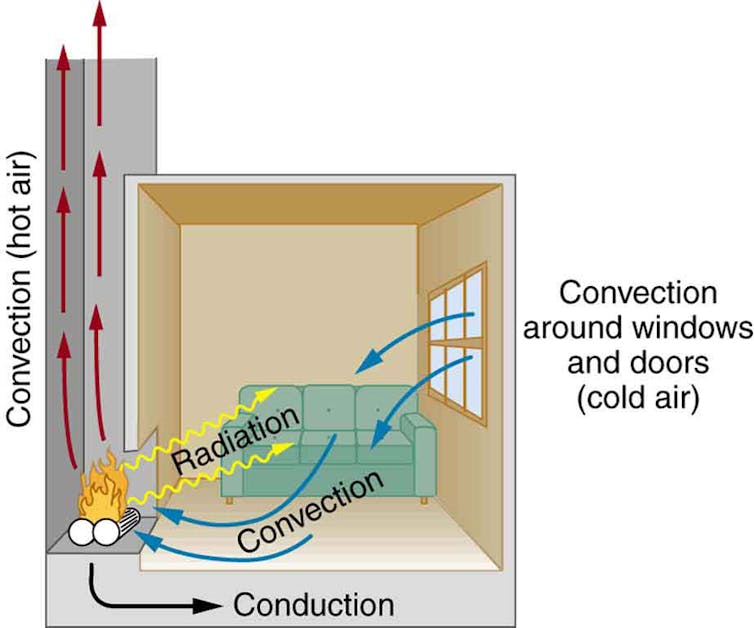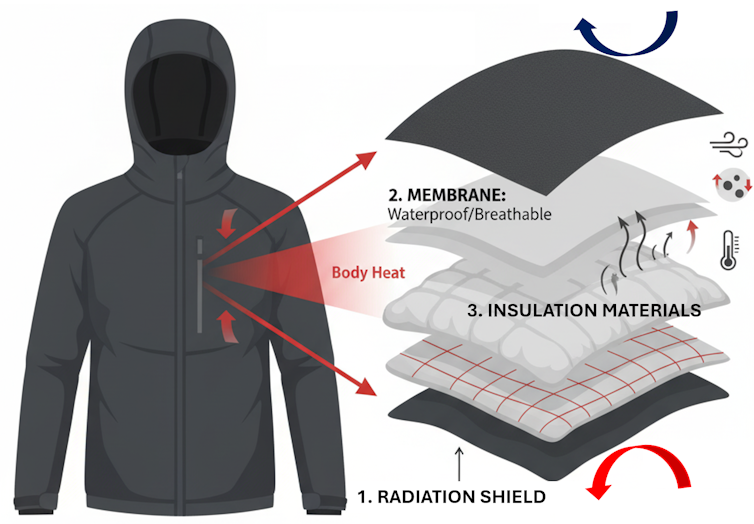Source: The Conversation – France (in French) – By Pierre Cilluffo Grimaldi, Maître de conférences qualifié – SIC, Sorbonne Université

Pandora n’est pas l’Amazonie. Pourtant, depuis plus de quinze ans, la saga Avatar entretient la confusion entre fiction et réalité, nourrissant le mythe séduisant mais problématique du « bon sauvage écologiste ».
La sortie d’Avatar : de Feu et de Cendres le 17 décembre, donne l’occasion de revenir sur un parti pris représentationnel qui irrigue la saga : « le bon sauvage écologiste ».
Le « bon sauvage » reste encore un important référent dans nos imaginaires occidentaux ainsi que nous le présentions dans notre récent ouvrage, L’héroïsation du bon sauvage de l’antiquité au XXIᵉ siècle : émergence de l’éco-spiritualisme. À ce titre, l’actualisation moderne de cette figure se fait autour d’une vision romantique et écologistante dominante dans notre société du spectacle. Cela représente un impensé problématique, puisque le mythe du bon sauvage lie les peuples autochtones à une norme impossible et une assignation identitaire archaïque.
L’appropriation culturelle de James Cameron
Le parallèle entre la réalité amazonienne des peuples premiers et les personnages du film, remplis de pureté et de sagesse mythologique, est directement assumé par le réalisateur. L’univers d’Avatar nous plonge dans un imaginaire édénique sur la planète Pandora, couverte d’une jungle luxuriante qui devient le théâtre d’un choc entre une population autochtone idéalisée et des barbares humains venus exploiter un minerai rare. Cet imaginaire occidental est problématique à plusieurs titres.
James Cameron assume directement la comparaison entre son film de science-fiction et la réalité complexe de l’Amazonie. Par exemple, il a demandé aux acteurs de s’immerger dans la jungle amazonienne auprès des indigènes du Brésil avant le tournage du deuxième film, déclarant : « Je veux amener mes acteurs ici, pour pouvoir mieux raconter l’histoire ». Il dresse ensuite un parallèle direct entre son film et la lutte contre le barrage de Belo Monte, multipliant les interventions dans la presse où fiction et réalité amazonienne semblent absolument comparables.
Le rêve d’une wilderness hollywoodienne
Par ailleurs, l’internationalisation de la « wilderness » étatsunienne et son imaginaire socio-politique transparaît aussi dans l’œuvre de James Cameron. La wilderness traduit un rapport particulier à la nature sauvage et édénique, où l’humain n’est qu’un visiteur temporaire, comme défini par le Wilderness Act de 1964 aux États-Unis. Outre-Atlantique, elle occupe une place centrale dans l’histoire et la culture : elle symbolise d’abord la frontière à conquérir pour l’expansion pionnière, puis devient un idéal de préservation. Cet éco-imaginaire de wilderness doit être appréhendé culturellement.
L’étude de Lawrence Buell a déjà montré le rôle de la wilderness dans la formation, dès les années 90, d’un « imaginaire environnemental » aux États-Unis. Cette pensée nourrit les différents mouvements écologistes, en particulier l’écologie profonde et le monde libertaire. Dans ce cadre, l’Amazonie, par sa force évocatrice, constitue la quintessence d’une « wilderness » : une nature sauvage peuplée de simples « bons sauvages » dans un Éden préservé, propice aux idéalismes. L’Amazonie se transforme ainsi dans l’imaginaire occidental en une nature fabuleuse, animée de monstruosités ou d’angélisme. Cette nature sauvage globalisée dans les éco-imaginaires modernes est pourtant une construction sociale et historique qu’il convient d’interroger. La wilderness est une représentation collective de la nature sauvage, non pas une réalité objective.
Échos d’un néo-colonialisme du quotidien
Dans le contexte du buzz autour du premier film en 2009-2010, le reportage « Le monde d’Avatar en vrai » (magazine « Haute Définition », diffusé sur TF1 le 17 mai 2010) part à la rencontre de la tribu des Yawalapiti. Ce document, toujours disponible sur YouTube, attire massivement les internautes en montrant à l’excès la pureté et l’Éden coupé du monde de ces « bons sauvages », avec des séquences fortement caricaturales. Il s’agit de mettre en scène pour assurer le spectacle par exemple des commentaires sur le 11 septembre pour illustrer leur incompréhension de la violence, ou encore la découverte prétendue de la civilisation occidentale via de multiples images sur un ordinateur.
La persistance du mythe du « bon sauvage » au cinéma
Les rares études sur le sauvage/bon sauvage au cinéma traitent essentiellement des dimensions techniques ou esthétiques. Une exception remarquable est le travail de l’anthropologue Roger Bartra dans son ouvrage Los salvajes en el cine. Ce chercheur mexicain, renommé pour ses travaux sur le « bon sauvage » dans les années 90, démontre la profondeur et la contemporanéité de ce mythe au cinéma et dans notre société occidentale.
Selon Bartra, le mythe de l’homme sauvage est issu d’un stéréotype enraciné dans la littérature et l’art européens depuis le XIe siècle, cristallisé dans un thème précis et facilement reconnaissable. Ce mythe dépasse les limites du Moyen Âge ou de la colonisation et traverse les millénaires, se confondant avec les grands problèmes de la culture occidentale. La civilisation n’a pas fait un pas sans être accompagnée de son ombre : le sauvage. De nos jours, l’idée du « bon sauvage » prend progressivement le pas sur son jumeau « le sauvage ». Bartra met en avant la notion de « néo-sauvages » pour décrire les représentations au sein des industries culturelles dominantes, et notamment via le « soft power » hollywoodien, de personnages : héroïques, valeureux, simples et proches de la nature (ex. : dans « Game of Thrones », Tarzan ou encore Apocalypto de Mel Gibson).
Ainsi, le mythe du « bon sauvage » est une tendance de fond au sein de la culture populaire, particulièrement via le septième art. Cette circulation médiatique du mythe s’adapte aux contextes de nos sociétés. La crise climatique engendre une réactivation de ce mythe vers celui d’un « bon sauvage écologiste », dont Avatar semble être la quintessence.
Déconstruire le mythe du « bon sauvage »
Dans un article critique intitulé « L’Amazonie n’est pas Avatar », l’économiste Hernando de Soto dénonce cette comparaison qui tend à s’installer en Occident. Il fait valoir que de nombreux « mythes et idées reçues persistent à marginaliser les populations indigènes et à les exclure de toute intégration dans l’économie mondiale ».
Selon lui, Avatar perpétue l’idée rousseauiste d’un état de nature idéalisé, dont la figure du « bon sauvage » est clef : « Nous sommes nombreux à avoir adhéré automatiquement aux messages véhiculés par le film, à savoir que les peuples indigènes du monde sont satisfaits de leur mode de vie traditionnel, qu’ils s’épanouissent dans un état d’harmonie rousseauiste avec leur environnement et qu’ils ne voient certes pas l’intérêt de prendre part à l’éconoime de marché de leur pays, mondialisation ou pas. »
Avatar est l’un des rares contenus où la représentation problématique des « bons sauvages » a été dûment traitée par différents chercheurs. Les conclusions sur l’aspect néo-colonialiste sont déjà connues concernant une œuvre caricaturale, à tel point que la chercheuse Franciska Cetti appelle à « décoloniser la science-fiction ».
De notre côté, nous mettons en lumière le caractère systémique de cette représentation du « bon sauvage » au sein d’un ouvrage de vulgarisation de notre thèse. Le bon sauvage est le héros, malgré lui, des errances de l’imaginaire social dans une société occidentale en crise de sens devant l’urgence climatique. Ainsi, la résurgence médiatico-politique du mythe, que Fanon aurait probablement qualifiée de « masque blanc écologique », a nourri les débats durant la COP30 d’un faux multilatéralisme paternaliste. Notre ouvrage permet de mieux saisir l’historicité et le degré civilisationnel de cet impasse écologique et spirituelle.
Vers une critique métapolitique globale
Le « bon sauvage écologiste » n’est pas une construction neutre. Il constitue un dispositif idéologique qui cristallise et légitime un discours vague de reconnexion à la nature. L’universitaire Kent H. Redford appelle à ne plus instrumentaliser cette figure, tout en valorisant les peuples premiers sans recyclage néo-colonialiste.
Alors que l’animisme ou le mélange écologie-spiritualité devient une tendance en Occident, il convient de s’interroger sur la cohérence de cette appropriation culturelle. Selon l’anthropologue Wolfgang Kapfhammer : « La question simple est : est-il viable de penser aux cosmologies des cultures marginalisées pour réanimer la cosmologie hégémonique occidentale qui est tombée en crise ? Ou cela signifie-t-il à nouveau abuser de ces cultures indigènes comme un simple espace de projection pour compenser nos mécontentements culturels ? »
La pensée rousseauiste imprègne encore profondément nos imaginaires. Selon le philosophe, l’homme nait bon par nature et c’est la société qui le corrompt. Ce dernier suppose l’existence d’un état naturel humain où tous les hommes seraient nés bons, purs et innocents, heureux avant de rentrer en contact avec la société et de se pervertir.
À l’heure où règne la reconnexion à la nature et à soi, notamment dans certains milieux de l’écologie politique, les évolutions internes de cette mouvance tendent à revaloriser une « écologie profonde » et collapsologue, traditionnellement ouverte aux mysticismes. L’éco-spiritualisme pourrait même devenir à terme majoritaire dans certains milieux de l’écologie politique.
D’après le chercheur Stéphane François : « Les positions scientifiques et rationnelles, au sein de l’écologie (en Allemagne, en Autriche ou en France par exemple), deviennent minoritaires, au profit de conceptions plus mystiques, ou du moins marquées par l’intuitivité, inspirées notamment des pratiques anthroposophiques, telles celles prônées par Pierre Rabhi. Une part de plus en plus importante des militants écologistes, surtout parmi les néoruraux, acceptent ces discours au nom d’un retour à la nature, largement idéalisé, et d’un rejet des solutions scientifiques ».
En bref, si la saga Avatar séduit par sa beauté visuelle et son appel à la préservation de la nature, elle véhicule aussi un mythe du « bon sauvage écologiste ». Ce dernier, loin d’honorer les peuples autochtones, les enferme dans une idéalisation néo-colonialiste dont il est urgent de se défaire.
Au-devant du dérèglement climatique qui réactive avec force ce vieux mythe rousseauiste, il semble utile de dépasser la figure simpliste du bon sauvage pour proposer des représentations plus complexes et respectueuses des réalités indigènes contemporaines. Ce n’est pas la première fois que l’Amazonie, la wilderness, ou la rencontre entre imaginaires civilisationnels et futur eschatologique, excitent et polarisent nos débats publics et pensées instinctives en Occident devant les ravages ineffables d’un certain capitalisme dérégulé.
Néanmoins, la figure moderne du héros « hyperindien », un sage ancestral capable avec ses pouvoirs de conjurer les maux des excès du capitalisme, semble promis à occuper une place importante dans les mythologies écologiques et le bon sens populaire du XXIe siècle.
![]()
Pierre Cilluffo Grimaldi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Avatar : la réincarnation néo-colonialiste du « bon sauvage » et ses impasses écologiques – https://theconversation.com/avatar-la-reincarnation-neo-colonialiste-du-bon-sauvage-et-ses-impasses-ecologiques-272572