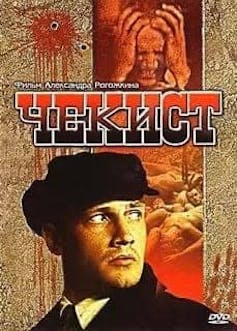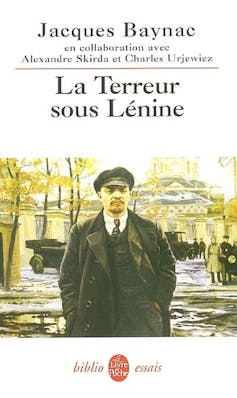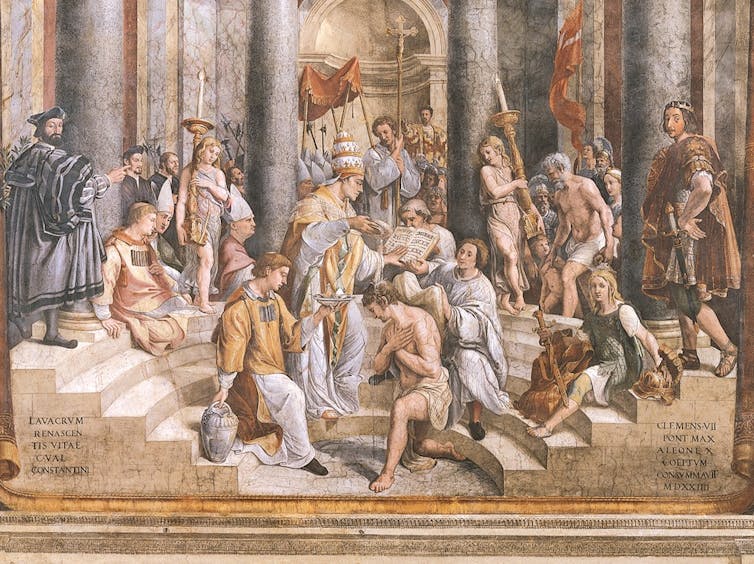Source: The Conversation – in French – By Mikael Fauvelle, Associate Professor and Researcher, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University

En réexaminant des matériaux prélevés lors de fouilles anciennes, des scientifiques ont pu déterminer que le plus ancien bateau en planches du Danemark provenait probablement d’une région éloignée de la tourbière où il a été retrouvé.
Il y a environ 2 400 ans, avant l’émergence de l’Empire romain, une petite armada de bateaux s’approcha de l’île d’Als, près de la côte du Jutland méridional, dans l’actuel Danemark. Cette armada transportait environ quatre-vingts guerriers armés de lances et de boucliers. Certains étaient des officiers, et ces hommes portaient des épées en fer.
Les navigateurs avaient traversé ce qui est aujourd’hui la mer Baltique à bord de longs bateaux en planches, élancés, d’environ 20 mètres de long. Les planches étaient cousues entre elles, car les bateaux de l’époque n’utilisaient pas de clous en métal, et les joints étaient calfatés, c’est-à-dire rendus étanches, à l’aide de goudron.
À un moment du voyage, ils se sont arrêtés pour réparer leurs embarcations. L’un d’eux a laissé une empreinte digitale partielle dans le matériau de calfatage encore tendre, fraîchement appliqué entre les jointures des planches. Ce guerrier de la mer – dont l’âge et le genre nous sont inconnus – laissait sans le savoir un message à destination de scientifiques (dont moi) qui, plus de deux millénaires plus tard, allaient enfin évaluer la portée de cette empreinte digitale grâce aux technologies les plus avancées.
Sauvé par la tourbière
La petite armée préparait une attaque amphibie éclair contre ses ennemis au Danemark – mais leurs plans échouèrent. Peu après avoir débarqué sur la plage, ces guerriers furent tués par les défenseurs locaux. Pour remercier les dieux de leur victoire sur ces envahisseurs, les habitants remplirent l’un des bateaux des armes des assaillants, puis l’immergèrent dans une tourbière locale en guise d’offrande. Le choix d’avoir coulé l’embarcation dans la tourbière a permis aux archéologues de reconstituer peu à peu les indices entourant cette attaque, ainsi que de mieux comprendre la technologie et la société de ces populations anciennes.
Aujourd’hui, cette tourbière insulaire du sud du Danemark est connue sous le nom de tourbière de Hjortspring. À la fin du XIXᵉ siècle, les vestiges du bateau antique y furent découverts, remarquablement bien conservés grâce à l’environnement pauvre en oxygène. Mais comme à l’époque, la région venait d’être conquise par la Prusse et faisait partie de l’Empire allemand, les Danois qui mirent au jour l’embarcation gardèrent leur découverte secrète jusqu’au retour de l’île d’Als dans le giron du Danemark, en 1920.
Le bateau fut finalement mis au jour en 1921 et est depuis lors exposé au Musée national du Danemark à Copenhague. La fouille des années 1920 avait mobilisé les meilleures méthodes archéologiques disponibles – mais les outils scientifiques de l’archéologie moderne n’existaient pas encore.
En 2023, des chercheurs de l’université de Lund et de l’université de Göteborg ont entamé une collaboration avec le musée national afin d’appliquer des méthodes scientifiques contemporaines à l’étude des matériaux extraits de la tourbière plus d’un siècle auparavant. Certains de ces échantillons n’avaient jamais été analysés depuis la fouille initiale – si bien qu’un grand mystère entourait le bateau de Hjortspring depuis toujours : d’où venaient ces guerriers envahisseurs du IVᵉ siècle avant notre ère ?
Un résultat surprenant
Les armes – épées, lances et autres – découvertes à bord du bateau étaient largement utilisées dans toute l’Europe du Nord au début de l’âge du fer, et fournissaient donc peu d’indices sur l’origine de l’embarcation. La plupart des archéologues supposaient que le bateau venait d’un lieu proche, dans le Jutland, ou peut-être du nord de l’Allemagne.
En analysant le matériau de calfatage du bateau grâce à une technique de pointe, la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, nous avons pu identifier précisément la composition chimique des goudrons utilisés : un mélange de graisse animale et de poix de pin.
Ce résultat était surprenant, car la quasi-totalité des forêts de pins du Danemark et du nord de l’Allemagne avaient déjà été abattues dès le Néolithique pour faire place à l’agriculture. Nous le savons grâce aux travaux des géologues, qui ont analysé les pollens anciens présents dans les lacs et les tourbières afin d’identifier les espèces végétales ayant poussé dans différentes régions d’Europe et à différentes périodes.
Si les constructeurs du bateau de Hjortspring ont pu se procurer du goudron par le commerce, il existait à l’époque, dans le Jutland, des solutions locales pour imperméabiliser les embarcations, comme l’huile de lin ou le suif (graisse bovine). Ainsi, notre enquête suggère que le bateau de Hjortspring ne provenait probablement ni du Jutland ni du nord de l’Allemagne, mais plutôt d’une région plus éloignée disposant d’abondantes forêts de pins.

Boel Bengtsson, CC BY-NC-SA
Au IVᵉ siècle avant notre ère, les grandes forêts de pins les plus proches se situaient le long des côtes de la mer Baltique, à l’est du Danemark actuel. Cela signifie que l’équipage du bateau de Hjortspring, ainsi que leurs compagnons d’aventure, ont peut-être parcouru des centaines de kilomètres en pleine mer avant de lancer leur attaque sur l’île d’Als.
On savait déjà que de tels voyages au long cours existaient à l’âge du bronze, lorsque des Scandinaves s’éloignaient considérablement de leurs terres à la recherche de cuivre. Le fer, en revanche, était produit localement en Scandinavie, ce qui rendit le besoin économique de telles expéditions moins évident à l’âge du fer.
Néanmoins, nos résultats indiquent que les échanges commerciaux et les raids à longue distance se sont poursuivis bien après la fin de l’âge du bronze. Si l’on ne saura jamais exactement ce qui a poussé ces guerriers à lancer cette attaque précise, nos travaux suggèrent qu’à l’époque déjà – comme aujourd’hui – les conflits politiques dépassaient les frontières régionales et incitaient de jeunes combattants à s’aventurer loin de chez eux.
Nous avons également pu dater au carbone 14 certaines cordes en liber de tilleul utilisées sur le bateau, fournissant ainsi la première datation absolue issue du matériel de la fouille d’origine. Ces cordages ont été datés entre 381 et 161 avant notre ère, confirmant que l’embarcation appartenait à l’âge du fer préromain.
La piste de l’ADN
Au moment de choisir les échantillons de goudron pour nos analyses, une autre découverte spectaculaire s’est imposée : le « message secret » laissé par l’un des membres de l’équipage, une empreinte digitale partielle imprimée par un marin dans un petit amas de goudron.

Knut Valbjørn/Boel Bengtsson, CC BY-NC-SA
Grâce à la tomographie aux rayons X, nous avons réalisé un modèle numérique tridimensionnel de cette empreinte digitale, avec une précision allant jusqu’à l’échelle du nanomètre. L’analyse de l’empreinte indique qu’elle a été laissée par un adulte, même si nous ne pouvons, pour l’instant, en dire beaucoup plus sur l’identité de cet individu. Cette découverte fascinante nous offre un lien direct avec ce guerrier antique qui a autrefois traversé la mer Baltique.
Au cours de l’année à venir, nous espérons pouvoir extraire de l’ADN ancien à partir du goudron de calfatage du bateau, ce qui pourrait nous fournir des informations plus détaillées sur les populations qui l’ont utilisé.
À ce stade, nos résultats montrent que les pratiques de commerce maritime et de raids à longue distance, qui caractériseront plus tard la célèbre époque viking, se sont inscrites dans près de 3 000 ans d’histoire nordique. L’étude de ce bateau ancien nous permet ainsi de plonger plus profondément dans les origines de la Scandinavie en tant que société maritime.
![]()
Mikael Fauvelle a reçu un soutien financier pour ces travaux de la Marcus and Amalia Wallenberg Foundation (projet Complex Canoes) ainsi que du Riksbankens Jubileumsfond (programme Maritime Encounters).
– ref. Comment les scientifiques ont percé les secrets du plus ancien bateau en planches du Danemark – https://theconversation.com/comment-les-scientifiques-ont-perce-les-secrets-du-plus-ancien-bateau-en-planches-du-danemark-272355