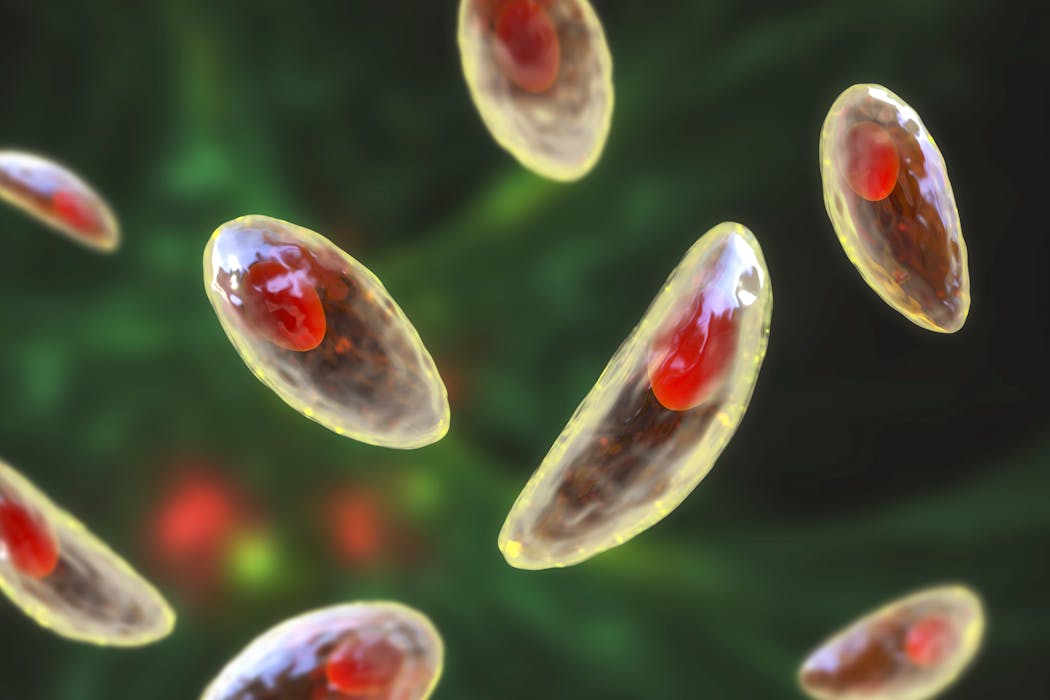Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ludovic Slimak, Archéologue, penseur et chercheur au CNRS, Université de Toulouse

Es 16 de junio de 1951. El explorador francés Jean Malaurie avanza en trineos tirados por perros por la costa noroeste de Groenlandia. Había llegado solo, de forma impulsiva, con unos escasos ahorros del CNRS, oficialmente para trabajar en los paisajes periglaciales. En realidad, este encuentro con pueblos cuya relación con el mundo era de otra naturaleza forjaría un destino singular.
Ese día, tras largos meses de aislamiento entre los inuit, en el momento crítico del deshielo, Malaurie avanza con algunos cazadores. Está agotado, sucio, demacrado. Uno de los inuit le toca el hombro: “Takou, mira”. Una espesa nube amarilla se eleva hacia el cielo. A través del catalejo, Malaurie cree al principio que se trata de un espejismo: “una ciudad de hangares y tiendas de campaña, de chapas y aluminio, deslumbrante bajo el sol entre el humo y el polvo […] Hace tres meses, el valle estaba tranquilo y desierto. Había plantado mi tienda, un día claro del verano pasado, en una tundra virgen y llena de flores”.
El aliento de esta nueva ciudad, escribirá, “no nos abandonará jamás”. Las excavadoras tentaculares raspan la tierra, los camiones vomitan los escombros al mar, los aviones dan vueltas. Malaurie es proyectado de la edad de piedra a la era atómica. Acaba de descubrir la base secreta estadounidense de Thule, cuyo nombre en clave es Operación Blue Jay, uno de los proyectos de construcción militar más ambiciosos y rápidos de la historia de los Estados Unidos.

U.S. Army, The Big Picture — Operation Blue Jay (1953), CC BY
Tras este nombre anodino se esconde una logística faraónica. Estados Unidos teme un ataque nuclear soviético por la ruta polar. En un solo verano, unos 120 barcos y 12 000 hombres se han movilizado en una bahía que hasta entonces solo había conocido el silencioso deslizamiento de los kayaks. Groenlandia contaba entonces con unos 23 000 habitantes. En 104 días, sobre un suelo permanentemente helado, surge una ciudad tecnológica capaz de albergar los gigantescos bombarderos B-36, portadores de ojivas nucleares.
A más de 1 200 kilómetros al norte del círculo polar ártico, en un secreto casi total, Estados Unidos acaba de levantar una de las bases militares más grandes jamás construidas fuera de su territorio continental. En la primavera de 1951 se había firmado un acuerdo de defensa con Dinamarca, pero la base de Thule ya estaba en marcha: la decisión estadounidense se había tomado en 1950.
La anexión del universo inuit
Malaurie comprende inmediatamente que la desmesura de la operación supone, de hecho, una anexión del universo inuit. Un mundo basado en la velocidad, la máquina y la acumulación acaba de penetrar de forma brutal y ciega en un espacio regido por la tradición, el ciclo, la caza y la espera.
El arrendajo azul (“Blue Jay” en inglés) es un pájaro ruidoso, agresivo y extremadamente territorial. La base de Thule se encuentra a medio camino entre Washington y Moscú por la ruta polar. En la era de los misiles hipersónicos intercontinentales, ayer soviéticos, hoy rusos, es esta misma geografía la que sigue sustentando el argumento de la “necesidad imperiosa” invocado por Donald Trump en su deseo de anexionar Groenlandia.

U.S. Army, The Big Picture — Operation Blue Jay (1953), CC BY
El resultado inmediato más trágico de la Operación Blue Jay no fue militar, sino humano. En 1953, para asegurar el perímetro de la base y sus radares, las autoridades decidieron trasladar a toda la población inughuit local a Qaanaaq, a unos cien kilómetros más al norte. El traslado fue rápido, forzado y sin consulta, rompiendo el vínculo orgánico entre este pueblo y sus territorios ancestrales de caza. Un “pueblo raíz” desarraigado para dar paso a una pista de aterrizaje.
Es en este momento de cambio radical donde Malaurie sitúa el colapso de las sociedades tradicionales inuit, en las que la caza no es una técnica de supervivencia, sino un principio organizador del mundo social. El universo inuit es una economía del sentido, hecha de relaciones, gestos y transmisiones, que dan a cada uno reconocimiento, papel y lugar. Esta coherencia íntima, que constituye la fuerza de estas sociedades, también las hace extremadamente vulnerables cuando un sistema externo destruye repentinamente sus fundamentos territoriales y simbólicos.
Consecuencias del colapso de las estructuras tradicionales
Hoy en día, la sociedad groenlandesa está ampliamente urbanizada. Más de un tercio de los 56 500 habitantes vive en Nuuk, la capital, y casi toda la población reside ahora en ciudades y localidades costeras sedentarizadas. El hábitat refleja esta transición brutal.
En las grandes ciudades, una parte importante de la población ocupa edificios colectivos de hormigón, muchos de ellos construidos en los años sesenta y setenta, a menudo vetustos y superpoblados. La economía se basa en gran medida en la pesca industrial orientada a la exportación. La caza y la pesca de subsistencia persisten. Las armas modernas, los GPS, las motos de nieve y las conexiones por satélite acompañan ahora a las antiguas costumbres. La caza sigue siendo un referente identitario, pero ya no estructura la economía ni la transmisión.
Las consecuencias humanas de esta ruptura son enormes. Groenlandia presenta hoy en día una de las tasas de suicidio más altas del mundo, especialmente entre los jóvenes inuit. Los indicadores sociales contemporáneos de Groenlandia –tasa de suicidio, alcoholismo, violencia intrafamiliar– están ampliamente documentados. Numerosos trabajos los relacionan con la rapidez de las transformaciones sociales, la sedentarización y la ruptura de las transmisiones tradicionales.

U.S. Army, The Big Picture — Operation Blue Jay (1953), CC BY
Volvamos a Thule. El inmenso proyecto secreto iniciado a principios de la década de 1950 no tiene nada de provisional. Radares, pistas, torres de radio, hospital: Thule se convierte en una ciudad totalmente estratégica. Para Malaurie, el hombre del arpón está condenado. No por una falta moral, sino por una colisión de sistemas. Advierte contra una europeización que no sería más que una civilización de chapa esmaltada, materialmente cómoda, pero humanamente empobrecida.
El peligro no reside en la irrupción de la modernidad, sino en la llegada, sin transición, de una modernidad sin interioridad, que opera en tierras habitadas como si fueran vírgenes, repitiendo, cinco siglos después, la historia colonial de América.
Espacios y contaminaciones radiactivas
El 21 de enero de 1968, esta lógica alcanza un punto de no retorno. Un bombardero B-52G de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comprometido en una misión permanente de alerta nuclear del dispositivo Chrome Dome, se estrella en el hielo marino a unos diez kilómetros de Thule. Transportaba cuatro bombas termonucleares. Los explosivos convencionales de las bombas nucleares, destinados a iniciar la reacción, detonaron con el impacto. No se produjo una explosión nuclear, pero la deflagración dispersó plutonio, uranio, americio y tritio por una amplia zona.
En los días siguientes, Washington y Copenhague lanzan el Proyecto Crested Ice, una vasta operación de recuperación y descontaminación antes del deshielo primaveral. Se movilizan unos 1 500 trabajadores daneses para raspar el hielo y recoger la nieve contaminada. Varias décadas más tarde muchos de ellos iniciarán procedimientos judiciales, alegando que trabajaron sin la información ni la protección adecuadas. Estos litigios se prolongarán hasta 2018-2019, dando lugar a indemnizaciones políticas limitadas, sin reconocimiento jurídico de responsabilidad. Nunca se llevará a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva entre las poblaciones inuit locales.
Hoy rebautizada como Pituffik Space Base, la antigua base de Thule es uno de los principales nodos estratégicos del dispositivo militar estadounidense. Integrada en la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, desempeña un papel central en la alerta antimisiles y la vigilancia espacial en el Ártico, bajo un régimen de máxima seguridad. No es un vestigio de la Guerra Fría, sino un eje activo de la geopolítica contemporánea.
En Los esquimales del Polo: los últimos reyes de Thule, Malaurie muestra que los pueblos indígenas nunca tienen cabida en las consideraciones estratégicas occidentales. Ante las grandes maniobras del mundo, la existencia de los inuit se vuelve tan periférica como la de las focas o las mariposas.
Las declaraciones de Donald Trump no dan lugar a un mundo nuevo. Su objetivo es generalizar en Groenlandia un sistema que lleva setenta y cinco años en vigor. Pero la postura de un hombre no nos exime de nuestras responsabilidades colectivas. Escuchar hoy que Groenlandia “pertenece” a Dinamarca y depende de la OTAN, sin siquiera mencionar a los inuit, equivale a repetir un viejo gesto colonial: concebir los territorios borrando a quienes los habitan.
Los inuit siguen siendo invisibles e inaudibles. Nuestras sociedades siguen representándose a sí mismas como adultos frente a poblaciones indígenas infantilizadas. Sus conocimientos, sus valores y sus costumbres quedan relegados a variables secundarias. La diferencia no entra en las categorías a partir de las cuales nuestras sociedades saben actuar.
Siguiendo a Jean Malaurie, mis investigaciones abordan lo humano desde sus márgenes. Ya se trate de sociedades de cazadores-recolectores o de lo que queda de los neandertales, cuando los despojamos de nuestras proyecciones, el Otro sigue siendo el ángulo muerto de nuestra mirada. No sabemos ver cómo se derrumban mundos enteros cuando la diferencia deja de ser pensable.
Malaurie concluía su primer capítulo sobre Thulé con estas palabras:
“No se habrá previsto nada para imaginar el futuro con altura”.
Por encima de todo, hay que temer no la desaparición brutal de un pueblo, sino su relegación silenciosa y radical a un mundo que habla de él sin mirarlo ni escucharlo nunca.
![]()
Ludovic Slimak no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Groenlandia: colocarse de parte de los inuit – https://theconversation.com/groenlandia-colocarse-de-parte-de-los-inuit-273258