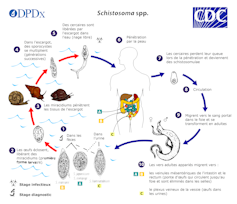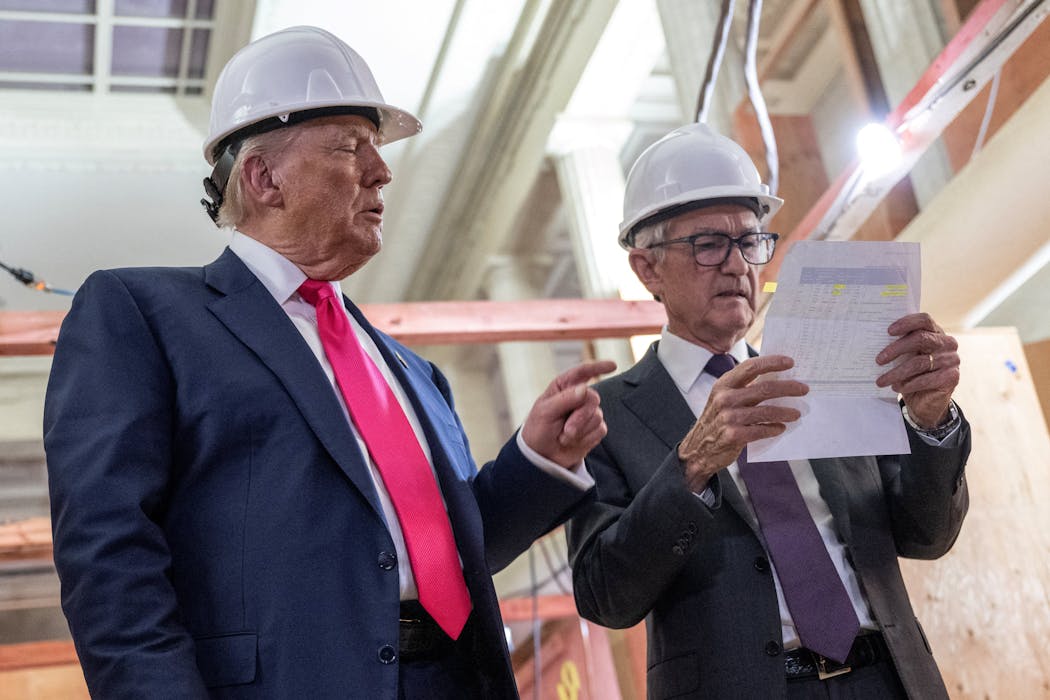Source: The Conversation – in French – By Olivia Roth-Delgado, Cheffe de projets scientifiques, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
Troubles anxiodépressifs et pensées suicidaires, cyberharcèlement, image de soi dégradée, consommation d’alcool, de cannabis et autres substances psychoactives… les réseaux sociaux exploitent les vulnérabilités des jeunes et contribuent ainsi à amplifier certains troubles dont ces derniers sont victimes.
C’est ce que conclut un rapport d’envergure de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) qui décortique les mécanismes d’action de ces outils numériques paramétrés pour cibler à des fins mercantiles les spécificités mais aussi les fragilités liées à l’adolescence.
Olivia Roth-Delgado et Thomas Bayeux font partie de l’équipe de l’Anses qui a coordonné ces travaux. Ils nous présentent les principaux enseignements de ce rapport.
The Conversation : Le rapport de l’Anses relatif aux « effets de l’usage des réseaux sociaux numériques sur la santé des adolescents » est inédit. Pourquoi ?
Olivia Roth-Delgado : Cette expertise, c’est cinq ans de travail et plus de 1 000 articles analysés. Elle est inédite par son originalité et par son ampleur qui sont sans équivalent, à notre connaissance, pour des instances publiques comme l’Anses.
Pour la première fois, ce sont certains mécanismes de conception des réseaux sociaux qui ont été mis en relation avec des effets sur la santé des adolescents. Ces mécanismes, ce sont les dark patterns en anglais – que nous avons traduits par « interfaces trompeuses ».
L’adolescence est une période de vulnérabilité, car le cerveau est encore en maturation. Les adolescents et adolescentes traversent des changements dans la façon dont ils ressentent et gèrent les émotions, et dans les circuits liés à la récompense. Ils sont aussi plus sensibles au contexte social, ce qui peut favoriser des conduites à risque lorsqu’ils sont entourés de leurs pairs. Et c’est également une période de grande vulnérabilité aux troubles psychiques.
Thomas Bayeux : Se développe, durant l’adolescence, une culture qui invite à se confronter à autrui, une appétence pour la communication, une construction de soi qui conduit à tester les normes, etc. Tous ces arguments nous ont amenés à retenir la tranche d’âge 11-17 ans, lors de laquelle s’opèrent tous ces changements.
Le rôle de l’Anses, en tant qu’agence de santé publique, est d’évaluer les risques pour la santé. Toutefois, dans les chapitres du rapport consacrés aux usages et au maintien des relations entre générations, l’expertise évoque les effets bénéfiques potentiels des réseaux sociaux, à travers les motivations qui poussent à les utiliser durant l’adolescence.
Le rapport évoque des effets particulièrement préoccupants en lien avec l’usage des réseaux sociaux à l’adolescence, comme des troubles anxiodépressifs, des pensées suicidaires ou encore de l’automutilation. Quels sont les mécanismes à l’œuvre ?
O. R.-D. : Parmi les mécanismes que nous avons mis en exergue et étudiés, figurent ces interfaces trompeuses (ou manipulatrices) ainsi que les algorithmes de personnalisation de contenus. Tous correspondent à des mécanismes de captation de l’attention qui retiennent les utilisatrices et utilisateurs sur le réseau social, en leur présentant des contenus de plus en plus ciblés, voire extrêmes.
Si un ou une adolescente a, par exemple, recherché une première fois du contenu sur l’automutilation, ce type de contenus va lui être présenté de manière répétée et peut l’enfermer dans une spirale de difficultés.
T. B. : La captation de l’attention sert le modèle économique sur lequel reposent ces plateformes numériques. Cela leur permet de disposer d’un nombre important de données et de les monétiser et concourt également à la vente d’espaces publicitaires.
Les plateformes numériques ont donc intérêt à ce que les personnes restent sur le réseau social grâce aux deux stratégies que nous avons évoquées : d’une part, la personnalisation des contenus au travers d’algorithmes de plus en plus performants qui enferment celles et ceux qui les utilisent dans une boucle d’informations et, d’autre part, via la mise en avant des contenus les plus impactants.
Les interfaces trompeuses (dark patterns) mobilisent des techniques que nous connaissons tous : les likes, les notifications, le scroll infini, les vidéos qui s’enchaînent de manière automatique, etc.
La période de l’adolescence entre en forte résonance avec ces stratégies mises en place par les réseaux sociaux. À l’Anses, nous voyons là des enjeux majeurs en matière de santé publique, car une offre et une demande se rencontrent en quelque sorte. Et le cocktail peut se révéler détonnant !
Concernant ces troubles liés à la santé mentale, mais aussi le harcèlement, la consommation d’alcool, de tabac, de cannabis et d’autres comportements à risque contre lesquels vous alertez, est-ce à dire que les réseaux sociaux amplifient des phénomènes préexistants ?
O. R.-D. : Tout à fait. Les réseaux sociaux sont un espace social. Ils agissent comme une caisse de résonance des problèmes présents dans la société, à l’image des stéréotypes de genre, de l’incitation à la prise de drogues, etc.
T. B. : Les réseaux sociaux participent à la socialisation et à la construction adolescente, ils constituent une continuité du monde hors ligne, avec ses points positifs et ses travers. Il n’existe pas de barrière étanche entre ce qui se passe hors ligne et sur les réseaux sociaux.
Les règles qui existent pour protéger les mineur·es dans la société devraient donc s’exercer également sur les réseaux sociaux ?
O. R.-D. : C’est le principe fondateur du Digital Services Act, le dispositif réglementaire européen qui vise à réguler les contenus en ligne des très grandes plateformes, selon la formule : « Ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. »
T. B. : Cette préoccupation motive l’une des recommandations phares du rapport de l’Anses, à savoir que les moins de 18 ans ne puissent accéder qu’à des réseaux sociaux conçus et paramétrés pour protéger les mineurs. Notre propos n’est pas de les bannir. Mais des solutions techniques doivent être engagées pour que les réseaux sociaux soient des lieux sûrs pour les adolescents et adolescentes, et l’Anses insiste pour une responsabilisation des plateformes à cet égard.
Ensuite, pour un adolescent ou une adolescente, discuter de ses pratiques numériques avec autrui – ses pairs, ses parents, des membres du corps enseignant, des éducateurs… – peut se révéler vertueux. Cela ne dédouane pas les pouvoirs publics et les plateformes numériques d’adopter des stratégies à une échelle collective pour que les réseaux sociaux soient des espaces sûrs pour les adolescents et adolescentes.
Le rapport évoque des liens entre l’utilisation des réseaux sociaux et certains troubles, mais il n’établit pas de relation de causalité à proprement parler. Pourquoi ?
O. R.-D. : La question de la causalité reste compliquée. Nous nous appuyons sur une expertise très fournie et documentée. Notre méthodologie est solide, mais elle ne repose pas sur une méthode du poids des preuves. Néanmoins, nous montrons des associations robustes entre l’usage des réseaux sociaux et les troubles que nous avons évoqués et pour lesquelles nous mettons au jour les mécanismes sous-jacents de manière extrêmement pertinente.
Dans le cas du sommeil, par exemple, plusieurs mécanismes jouent. Quand les adolescents consultent les réseaux sociaux le soir avant de se coucher, la lumière bleue des écrans entraîne un retard d’endormissement, car elle stimule ce qu’on appelle un éveil cognitif, ce qui raccourcit la durée de leur sommeil. Or, les effets à long terme sur la santé physique et mentale d’un manque chronique de sommeil sont bien documentés. De plus, quand on consulte des réseaux sociaux, des stimuli émotionnels peuvent aussi empêcher de dormir. On le voit, il existe un faisceau de preuves. Mais les effets concrets des réseaux sociaux sur le sommeil d’un adolescent ou d’une adolescente dépendent aussi de ses usages.
De même, dans la survenue des troubles anxiodépressifs ou d’idées suicidaires, la nature des contenus proposés joue un rôle majeur. On doit également prendre en compte un effet bidirectionnel. Je m’explique : un adolescent ou une adolescente qui est déjà vulnérable psychologiquement aura tendance à consulter davantage les réseaux sociaux. L’algorithme de présentation de contenus va détecter cette fragilité émotionnelle et lui présenter des contenus chargés sur le plan émotionnel. Et c’est là qu’il ou elle va se retrouver enfermé·e dans une spirale délétère. Il est plus difficile d’affirmer une causalité en présence de boucles de rétroaction et d’effets bidirectionnels.
Enfin, sur l’altération de l’image de soi, nous disposons également d’un faisceau convaincant de preuves selon le même type de mécanismes fondés sur une exposition répétée à des contenus valorisant des femmes maigres et des hommes musclés.
Les filles apparaissent plus sensibles que les garçons aux effets négatifs des réseaux sociaux. Comment l’expliquer ?
T. B. : C’est l’un des enseignements majeurs de cette expertise. Les filles représentent clairement un groupe à risque sur les réseaux concernant tous les effets sur la santé, pas uniquement l’altération de l’image de soi. Elles sont plus présentes sur les réseaux sociaux que les garçons, y sont davantage harcelées, victimes de stéréotypes de genre, soumises à des pressions sociales… Les filles accordent également davantage d’importance à ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux, aux commentaires qui y sont postés, etc.
Les communautés LGBTQIA+ représentent aussi un groupe à risque sur les réseaux sociaux. Elles sont notamment davantage victimes de cyberharcèlement dont découlent des risques, notamment en matière de santé mentale.
Le rapport de l’Anses relève le fait que le temps passé devant les réseaux sociaux n’est pas le seul critère à prendre en compte.
T. B. : Le temps d’utilisation constitue une mesure utile, mais qui ne suffit pas pour aborder pleinement le sujet. Le temps permet d’étudier certains enjeux de santé, comme la sédentarité, même si les outils numériques nomades se multiplient pour accéder aux réseaux sociaux. Quantifier la durée d’utilisation se révèle également précieux quand on parle d’expositions tardives susceptibles d’impacter le sommeil, par exemple.
En revanche, on sait aussi que la compréhension des usages est essentielle pour étudier certains effets sur la santé. Il est important de savoir ce qui est fait sur le réseau social : publier, liker, lire des commentaires, faire des retouches photos, par exemple, et quel engagement émotionnel est associé à ces pratiques. Il ne faut pas opposer les approches mais plutôt y voir une complémentarité.
Votre rapport s’appuie sur des travaux de recherche qui n’ont pas, ou peu, étudié l’impact des outils numériques les plus récents, comme TikTok ou les « compagnons IA ». Peut-on supposer que ces nouvelles technologies accroissent les risques pour la santé mentale des adolescentes et adolescents ?
O. R.-D. : L’expertise de l’Anses s’est appuyée sur plus d’un millier d’articles publiés majoritairement entre 2011 et 2021. Du fait du cumul entre le temps de la recherche et celui de l’expertise, nous avons été amenés à étudier des technologies qui ont effectivement évolué. Néanmoins, nous nous sommes basés sur un socle commun de mécanismes, comme les interfaces trompeuses (dark patterns) et les algorithmes de personnalisation de contenus, auxquels nous avons associé des effets sur la santé.
Donc nos conclusions comme nos recommandations peuvent s’étendre à des réseaux sociaux plus récents. En ce qui concerne l’intelligence artificielle et les « compagnons IA », l’Anses recommande que des expertises futures se penchent sur la question.
Dans vos recommandations, vous proposez d’associer les adolescentes et les adolescents aux programmes développés pour prévenir les risques.
O. R.-D. : L’Anses propose d’associer les jeunes eux-mêmes aux travaux, car ce sont eux qui connaissent leurs motivations à aller sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui construisent et diffusent les nouvelles pratiques. Il nous paraît donc important de les inclure dans les dialogues et la construction des repères, avec les éducateurs et les parents. Ils seront plus enclins à respecter des règles qu’ils auront contribué à formuler. Parmi ses recommandations, l’Anses évoque également le fait de promouvoir des espaces de dialogue entre jeunes pour des retours d’expérience de ce qui leur arrive en ligne.
T. B. : Et encore une fois, nous rappelons que l’Anses ne recommande pas d’interdire les réseaux sociaux, mais de revoir en profondeur leur conception de manière à ce qu’ils ne nuisent pas à la santé des adolescents et les adolescentes.
Propos recueillis par Lionel Cavicchioli et Victoire N’Sondé.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Santé mentale des adolescents : les réseaux sociaux amplifient les troubles observés hors ligne, en particulier chez les filles – https://theconversation.com/sante-mentale-des-adolescents-les-reseaux-sociaux-amplifient-les-troubles-observes-hors-ligne-en-particulier-chez-les-filles-273116
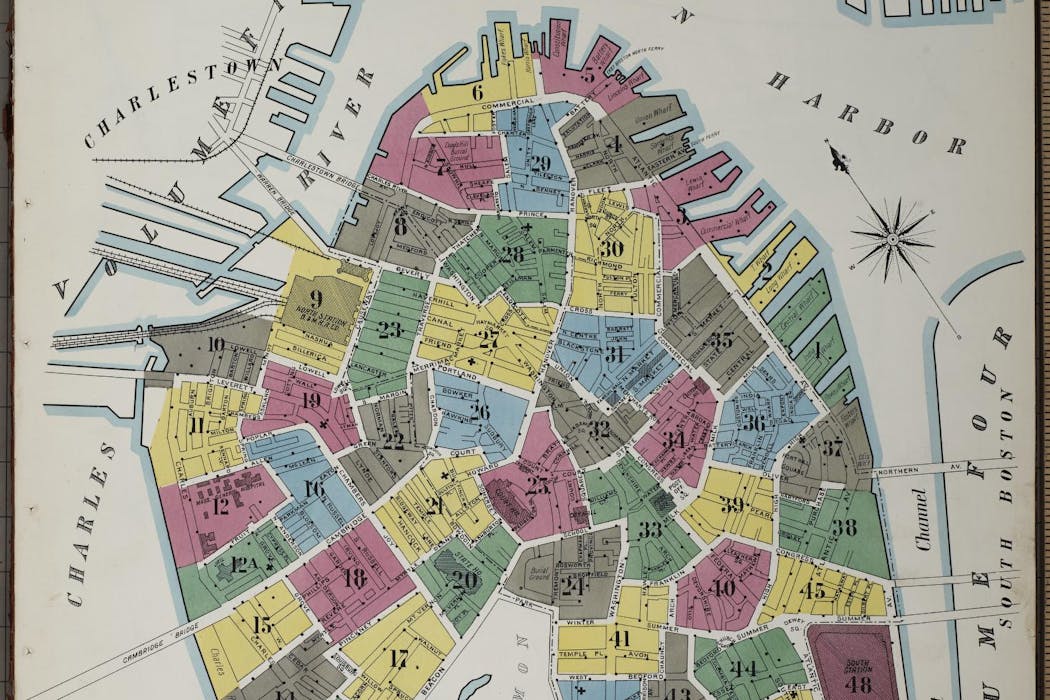


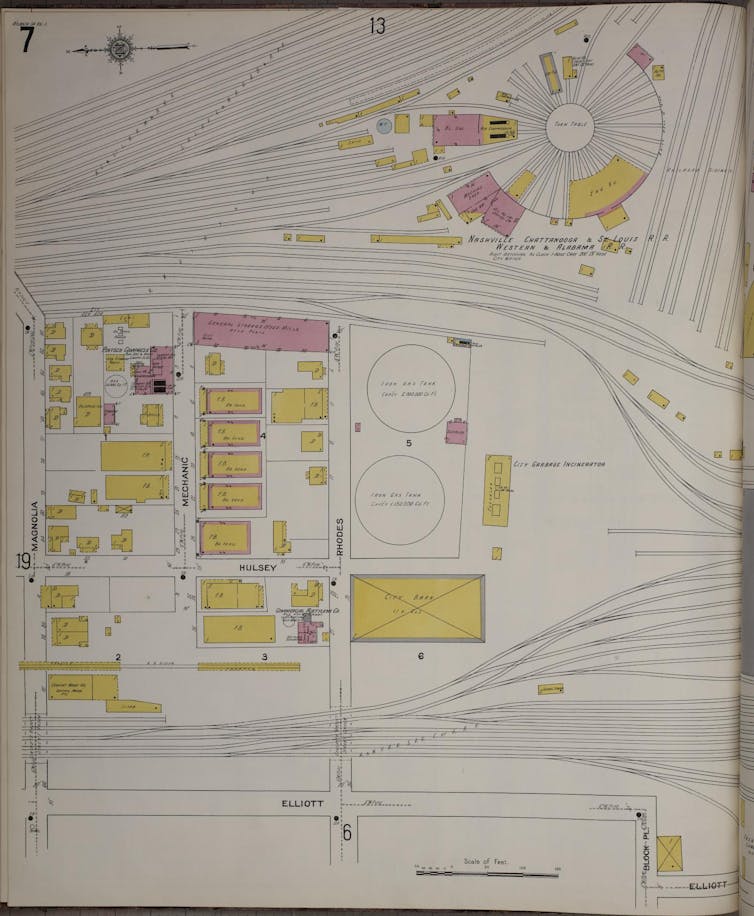
![]()