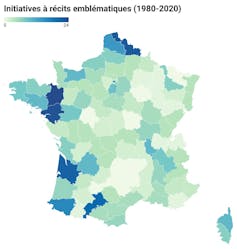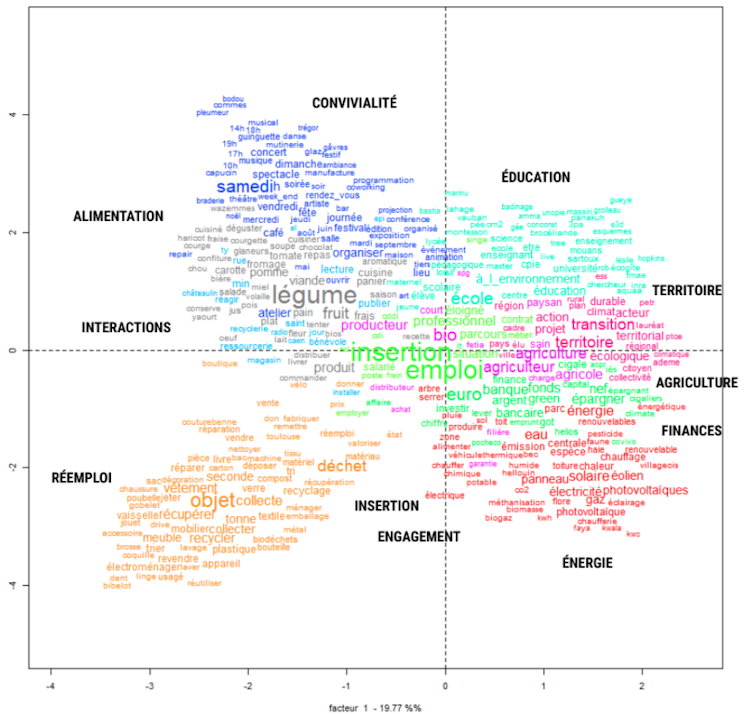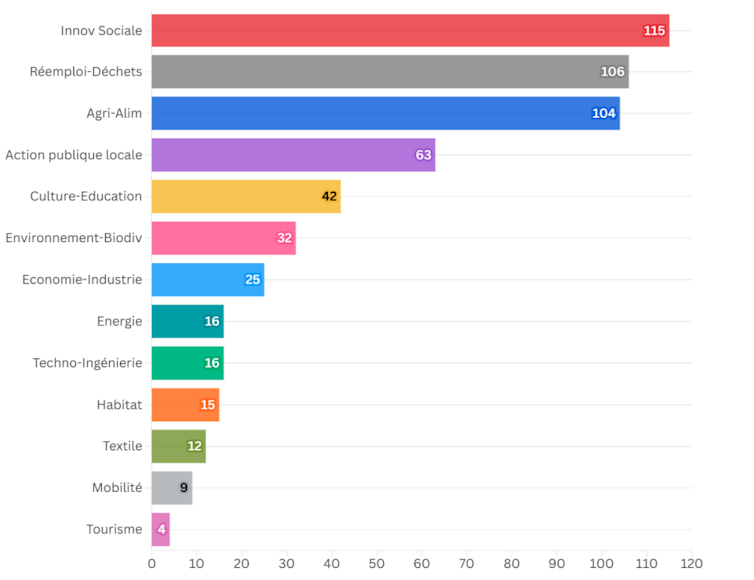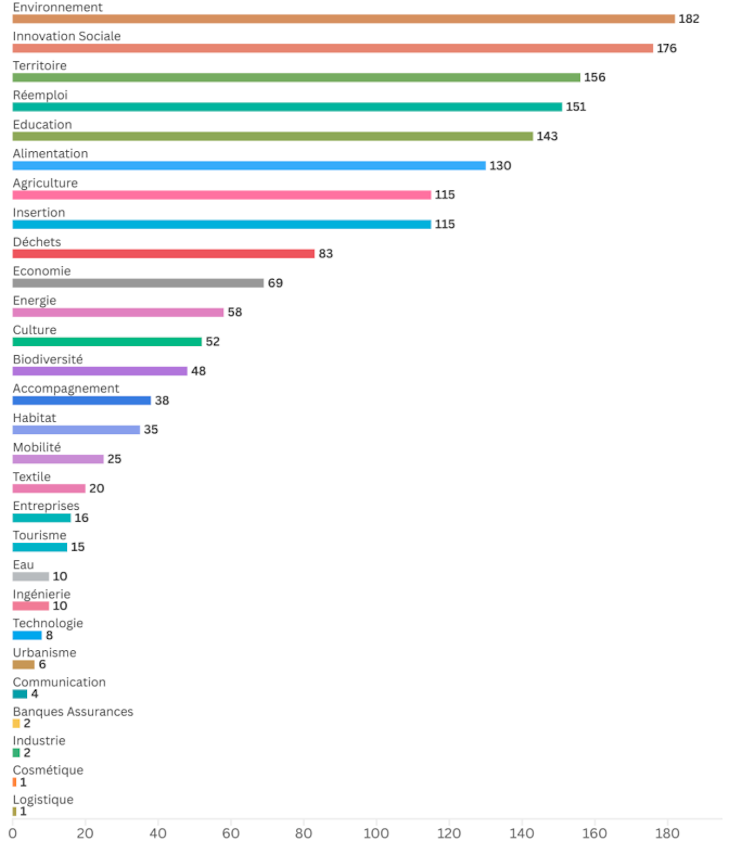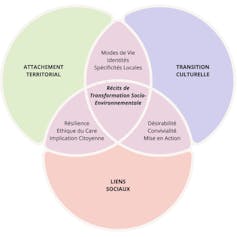Source: The Conversation – in French – By Leda Stawnychko, Associate Professor of Strategy and Organizational Theory, Mount Royal University
Au début de la nouvelle année, il est naturel de se sentir partagé entre la gratitude et l’envie de changement. Le mois de décembre modifie souvent nos habitudes : moins de réunions, des boîtes courriel moins encombrées et une rare occasion de faire le point et de réfléchir.
Pendant cette période, on peut se réjouir du chemin parcouru, tout en ressentant que la voie suivie n’est plus vraiment la bonne.
Ce malaise est particulièrement fréquent à des étapes de la vie où les professionnels s’attendent à se sentir plus stables, mais ont plutôt l’impression de stagner. Il est facile de rejeter ces sentiments comme de l’impatience ou un manque d’engagement.
Mais les recherches sur l’apprentissage et le développement des adultes suggèrent que se sentir bloqué est souvent un signe de croissance personnelle. C’est la preuve que notre développement interne a dépassé ce que notre environnement immédiat peut offrir.
Dans la recherche en éducation, cette tension est souvent décrite comme un dilemme désorientant : une expérience qui remet en question nos hypothèses et révèle un décalage entre la façon dont nous nous voyons et le contexte dans lequel nous évoluons.
Bien que ces moments soient souvent inconfortables, ils agissent comme des catalyseurs pour l’apprentissage et le changement, incitant à réévaluer vos objectifs, vos valeurs et votre orientation. Vu ainsi, le désir d’un nouveau départ est une réponse normale à votre croissance.
À lire aussi :
Cinq conseils pour trouver ce qui vous apporte vraiment de la joie en dehors du travail
Diagnostiquer la source de l’agitation
Si vous êtes prêt à changer, mais que vous ne savez pas par où commencer, une première étape consiste à clarifier ce qui alimente votre sentiment d’agitation. Est-ce le travail lui-même, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou la culture organisationnelle au sens large ?
Lorsque les organisations sont généralement favorables, la croissance ne nécessite pas forcément de changer d’entreprise. Le changement peut être possible au sein du même environnement. Dans ces cas, les conversations avec les superviseurs peuvent révéler des opportunités qui ne sont pas immédiatement évidentes, telles que des missions ambitieuses, des projets spéciaux ou le soutien à la formation continue.
Les recherches montrent que les personnes qui restent longtemps dans une même entreprise le font souvent en raison de relations solides, d’une bonne adéquation avec leur vie en général et de ce que les chercheurs appellent « l’ancrage professionnel », c’est-à-dire les avantages financiers, sociaux et psychologiques liés à leur poste qui rendent leur départ coûteux.
Mais si rester freine votre progression, il vaut la peine d’explorer soit la possibilité de renégocier votre trajectoire, soit celle de préparer votre départ de manière réfléchie.
Réévaluer ce qui compte aujourd’hui
Que vous envisagiez un changement au sein de votre organisation ou ailleurs, prendre le temps de clarifier vos besoins, vos objectifs et vos valeurs est essentiel. Ce qui comptait pour vous au début de votre carrière n’a peut-être plus la même importance.
Revenu, apprentissage, flexibilité, stabilité et sens de la vie : l’importance de ces facteurs évolue selon les étapes de votre parcours. Identifier vos priorités actuelles ne signifie pas les figer pour toujours, mais simplement avoir une vision claire pour évaluer les opportunités.
Certaines personnes accordent la priorité au mentorat ou à la formation prise en charge par l’employeur. D’autres ont besoin d’horaires prévisibles, d’une bonne couverture santé ou de flexibilité pour s’occuper de leur famille.
Comprendre ce qui compte vraiment pour vous aujourd’hui aide à réduire les options et à éviter la paralysie que provoquent souvent les grandes décisions.
À lire aussi :
Un robot m’a pris mon stage : l’impact de l’IA sur l’entrée des jeunes dans le monde du travail
Se concentrer sur les activités plutôt que sur les titres
Pour y voir plus clair, imaginez votre rôle idéal sans vous arrêter aux titres de poste. Les titres peuvent être trompeurs et masquent souvent la réalité quotidienne du travail.
Concentrez-vous plutôt sur les activités qui occupent la majeure partie de votre temps et sur les compétences que vous utilisez réellement. Une question utile est : que feriez-vous volontiers même sans être rémunéré ? Ces tâches révèlent souvent vos forces et motivations profondes, ce que les psychologues appellent la motivation intrinsèque – le plaisir d’accomplir une tâche simplement parce qu’elle est gratifiante.
Par exemple, au début de ma carrière, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de plaisir à soutenir des professionnels en transition, en période de conflit ou de changement. Avec le temps, j’ai compris que le mentorat et le coaching étaient des activités qui me passionnaient suffisamment pour les exercer même gratuitement.
Fort de cette prise de conscience, j’ai commencé à chercher des postes qui incluaient ces activités, afin de m’assurer que mon travail reste significatif et stimulant.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Se préparer pour la prochaine étape
Une fois vos priorités et intérêts clarifiés, identifiez les compétences et qualifications nécessaires pour les postes qui vous intéressent et commencez à les développer de façon intentionnelle.
Cela peut se faire à faible risque, par exemple à travers des projets dans votre emploi actuel, des activités entrepreneuriales, des emplois secondaires, des missions bénévoles ou des formations ciblées. En prenant régulièrement de petites mesures concrètes, vous réduisez progressivement l’écart entre vos capacités actuelles et ce que requiert votre prochaine étape professionnelle.
En cultivant activement ces compétences, vous transformez une période d’agitation en une phase constructive de préparation et de croissance professionnelle.
Lorsque vous réfléchissez à la suite, utilisez votre réseau de manière stratégique pour poser des questions, apprendre et découvrir des opportunités. Les nouveaux départs se construisent à travers les conversations, les expériences et les choix progressifs.
Enfin, soyez également attentif aux croyances qui limitent vos actions. Les idées que vous vous faites sur ce que vous pouvez faire ou non peuvent restreindre vos options bien plus que vos compétences réelles. Le sentiment d’être bloqué n’est pas un obstacle, mais une invitation à évoluer et le signal que vous pouvez commencer un nouveau chapitre dès aujourd’hui.
![]()
Leda Stawnychko reçoit des financements du CRSH.
– ref. Bloqué au travail en ce début d’année ? C’est peut-être un signe que vous progressez – https://theconversation.com/bloque-au-travail-en-ce-debut-dannee-cest-peut-etre-un-signe-que-vous-progressez-272794