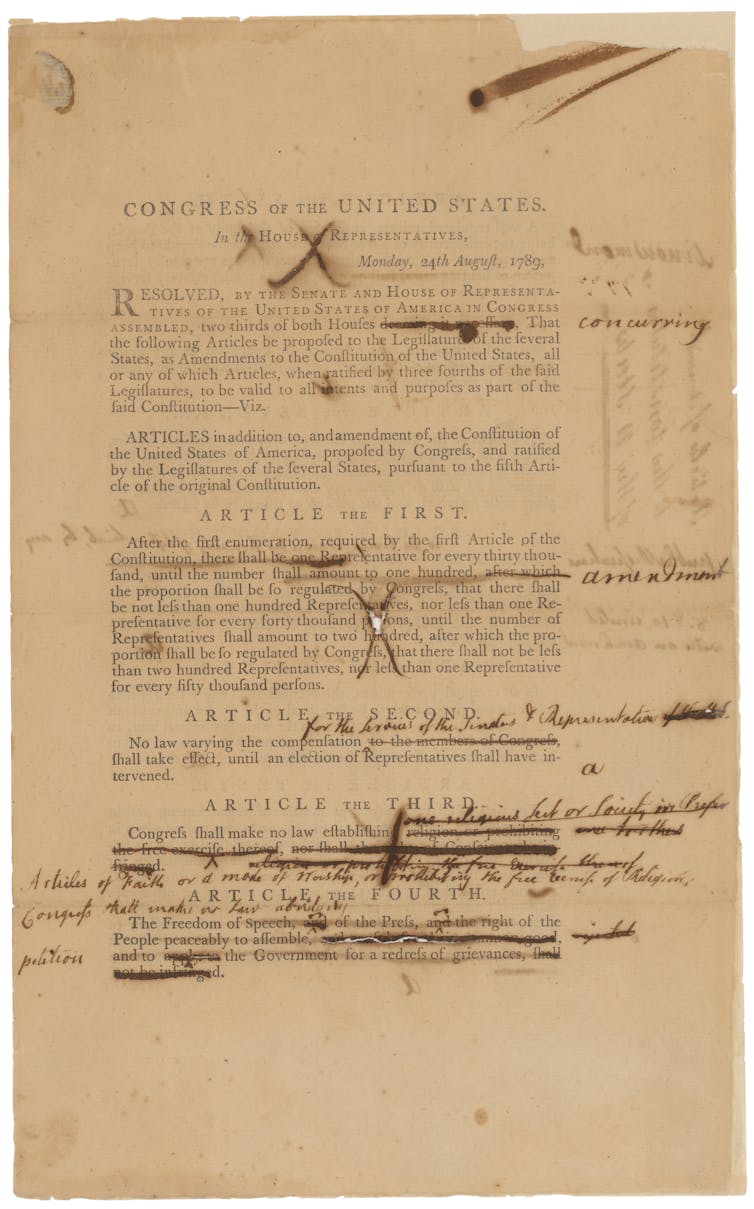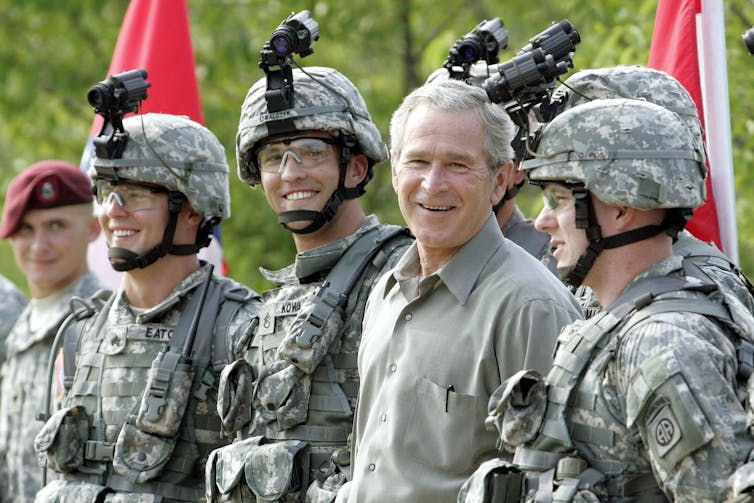Source: The Conversation – France in French (3) – By Mohamad Fadl Harake, Docteur en Sciences de Gestion, Chercheur en Management Public Post-conflit, Université de Poitiers
Après un conflit, une bataille se joue dans les instances gouvernementales. Administrations, écoles, hôpitaux, tribunaux : il est nécessaire de faire fonctionner à nouveau ces lieux où l’État redevient visible et utile. Offrir des services publics équitables et efficaces permet de rétablir la confiance auprès de la population, de prévenir les tensions futures et de consolider une paix durable. Mais comment allier inclusion politique et professionnalisation de l’administration sans exclure ou corrompre le processus ? Cet article explore, exemples à l’appui, les conditions d’un État solide après la guerre.
Au lendemain d’un conflit, la paix ne se gagne pas qu’avec des ponts et des routes. Elle se joue aux guichets : dans les ministères, les centres de santé, les écoles, les tribunaux… Une administration qui délivre, une légitimité qui se reconstruit, des services qui reviennent partout. Comment concilier inclusion politique et professionnalisation de l’État pour une paix durable ?
L’urgence de faire fonctionner l’État… sans sacrifier le long terme
Dans les États sortant de guerre, les caisses sont vides, les talents ont souvent fui, les procédures se sont délitées. Les bailleurs poussent à « livrer vite » des résultats visibles.
Or, les recherches sur les réformes administratives en sortie de conflit montrent que des arbitrages délicats doivent être faits entre rétablissement immédiat des services et consolidation institutionnelle sur la durée (stabiliser la paie, reconstruire les chaînes d’approvisionnement, reprofessionnaliser, etc.).
Les dispositifs parallèles pilotés par des projets internationaux peuvent accélérer la reprise, mais ils siphonnent parfois les compétences et fragilisent les administrations nationales si la passation vers le secteur public n’est pas anticipée.
Le dilemme technocratie–réconciliation
Qui doit tenir les rênes de l’administration rénovée ? Des technocrates indépendants, garants de l’efficacité, ou des représentants des ex-belligérants, garants de l’inclusion ? La plupart des pays naviguent entre ces pôles, avec des effets ambivalents.
En Irak, le système de partage des postes par quotas ethno-confessionnels, la muhasasa, mise en place en 2003, a garanti la représentation des grands groupes, mais il a aussi institutionnalisé le clientélisme et affaibli les incitations au mérite. Les grandes mobilisations de 2019 visaient explicitement ce mécanisme, accusé d’entretenir corruption et services défaillants.
À lire aussi :
Vingt ans après l’invasion américaine, l’Irak peut-il enfin connaître une paix durable ?
Au Liban, les accords de Taëf de 1989 ont mis fin à la guerre civile en reconduisant une répartition confessionnelle du pouvoir. Cette formule a stabilisé la coexistence, mais elle a aussi fortement politisé l’administration et fragmenté les responsabilités, au prix de blocages répétés dans les politiques publiques.
À lire aussi :
Le Liban a enfin un président. Et alors ?
En Bosnie-Herzégovine, l’architecture issue des accords de Dayton en 1995 a garanti l’équilibre entre peuples constitutifs – les Bosniaques, les Serbes et les Croates –, mais créé une gouvernance extrêmement complexe à plusieurs étages où les chevauchements de compétences freinent coordination et réformes. Le dispositif mis en place par les accords de Dayton prévoit en effet la présence d’un haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine, chargé de superviser l’application civile de l’accord de paix. Les diagnostics récents évoquent des dysfonctionnements persistants et des tensions politiques récurrentes qui testent les limites du système.
À Chypre, la division institutionnelle perdure depuis la fin de la guerre en 1974 : deux administrations coexistent de part et d’autre de la ligne verte, une zone démilitarisée gérée par la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP). Toute solution devra articuler bi-communauté et harmonisation administrative. Au sud – la République de Chypre, membre de l’UE depuis 2004 –, les évaluations européennes soulignent toujours un degré de corruption élevé et insistent sur la nécessité de renforcer la redevabilité (accountability) au sommet de l’État.
Légitimité : représenter, protéger, délivrer
Au vu des recherches et études de cas existantes, les recommandations suivantes peuvent être formulées à l’intention des acteurs dans la reconstruction des États sortant de guerre. La légitimité d’un État post-conflit tient à trois choses.
D’abord, représenter : garantir que chaque groupe se retrouve dans les institutions, y compris par des mécanismes transitoires (on peut penser aux quotas ou à l’intégration d’ex-combattants), bornés dans le temps et articulés à des critères professionnels.
Ensuite, protéger : sécurité publique, justice accessible, reconnaissance des victimes.
Enfin, délivrer : l’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation et à l’électricité restaure plus vite la confiance que tout discours. C’est là que la « plomberie » administrative – budgets prévisibles, logistique, achats publics – fait la différence.
Professionnaliser sans aseptiser la politique
La professionnalisation est centrale, mais l’administration ne peut être « hors sol ». Des concours transparents, des parcours de carrière clairs, une formation continue ciblée sur les métiers critiques (par exemple les finances publiques, achats, santé, éducation, justice) permettent de remonter le niveau.
La fiabilisation de la rémunération des agents publics/fonctionnaires (identification, bancarisation, contrôle des doublons) et la structuration d’outils simples (fiches de poste, manuels de procédures, tableaux de bord publics) sécurisent les managers face aux pressions.
Ces chantiers techniques n’ont de sens que s’ils s’accompagnent d’une protection de l’intégrité (via la cartographie des risques, contrôles indépendants, sanctions effectives) et d’un dialogue régulier avec les autorités politiques pour calibrer le rythme des réformes.
Décentraliser, oui, mais avec moyens et redevabilité
Beaucoup de pays misent sur la décentralisation pour rapprocher l’État des citoyens et apaiser les tensions. Le résultat dépend de l’alignement entre compétences transférées, ressources et capacités locales.
Transférer sans financement ni personnels formés produit des coquilles vides ; à l’inverse, une dispersion extrême fige les inégalités territoriales. Les accords État–collectivités doivent préciser qui fait quoi, avec quel budget et comment on rend des comptes.
Services essentiels : des victoires visibles et équitables
La paix perçue se gagne souvent au guichet. Des « victoires rapides » comme la réouverture simultanée de toutes les écoles d’un district (à l’image de la Sierra Leone après la guerre civile – voir le projet de reconstruction scolaire post-conflit ou la réouverture après l’épidémie d’Ebola en 2015 (1,8 million d’élèves sont retournés en classe)), le rétablissement d’un paquet minimal de soins comprenant vaccinations, santé maternelle et médecine primaire (c’est-à-dire des soins de première ligne pour les problèmes courants, la prévention et l’orientation, comme les campagnes nationales de vaccination en Afghanistan ou d’autres interventions nationales) ou encore la sécurisation de l’état civil et de l’identité (mesure décisive au Rwanda après 1994) créent un effet de cliquet.
L’important est d’annoncer des critères d’allocation transparents, de publier des données de performance (par exemple délais d’attente, disponibilité des médicaments, taux de scolarisation) et d’assurer une présence de l’État sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones anciennement contrôlées par des groupes armés.
Le Liberia, par exemple, a tenté de réduire la corruption perçue en rendant publiques les listes de distribution de médicaments essentiels (via la coopération avec des bailleurs et ONG) ; Timor-Leste a recours à la publication des statistiques de scolarisation par district pour rendre visibles ses progrès ; la Colombie via le plan Colombia a aussi essayé d’intégrer des mesures de transparence dans ses programmes de sécurité et développement (avec des dispositifs de suivi pour limiter les abus) ; et dans les zones anciennement contrôlées par les FARC, des « points de services intégrés » (santé, état civil, justice mobile) ont été déployés pour restaurer rapidement la confiance dans les institutions (en complément des efforts de présence institutionnelle de l’État).
Composer avec les institutions « hybrides »
Dans de nombreuses sociétés, des autorités coutumières et religieuses, des comités de quartier ou des ONG enracinées continuent d’arbitrer la vie sociale. Les ignorer fragilise l’appropriation locale.
L’enjeu n’est pas de « folkloriser » la gouvernance, mais d’articuler formel et informel : par exemple, associer des médiateurs reconnus aux comités scolaires ou aux conseils de santé, tout en garantissant des procédures et des recours conformes à l’État de droit.
Plusieurs expériences offrent des points de repère : au Rwanda, les juridictions gacaca, inspirées des tribunaux coutumiers, ont permis de juger plus de deux millions de dossiers liés au génocide, tout en intégrant un encadrement légal.
En Somalie, certains programmes de santé ont fonctionné en partenariat avec les autorités religieuses et les comités de quartier pour assurer l’accès aux cliniques malgré l’absence d’État central.
En Afghanistan – avant le retour des talibans –, l’intégration des conseils locaux (shuras) dans la gestion des écoles communautaires a permis d’augmenter la scolarisation, surtout des filles.
Que peuvent faire les bailleurs ?
Les partenaires internationaux – ONU, Union européenne, agences bilatérales – sont d’un grand secours s’ils privilégient l’investissement dans la capacité de l’État, plutôt que des circuits parallèles, tels que les unités de gestion de projets ad hoc financées par les bailleurs et opérant en marge des ministères, le recours massif aux ONG internationales pour fournir directement les services publics (santé, éducation, eau), ou encore les flux financiers hors budget national (comme le paiement direct des salaires d’enseignants ou de soignants par des agences extérieures, au lieu de passer par les systèmes de paie de l’État).
La France, via l’AFD et l’INSP (ex-ENA) pour la formation des cadres, peut jouer un rôle utile à condition d’inscrire l’appui dans une co-construction avec les ministères.
Plus largement, l’expérience comparée plaide pour des programmes qui, dès le départ, planifient la maintenance, le financement récurrent et la transmission des compétences aux équipes locales.
Plus largement, l’expérience comparée plaide pour des programmes qui, dès le départ, planifient la maintenance, le financement récurrent et la transmission des compétences aux équipes locales. Un exemple souvent cité est celui du secteur de l’eau au Mozambique, où le National Rural Water Supply Program a intégré dès les années 2000 la formation de comités villageois et le financement de l’entretien des pompes à main : après transfert de compétences, plus de 80 % des points d’eau restaient fonctionnels plusieurs années après l’installation.
En guise de boussole
Rebâtir l’État après la guerre est un exercice d’équilibriste. Trop de compromis politiques paralysent l’action publique ; trop de purisme technocratique peut rallumer les griefs.
Les cas de l’Irak, du Liban, de la Bosnie-Herzégovine et de Chypre rappellent qu’on consolide la paix en même temps qu’on améliore l’efficacité : par une professionnalisation progressive, une inclusivité maîtrisée, des services qui fonctionnent partout sur le territoire et une lutte anticorruption crédible. La paix durable est moins un « événement » qu’une routine administrative qui tient, jour après jour.
![]()
Mohamad Fadl Harake ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Reconstruire l’État après la guerre : quels défis pour le management public en contexte post-conflit ? – https://theconversation.com/reconstruire-letat-apres-la-guerre-quels-defis-pour-le-management-public-en-contexte-post-conflit-264832