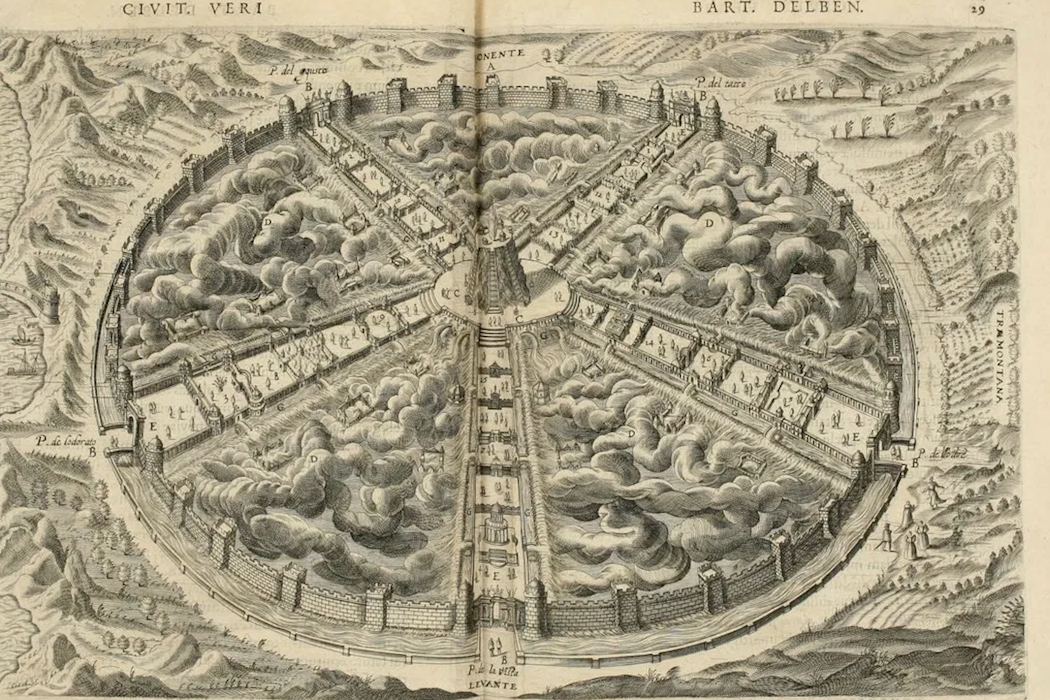Source: The Conversation – in French – By Consuelo Vasquez, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Les débats sur l’immigration qui défraient les manchettes québécoises et internationales abordent fréquemment le sujet à travers les chiffres. Comme tout dossier politique, l’immigration soulève bien entendu des défis logistiques, mais aussi des réalités humaines. Considérant la prévalence d’une approche technique de la question migratoire, nous déplorons le peu de place accordée collectivement aux humains derrière les indices numériques, à leurs parcours, à leurs histoires.
Derrière ces chiffres se trouvent des trajectoires particulières, faites d’espoirs, de ruptures et d’ajustements. C’est ce que nous cherchons à mettre en lumière dans le projet de recherche Entraide dans les marges, à l’Université du Québec à Montréal, qui documente les formes d’entraide émergentes dans des contextes de précarité, comme celui associé à l’immigration.
Pour réintroduire l’humain dans un débat largement dominé par des considérations quantitatives et objectives, nous nous appuyons notamment sur la notion d’escrevivência, qui désigne un acte d’auto-narration politique permettant aux personnes marginalisées de raconter elles-mêmes leur expérience depuis les marges, et ainsi de se réinscrire dans l’histoire.
L’escrevivência se distingue à cet égard de l’autobiographie classique en ce qu’elle porte explicitement une visée politique et collective : elle émane toujours de personnes subalternisées, dont la prise de parole vise à transformer le regard social envers leurs communautés et à revendiquer une place dans l’espace public.
Escrevivência : réhumaniser par l’auto-narration
L’escrevivência, concept forgé par la romancière brésilienne Conceição Evaristo en 1996, désigne l’acte d’« écrire-vivre » : une écriture où la vie devient affirmation politique et production de savoirs. Ancrée dans les traditions afrodiasporiques, elle souligne la mémoire collective, la réappropriation des racines et l’identité communautaire.
Écrire, ici, c’est résister à la « désmémoire » que les récits de ceux en situation de pouvoir imposent lorsqu’ils parlent en notre nom, nous instrumentalisent, ou tout simplement ne parlent jamais de nous. L’écriture vient dans ce contexte transformer la douleur en force créatrice, l’oubli en volonté de se faire entendre.
Née dans les marges, l’escrevivência permet aux sujets historiquement réduits au silence – notamment les femmes noires – de passer de l’objectité à la subjectivité. Par l’auto-narration, elle reconstitue le lien entre corps, mémoire et parole, redonnant humanité à celles et ceux que l’histoire a souvent effacés ou condamnés.
L’écrivaine afro-brésilienne Conceição Evaristo est une figure importante de l’escrevivência. Dans son conte « O espelho opaco de Seni », écrit en portugais et publié en 2022, Evaristo relate l’histoire de Seni, une femme noire incapable d’apercevoir son reflet dans le miroir. Au terme du récit, devant les miroirs dorés de sa petite-fille, elle parvient enfin à se reconnaître avec une clarté ancestrale. En saisissant son propre reflet – celui d’une lignée de femmes noires longtemps déniées – elle transforme l’image en mémoire vivante. Ce geste d’auto-reconnaissance, partagé par sa petite-fille et toutes leurs ascendantes, reconstitue le lien entre corps, temps et parole : un passage de l’objectivité imposée à la subjectivité réaffirmée.

(Wikimedia | Fora do Eixo), CC BY
Dans le contexte migratoire, cette pratique acquiert une portée universelle : raconter devient un acte de guérison et d’émancipation. Les auto-narrations se présentent comme des discours minoritaires assumés, mais revendiquant la possibilité de pouvoir « parler en retour » afin de réinscrire tant l’histoire subjective que collective.
L’escrevivência devient ainsi un geste collectif de reconstruction, un espace pour recréer le monde depuis les marges.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
« Je ne veux pas être traitée comme un numéro » – L’expérience de Cecilia
Parmi les récits oraux recueillis dans le cadre de notre projet Entraide dans les marges, celui de Cecilia (un pseudonyme), arrivée du Mexique il y a deux ans, illustre la portée de l’escrevivência dans le contexte migratoire.
Enseignante de mathématiques dans son pays, mère d’un jeune enfant, elle amorce au Québec une recherche d’emploi qui la confronte à de multiples obstacles linguistiques et administratifs. Elle raconte qu’un premier organisme d’aide lui aurait conseillé, allant à l’encontre des principes interculturalistes québécois, « d’oublier tout ce qu’elle savait », comme si son expérience, sa formation et son identité professionnelle n’avaient plus aucune valeur ici. « Une claque dans la figure », dira-t-elle plus tard
Heureusement, son parcours ne s’arrête pas à cette blessure. Une intervenante, elle-même migrante, puis un enseignant de français dans un centre communautaire – devenu depuis un ami proche – l’ont accueillie et soutenue. Lors de ces rencontres, dit-elle, j’ai été « traitée comme une personne, pas comme un numéro ». Peu à peu, elle reconstruit sa confiance et redéfinit sa trajectoire professionnelle. Aujourd’hui, elle travaille au sein d’un organisme communautaire, où elle accompagne des travailleurs internationaux temporaires en les informant de leurs droits et des ressources disponibles.
Pour Cecilia, raconter son histoire l’a amenée à réaliser que « le problème n’était pas en moi, mais en fait dans le regard des autres ». À son tour, elle souhaite soutenir d’autres femmes migrantes pour leur éviter, si possible, de traverser seules les mêmes épreuves.
Des initiatives inspirantes
D’autres initiatives s’inscrivent dans cette volonté de donner place aux autonarrations des personnes migrantes et réfugiées. C’est le cas de Jade Bédard et de Kristina Bastien, fondatrices de l’OBNL Histoires d’Espoir avec lequel nous collaborons dans le cadre du projet Entraide dans les marges. Par la diffusion de récits de personnes ayant immigré au Québec, elles offrent un espace d’expression où se croisent résilience, courage et espoir. Ces témoignages visent à rejoindre d’autres personnes ayant un vécu semblable tout en sensibilisant la société d’accueil à la pluralité des trajectoires.
De la même manière, Paul Tom, réalisateur du documentaire Bagages, avec qui nous collaborons aussi, explore le pouvoir de la narration collective à travers le récit de jeunes nouvellement arrivés au Québec. Provenant de pays aussi divers que le Brésil, la Chine, l’Ukraine, la Colombie, ces jeunes racontent leurs parcours migratoires et leur intégration via des ateliers d’art dramatique.
Ces deux initiatives, parmi tant d’autres, nous rappellent qu’au-delà des chiffres et des slogans, les histoires vécues, fragiles, puissantes et multiples, comptent également, et qu’elles ont le pouvoir de tisser des liens et de transformer les imaginaires.
![]()
Le projet Entraide dans les marges est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).
Camila Goytisolo De Sainz et Hoang Kham NGUYEN ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
– ref. Chiffrer l’immigration ou écouter les personnes ? Le pouvoir des récits de vie – https://theconversation.com/chiffrer-limmigration-ou-ecouter-les-personnes-le-pouvoir-des-recits-de-vie-267697